| . |
|
||||||
|
|
| . |
|
||||||
| La Terre > Les parties de la Terre > Les continents et les √ģles > L'Europe / Etats et territoires |
|
L'Union Européenne |
 |
Organisation hybride,
à la fois intergouvernementale et supranationale, l'Union Européenne
(UE) regroupe 27 Etats européens et
un Etat asiatique (Chypre). Bien qu'elle ne soit
pas une fédération au sens strict, "l'Europe" est beaucoup plus qu'une
association de libre-échange tels que l'ANASE, l'ALENA ou le Mercosur
: elle a beaucoup d'attributs associés à des nations indépendantes :
son propre drapeau, hymne, fondateur
date, et la monnaie, ainsi que d'un début de politique étrangère et
de sécurité dans ses relations avec d'autres nations.
L'évolution de l'Union européenne à
partir d'un accord économique régional entre les six Etats voisins en
1951 peut être considéré comme un phénomène sans précédent dans
les annales de l'histoire. Des unions territoriales fondées sur des bases
dynastiques, destinées à la consolidation du pouvoir des familles régnantes
ont été longtemps la norme en Europe Malheureusement, cette manière inédite de penser le politique, cette expression de civilisation, que sous-tend le projet européen est aujourd'hui entre les mains de politiciens sans vision, qui ont fini par laisser croire que penser l'Europe ne pouvait s'inscrire que dans une alternative utilitariste : soit un économisme étroit, réduisant l'Europe à un bilan comptable, soit la mortifère impasse nationaliste, dont le seul horizon est le repli sur soi. Le résultat est qu'aujourd'hui le cancer nationaliste a répandu ses métastases partout dans l'Union. L'Union Européenne compte a actuellement 27 membres (liste ci-dessous) et deux autres Etats sont candidats : la Macédoine et la Turquie. Le Royaume-Uni, quant à lui, membre depuis 1973, s'est prononcé référendum, le 23 juin 2016, pour sa sortie du projet eurtopéen, qui a été effective à partir du 1er février 2020. On a désigné sous le nom de brexit ( = british exit) le processus de séparation initié par ce vote. Les 27 Etats membres de l'Union européenne
L'Union Européenne englobe un territoire
d'une superficie est de 4,08 millions de kilomètres carrés et réunit
une population d'environ 430 millions d'habitants (depuis le départ du
Royaume-uni). Le siège des institutions européennes se distribue entre
trois villes, considéréées chacune à sa manière comme les capitales
de l'Europe : Bruxelles Les principales villes (ou agglomérations)
de l'Union européenne sont : Paris Institutions européennesL'Union Européenne est dotée d'institutions analogues à celles de ses Etats membres, qui leur délèguent une parties de leurs pouvoirs.Pouvoir exécutif.
Le "collège" des commisssaires européens est formé par le président de la Commission, sur la recommendation des Etats membres. Le Parlement européen doit ensuite confirmer ensuite la composition de cette Commission, qui disposera d'un mandat de cinq ans. Le Conseil européen réunit les chefs d'Etat et de gouvernement et le président de la Commission européenne et se réunit au moins quatre fois par an. Son objectif est de donner l'élan nécessaire pour les grandes questions politiques relatives à l'intégration européenne et d'émettre des directives de politique générale Pouvoir législatif.
‚ÄĘ Le Conseil de l'Union Europ√©enne (ou Conseil des ministres de l'Union). Les ministres des 27 Etats membres, repr√©sentants les int√©r√™ts de leurs Etats, y disposent de 345 voix, qu'ils se r√©partissent √† peu pr√®s proportionnellement √† leurs populations respectives. Le Conseil, dont la pr√©sidence permute entre les √Čtats membres tous les six mois, est le principal organe de d√©cision de l'UE.Pouvoir judiciaire. L'Union Europ√©enne poss√®de une Cour de justice des Communaut√©s europ√©ennes. Elle veille √† ce que les trait√©s sont interpr√©t√©es et appliqu√©es uniform√©ment dans toute l'Union europ√©enne, et s'emploie √† r√©soudre les questions constitutionnelles entre les institutions de l'UE. 27 juges (un par √Čtat membre) nomm√©s pour un mandat de six ans (dans un souci d'efficacit√©, le tribunal peut si√©ger avec 13 juges; on parle alors de "Grande chambre"). S'ajoute √† cela un Tribunal de premi√®re instance compos√© de 27 juges nomm√©s pour un mandat de six ans. Le syst√®me juridique de l'Union Europ√©enne est comparable aux syst√®mes juridiques des Etats membres. C'est le premier syst√®me de droit supranational. La D√©fense europ√©enne.
L'Eurocorps a déjà déployé des forces
armées et de police dans le cadre de missions de maintien de la paix en
Bosnie-Herzégovine En novembre 2004, le Conseil des ministres de l'Union Européenne s'est formellement engagé à créer 13 bataillons tournants de 1500 hommes pour répondre aux crises internationales. 22 des 28 Etats membres ont accepté de fournir des troupes. La France, l'Italie et le Royaume-Uni ont constitué le premier des trois groupes de combat en 2005; la Norvège (non membre de l'UE), la Suède, l'Estonie, et la Finlande a créé un Bataillon Nordique (Nordic Battle Group), effectif depuis 1er Janvier 2008. Neuf autres groupes doivent encore être formés, ainsi qu'une force navale de réaction rapide. Frontières et
disputes internationales.
L'espace
Schengen.
Plusieurs pays qui ne sont pas membres
de l'Union Européenne ont été inclus dans l'espace de Schengen. Il s'agit
de l'Islande Le Royaume-Uni (depuis 2000) et l'Irlande (depuis 2002) ont pris part √† seulement certains aspects de l'espace Schengen, en particulier en mati√®re p√©nale et de police. Neuf des 12 nouveaux √Čtats qui sont entr√©s dans l'Union Europ√©enne depuis 2004 ont rejoint Schengen le 21 d√©cembre 2007. Chypre devrait int√©grer l'espace de Schengen sous peu, tandis qu'il a √©t√© demand√© √† la Roumanie et √† la Bulgarie de continuer √† renforcer leurs syst√®mes de s√©curit√© √† la fronti√®re. Courants et partis
politiques.
Histoire de l'Union EuropéenneHistoire de l'intégration européenne jusqu'en 2005.Dans sa forme et sous son nom actuels, l'Union ne remonte qu'au 7 février 1992 (signature du Traité de Maastricht instituant l'Union européenne) ou au 1er novembre 1993 (entrée en vigueur du Taité de Maastricht). Mais elle ne représente que la dernière étape en date d'un processus commencé au lendemain de la la Seconde guerre mondiale. Après les deux guerres mondiales dévastatrices
dans la première moitié du XXe siècle,
un certain nombre de dirigeants européens à la fin des années 1940,
était convaincus que la seule façon d'établir une paix durable était
d'unir les deux principales nations belligérantes, la France La
Communauté européenne.
En 1967, les institutions des trois communautés ont été officiellement intégrées au sein d'une nouvelle instance nommée Communauté européenne (CE). Celle-ci oeuvrera principalement dans le sens d'une coopération économique accrue et à la définition d'une politique agricole commune. Il a été en outre créé une Commission unique, un seul Conseil des ministres et un Parlement européen. Dans un premier temps, les membres du Parlement européen ont été choisis par les parlements nationaux, mais à partir de 1979, les premières élections directes ont été organisées, et elles ont lieu tous les cinq ans depuis. En 1973, le premier élargissement de la
CE a eu lieu avec l'entr√©e du Danemark 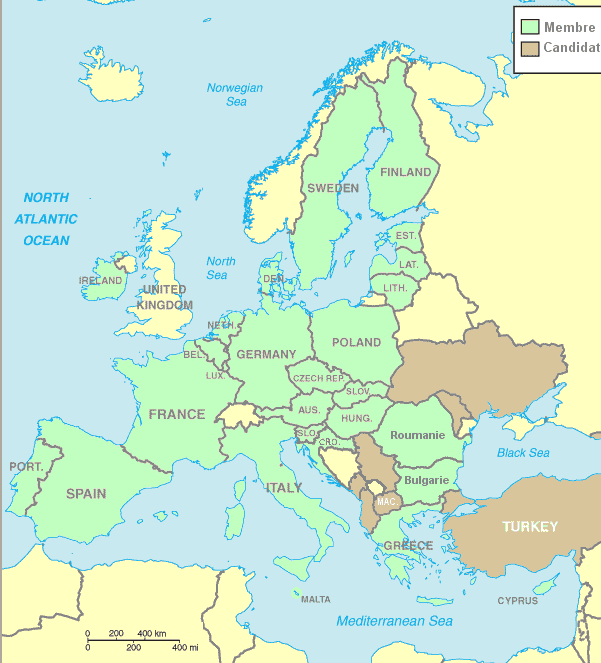
Carte de l'Union Européenne. Source : The World Factbook. Le
Traité de Maastricht.
Des conditions jugées indispensables pour réussir l'union économique et monétaire ont définies, au travers de l'établissement d'un Pacte de stabilité et de croissance. Au coeur de celui-ci se trouve l'exigence d'une discipline budgétaire stricte et de la coordination entre les Etats membres. Des sanctions sont prévues, en particulier, pour les pays qui ne controlent pas leurs déficits budgétaires. Ce faisant, le Traité de Maastricht spécifiait aussi les critères économiques et budgétaires à remplir par les pays souhaitant rejoindre l'Union. Nouveaux
élargissements.
Dix nouveaux pays ont rejoint l'Union Européenne
en 2004 - Chypre Ce nouvel élargissement, par le nombre devenu considérable d'Etats membres, mais aussi par l'effet de traditions politiques diverses, a rendu le fonctionnement de l'Union européenne très complexe. Aussi, afin de veiller à ce que l'UE puisse continuer à fonctionner efficacement, le Traité de Nice (en vigueur à compter dès 1er Février 2003) a énoncé des règles nouvelles destinées à rationaliser les procédures des institutions de l'UE. Les
déboires de la constitutions européenne.
Un nouveau projet de Traité constitutionnel
a été signé le 29 octobre 2004 à Rome L'Union Européenne
depuis 2005.
2010-2015
: crise de la dette souveraine et réponses de l'UE.
Pour prévenir de futures crises, l'UE a renforcé la gouvernance économique avec des mesures comme le Pacte budgétaire européen (2012), qui impose des règles strictes en matière de déficit public et de dette. 2015-2020
: crise migratoire, Brexit et montée du populisme.
En 2016, le Royaume-Uni a voté par référendum en faveur de la sortie de l'UE. Le processus de Brexit a été officiellement lancé en mars 2017, et le Royaume-Uni a quitté l'UE le 31 janvier 2020, après des négociations prolongées sur les termes de la séparation. Plusieurs pays européens ont vu la montée de partis d'extrême-droite (populistes et eurosceptiques), influençant les politiques nationales et européennes. Après
2020.
L'UE a intensifi√© ses efforts pour la transition vers une √©conomie verte et num√©rique, avec des initiatives comme le Pacte vert pour l'Europe (Green Deal) visant la neutralit√© carbone d'ici 2050 et des investissements massifs dans les technologies num√©riques. L'UE a √©galement d√Ľ faire face √† des d√©fis g√©opolitiques, notamment les questions de s√©curit√© et de d√©fense accentu√©es par la guerre men√©e par la Russie contre l'Ukraine. G√©ographie physique de l'Union Europ√©enneL'Union Europ√©enne s'√©tend sur une portion vaste et remarquablement diverse du continent europ√©en. Elle couvrant des territoires allant de l'Arctique au nord √† la M√©diterran√©e au sud, et de l'Atlantique √† l'ouest √† des parties de l'Europe de l'Est.Relief.
En contraste avec les zones montagneuses, de vastes plaines s'√©tendent sur une grande partie du territoire de l'UE. Elles constituent des zones agricoles majeures et dens√©ment peupl√©es. La Grande Plaine Europ√©enne est la plus √©tendue, traversant la Pologne, l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas. Cette plaine est caract√©ris√©e par une faible altitude, des sols souvent sableux et de nombreux cours d'eau lents et lacs. Parmi les autres plaines importantes on mentionnera le Bassin de Paris et le Bassin Aquitain en France, la plaine Pannonienne (ou Hongroise) dans le sud-est, et la fertile plaine du P√ī en Italie. Les vall√©es fluviales constituent √©galement des couloirs de basse altitude importants. La g√©ologie sous-jacente est √©galement complexe, incluant des boucliers anciens au nord, des massifs hercyniens au centre, et des cha√ģnes alpines plus jeunes au sud, ainsi que de vastes bassins s√©dimentaires, ce qui contribue √† la richesse et √† la vari√©t√© des paysages et des ressources naturelles. Hydrographie.
C√ītes et √ģles.
Climat.
Biog√©ographie de l'Union Europ√©enneL'extraordinaire diversit√© physique et climatique de l'Union Europ√©enne se traduit directement par une richesse biog√©ographique remarquable, avec une multitude d'√©cosyst√®mes et d'habitats abritant une flore et une faune sp√©cifiques, qui refl√®tent les gradients latitudinaux, longitudinaux et altitudinaux.Les grandes for√™ts constituent un √©l√©ment majeur de la biog√©ographie de l'UE. On trouve des for√™ts bor√©ales de conif√®res domin√©es par les pins et les √©pic√©as dans le nord de la Su√®de et de la Finlande. Plus au sud, dans le centre et l'ouest, dominent les for√™ts temp√©r√©es d√©cidues et mixtes, riches en esp√®ces d'arbres comme les ch√™nes, les h√™tres, les √©rables et les tilleuls. Les for√™ts montagnardes varient en composition selon l'altitude, passant des for√™ts de feuillus aux for√™ts de conif√®res puis aux prairies alpines. Dans le sud, les for√™ts m√©diterran√©ennes sont adapt√©es √† la s√©cheresse estivale, avec des esp√®ces scl√©rophylles comme le ch√™ne vert, le ch√™ne-li√®ge et diverses esp√®ces de pins. Les paysages forestiers varient des grandes √©tendues relativement continues dans certaines r√©gions de l'Est et du Nord aux for√™ts fragment√©es, g√©r√©es et g√©n√©ralement entour√©es de paysages agricoles dans l'Ouest et le Sud. Au sud, le maquis (formation arbustive dense) et la garrigue (formation plus ouverte) sont des √©cosyst√®mes caract√©ristiques sur sols calcaires ou siliceux, riches en esp√®ces aromatiques et adapt√©s aux incendies. Les vastes plaines, autrefois potentiellement couvertes de for√™ts ou de steppes herbeuses (comme dans la Plaine Pannonienne, r√©sidus de steppes), sont aujourd'hui majoritairement transform√©es en paysages agricoles intensifs, qui supportent n√©anmoins une biodiversit√© associ√©e, adapt√©e √† ces milieux anthropis√©s (ex: oiseaux des plaines, insectes pollinisateurs). Les zones humides sont des √©cosyst√®mes d'une importance capitale pour de nombreuses esp√®ces. Elles comprennent les estuaires, les pr√©s sal√©s, les deltas (Delta du Danube, delta du Rh√īne), les tourbi√®res (en Irlande, Finlande, pays Baltes), les √©tangs et les lacs, et servent de zones de reproduction, d'alimentation ou de haltes migratoires pour les oiseaux et d'autres esp√®ces. Les milieux aquatiques int√©rieurs (rivi√®res et lacs) h√©bergent √©galement une faune (poissons, invert√©br√©s) et une flore (plantes aquatiques) sp√©cifiques, dont la sant√© est √©troitement li√©e √† la qualit√© de l'eau et √† la morphologie des cours d'eau. Les environnements c√ītiers et marins vont des √©cosyst√®mes des zones intertidales (rocheuses, sableuses, vaseuses) aux herbiers marins (posidonies en M√©diterran√©e, zost√®res en Atlantique) et aux fonds rocheux ou sableux, supports de biodiversit√© adapt√©e aux conditions salines et dynamiques. Les r√©gions alpines et montagnardes h√©bergent des √©cosyst√®mes distincts adapt√©s aux altitudes √©lev√©es, caract√©ris√©s par une v√©g√©tation √©tag√©e (for√™ts d'altitude, prairies alpines, landes, v√©g√©tation de rochers et √©boulis). Ce sont souvent des refuges pour des esp√®ces end√©miques ou adapt√©es au froid. Cependant, l'impact humain, √† travers l'agriculture intensive, l'urbanisation croissante, le d√©veloppement des infrastructures, la pollution et, plus r√©cemment, l'acc√©l√©ration du changement climatique, a profond√©ment modifi√© de nombreux habitats, et entra√ģn√© des pertes de biodiversit√©, la fragmentation des √©cosyst√®mes et l'introduction d'esp√®ces exotiques envahissantes. En r√©ponse, l'Union Europ√©enne a mis en place des politiques de conservation ambitieuses pour tenter d'enrayer ce d√©clin et restaurer certains √©cosyst√®mes, notamment le r√©seau Natura 2000, le plus grand r√©seau coordonn√© de zones prot√©g√©es au monde, qui vise √† prot√©ger les habitats et les esp√®ces les plus importants et menac√©s √† travers un r√©seau coh√©rent de sites (Zones sp√©ciales de conservation pour les habitats et les esp√®ces, et Zones de protection sp√©ciale pour les oiseaux sauvages) couvrant une part significative du territoire terrestre et marin des √Čtats membres. G√©ographie humaine de l'Union Europ√©ennePopulation.L'Union Europ√©enne est un ensemble de 27 √Čtats membres, abritant environ 450 millions d'habitants, ce qui en fait la troisi√®me entit√© politique la plus peupl√©e du monde, derri√®re l'Inde et la Chine. La r√©partition de cette population est tr√®s in√©gale, avec des densit√©s √©lev√©es dans l'Ouest et le Centre de l'Europe (notamment dans la "Banane Bleue" s'√©tendant du sud de l'Angleterre √† l'Italie du Nord, en passant par le Benelux, le nord de la France et l'ouest de l'Allemagne) et le long des c√ītes, contrastant avec des zones beaucoup moins peupl√©es en Scandinavie, dans les pays baltes ou certaines r√©gions int√©rieures d'Espagne ou de France. Au-del√† des chiffres bruts de population, la d√©mographie europ√©enne est caract√©ris√©e par des tendances profondes. La plus significative est le vieillissement de la population. L'esp√©rance de vie y est parmi les plus √©lev√©es au monde, tandis que les taux de f√©condit√© sont g√©n√©ralement bas (souvent inf√©rieurs au seuil de renouvellement des g√©n√©rations de 2,1 enfants par femme). Cette combinaison entra√ģne une augmentation de la part des personnes √Ęg√©es et une diminution relative de la population en √Ęge de travailler dans de nombreux pays membres, ce qui pose des d√©fis majeurs pour les syst√®mes de sant√©, les retraites et le march√© du travail. Les dynamiques d√©mographiques varient cependant consid√©rablement entre les √Čtats membres, avec des pays de l'Est et du Sud qui connaissent parfois un vieillissement plus rapide ou m√™me une diminution de leur population totale. L'UE se caract√©rise par une forte mobilit√© interne, facilit√©e par l'espace Schengen (libre circulation des personnes) et le march√© unique (libre circulation des travailleurs). Des millions de citoyens europ√©ens vivent et travaillent dans un autre √Čtat membre que le leur,et contribuent √† la mixit√© et √† l'√©change de comp√©tences. Parall√®lement √† cette mobilit√© intra-europ√©enne, l'UE est une destination majeure pour l'immigration extra-europ√©enne, pour des raisons √©conomiques, politiques, ou familiales. Ces flux migratoires, aux origines diverses (Afrique, Asie, Am√©riques), enrichissent le tissu social et culturel mais posent √©galement des questions complexes d'int√©gration, de gestion des fronti√®res et de coh√©sion sociale, avec des d√©bats vifs sur la mani√®re de concilier diversit√© et unit√©. Une grande majorit√© de la population vit dans des villes, qui sont les moteurs √©conomiques, culturels et politiques. L'Europe abrite un r√©seau dense de villes de tailles tr√®s diverses, des m√©tropoles mondiales comme Paris, Berlin, Rome ou Madrid, aux capitales nationales, aux grandes villes r√©gionales et aux myriades de villes de taille moyenne et de petites villes. Ces centres urbains concentrent les emplois, les services, l'innovation, mais sont aussi confront√©s √† des d√©fis tels que la gentrification, la s√©gr√©gation spatiale, la gestion des transports et la pollution. Parall√®lement aux zones urbaines, les espaces ruraux occupent une part importante du territoire europ√©en. Ils pr√©sentent des dynamiques vari√©es : certaines r√©gions rurales connaissent une d√©population et un vieillissement acc√©l√©r√©, tandis que d'autres b√©n√©ficient d'une proximit√© avec les zones urbaines, d'une attractivit√© touristique ou d'un d√©veloppement de nouvelles activit√©s. Les liens et les interd√©pendances entre les zones urbaines et rurales sont essentiels √† l'√©quilibre territorial. Enfin, l'existence m√™me de l'Union Europ√©enne en tant qu'entit√© politique supranationale a un impact profond sur sa g√©ographie humaine. Les politiques communes (comme la politique agricole commune, les fonds structurels, les programmes de recherche, la politique migratoire) influencent directement ou indirectement la r√©partition de la population, le d√©veloppement r√©gional, les modes de vie, les √©changes et l'identit√© des citoyens. L'id√©e d'une citoyennet√© europ√©enne coexistante avec les citoyennet√©s nationales ajoute une couche suppl√©mentaire √† la complexit√© des identit√©s individuelles et collectives. La conscience d'appartenir √† un ensemble europ√©en est variable selon les r√©gions et les groupes sociaux. Quelques-unes des villes au centre des dynamiques de l'Union Europ√©enne
Culture. La richesse culturelle et linguistique est sans doute l'une des caract√©ristiques les plus marquantes de la g√©ographie humaine de l'UE. On y parle plus de 24 langues officielles et de nombreuses langues r√©gionales ou minoritaires. Cette diversit√© linguistique refl√®te l'histoire. Si l'anglais fonctionne souvent comme langue v√©hiculaire, le multilinguisme reste une r√©alit√© quotidienne et un principe fondateur de l'Union. Sur le plan religieux, le christianisme, sous ses diff√©rentes formes (catholicisme, protestantisme, orthodoxie), a longtemps √©t√© dominant, mais l'Europe conna√ģt un ph√©nom√®ne de s√©cularisation marqu√©, en particulier dans les pays de l'Ouest et du Nord. Parall√®lement, d'autres religions, notamment l'Islam, ont gagn√© en visibilit√©, particuli√®rement dans les grandes villes, et contribuent √† un paysage religieux de plus en plus diversifi√©. Les traditions, les arts, les cuisines, les modes de vie varient consid√©rablement d'une r√©gion √† l'autre. Ils t√©moignent de l'enracinement local des identit√©s tout en participant √† une certaine europ√©anisation des pratiques culturelles. Au coeur de cette culture multiforme se trouvent des fondements historiques communs profonds, issus des h√©ritages grec, romain, jud√©o-chr√©tien, mais aussi des Lumi√®res, des r√©volutions industrielles et d√©mocratiques, ainsi que des exp√©riences partag√©es du XXe si√®cle, notamment les guerres mondiales et la construction de la paix et de l'int√©gration qui a suivi. Ces exp√©riences collectives ont forg√© un socle de valeurs fondamentales qui sont officiellement ancr√©es dans les trait√©s de l'Union : le respect de la dignit√© humaine, la libert√©, la d√©mocratie, l'√©galit√©, l'√Čtat de droit et le respect des droits humains, y compris les droits des personnes appartenant √† des minorit√©s. Ces valeurs, bien que d√©clin√©es diff√©remment selon les contextes nationaux, constituent un ciment essentiel et un point de r√©f√©rence pour l'action de l'Union et l'identit√© de ses citoyens. L'UE joue un r√īle facilitateur et de soutien √† la culture, sans chercher √† uniformiser. √Ä travers des programmes comme Europe Cr√©ative ou Erasmus+, elle encourage la mobilit√© des artistes, des √©tudiants, des chercheurs, des professionnels de la culture, favorisant ainsi les √©changes interculturels, la coproduction artistique et la diffusion des oeuvres au-del√† des fronti√®res nationales. ‚ÄĘ Europe Cr√©ative est le principal instrument de l'UE d√©di√© aux secteurs culturels et cr√©atifs. L'objectif de ce programme est de renforcer la diversit√© culturelle et linguistique europ√©enne, d'accro√ģtre la comp√©titivit√© de ces secteurs et de promouvoir la circulation des oeuvres et des artistes europ√©ens. Il est structur√© en trois volets principaux : le volet Culture soutient la coop√©ration transnationale, les r√©seaux, les plateformes, la traduction litt√©raire et la mobilit√© des artistes et professionnels de la culture; le volet M√©dia vise √† renforcer l'industrie audiovisuelle europ√©enne, notamment en soutenant le d√©veloppement, la distribution et la promotion d'oeuvres, ainsi que la formation et les festivals; enfin, un volet Transsectoriel favorise l'innovation, la collaboration entre diff√©rents secteurs, le soutien aux m√©dias d'information et le d√©veloppement de politiques culturelles. Europe Cr√©ative finance des projets qui ont un impact europ√©en, encouragent l'acc√®s √† la culture et √† la cr√©ation pour un large public, et abordent des th√®mes prioritaires comme l'inclusion sociale, la durabilit√© environnementale et la transformation num√©rique.La reconnaissance des Capitales europ√©ennes de la culture chaque ann√©e met en lumi√®re la richesse et la diversit√© des sc√®nes culturelles locales et r√©gionales √† travers l'Europe. La protection et la promotion du patrimoine culturel, mat√©riel et immat√©riel, sont √©galement des priorit√©s, reconnaissant que ce patrimoine commun, dans toute sa diversit√©, est essentiel √† la m√©moire collective et √† l'identit√© europ√©enne. ‚ÄĘ Les Capitales europ√©ennes de la culture sont des villes ou des r√©gions d√©sign√©es par l'Union europ√©enne pour une dur√©e limit√©e, g√©n√©ralement une ann√©e enti√®re, afin de promouvoir leur patrimoine culturel, historique et artistique et valoriser ainsi la diversit√© culturelle du continent. Ce programme, mis en place dans le cadre de la politique culturelle de l'UE, vise √† renforcer la coh√©sion sociale et territoriale en Europe tout en favorisant l'√©change interculturel et l'int√©gration entre les citoyens europ√©ens. Chaque ann√©e, plusieurs villes ou r√©gions sont choisies parmi les pays membres de l'Union europ√©enne. Ces villes ou r√©gions se distinguent par un projet culturel ambitieux qui doit inclure une s√©rie d'√©v√©nements, d'expositions, de festivals et d'activit√©s artistiques vari√©es. Leur objectif est de mettre en lumi√®re leur richesse culturelle. Pour √™tre d√©sign√©e, une ville ou une r√©gion doit soumettre une candidature comprenant un plan d√©taill√© de ses projets culturels. Ce plan doit s'appuyer sur une programmation originale qui mette en avant les atouts sp√©cifiques de la ville ou de la r√©gion, tout en √©tant accessible √† tous les publics. L'accent est √©galement mis sur la participation active des habitants locaux, ainsi que sur l'accueil des visiteurs venus d'autres r√©gions de l'Europe. Le processus de s√©lection est g√©r√© par la Commission europ√©enne, en collaboration avec les √Čtats membres concern√©s. Les candidatures sont √©valu√©es selon des crit√®res tels que l'innovation culturelle, la qualit√© des propositions artistiques, l'engagement communautaire, et le potentiel de d√©veloppement durable. Lorsqu'une ville ou une r√©gion est d√©sign√©e, elle b√©n√©ficie d'un soutien financier de l'Union europ√©enne, qui peut atteindre plusieurs millions d'euros. Cet argent est utilis√© pour financer la programmation culturelle, mais aussi pour am√©liorer l'infrastructure culturelle locale, renforcer la coop√©ration transfrontali√®re, et promouvoir la ville ou la r√©gion √† l'√©chelle europ√©enne.La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, un principe fondateur du march√© unique, a √©galement un impact culturel majeur. Elle permet une confrontation quotidienne entre diff√©rentes mani√®res de vivre, de penser, de consommer la culture, conduisant √† des hybridations et √† une meilleure compr√©hension mutuelle, m√™me si elle peut aussi parfois g√©n√©rer des tensions ou des questions li√©es √† la pr√©servation des identit√©s nationales face aux influences ext√©rieures. La culture de l'Union Europ√©enne est donc intrins√®quement li√©e √† son projet politique : un espace de coop√©ration, de paix et de prosp√©rit√©, b√Ęti sur le respect des diff√©rences et la volont√© de travailler ensemble. Elle se manifeste dans les modes de vie vari√©s de ses citoyens, dans leurs expressions artistiques multiples (cin√©ma, musique, litt√©rature, arts visuels...), dans leurs traditions culinaires diverses, dans leurs syst√®mes √©ducatifs et sociaux, tout en √©tant travers√©e par des d√©bats et des pr√©occupations communes (d√©mocratie, environnement, justice sociale, rapport au monde ext√©rieur). Economie.
Adopt√©e par la majorit√© des √Čtats membres, la monnaie unique, l'euro, a √©limin√© les risques de change et r√©duit les co√Ľts de transaction entre les pays participants, facilitant ainsi le commerce et l'investissement. La politique mon√©taire pour la zone euro est g√©r√©e de mani√®re ind√©pendante par la Banque Centrale Europ√©enne (BCE), dont l'objectif principal est de maintenir la stabilit√© des prix. La coordination des politiques budg√©taires rel√®ve quant √† elle des √Čtats membres, bien qu'elle soit encadr√©e par le Pacte de Stabilit√© et de Croissance visant √† pr√©venir les d√©ficits excessifs et l'accumulation de dettes publiques non viables, m√™me si son application a connu des ajustements et des d√©bats au fil du temps. L'√©conomie europ√©enne est majoritairement orient√©e vers les services, un secteur qui contribue de mani√®re pr√©pond√©rante au PIB et √† l'emploi. Il englobe une vaste gamme d'activit√©s allant de la finance et de l'assurance au commerce de d√©tail, en passant par les transports, les t√©l√©communications, le tourisme et les services publics. L'industrie manufacturi√®re conserve n√©anmoins une importance significative, notamment dans des secteurs √† forte valeur ajout√©e comme l'automobile, la machinerie, la chimie et la pharmacie, bien que sa part dans l'emploi total ait diminu√© au fil des d√©cennies. L'agriculture, tout en ne repr√©sentant qu'une petite part du PIB et de l'emploi total, reste strat√©gique et b√©n√©ficie de la Politique Agricole Commune (PAC), qui vise √† soutenir les agriculteurs, assurer la s√©curit√© alimentaire et promouvoir des pratiques durables. Les √Čtats membres pr√©sentent des structures √©conomiques, des niveaux de richesse (PIB par habitant), des taux de ch√īmage et des syst√®mes sociaux tr√®s vari√©s. Cette h√©t√©rog√©n√©it√© constitue √† la fois une force, en offrant une diversit√© de sp√©cialisations et de march√©s, et un d√©fi, en termes de convergence √©conomique et sociale. La politique de coh√©sion de l'UE vise pr√©cis√©ment √† r√©duire ces disparit√©s en finan√ßant des projets dans les r√©gions moins d√©velopp√©es. L'√©conomie de l'UE fait face √† de nombreux d√©fis structurels et conjoncturels. Parmi les d√©fis structurels figurent le vieillissement d√©mographique, qui met sous pression les syst√®mes de retraite et de sant√© et peut entra√ģner des p√©nuries de main-d'oeuvre; la n√©cessit√© d'accro√ģtre la comp√©titivit√© mondiale, notamment face aux √©conomies √©mergentes et aux g√©ants technologiques; la transition √©cologique et num√©rique, qui n√©cessite des investissements massifs, la reconversion de certaines industries et l'adaptation des comp√©tences de la main-d'oeuvre. Les d√©fis conjoncturels incluent la gestion des chocs externes, tels que la pand√©mie de covid-19, la crise √©nerg√©tique exacerb√©e par la guerre en Ukraine, les tensions g√©opolitiques, et la gestion de l'inflation. Le commerce, tant interne qu'externe, est un moteur essentiel de l'√©conomie de l'UE. Le march√© unique g√©n√®re un volume d'√©changes intra-UE consid√©rable. Sur la sc√®ne mondiale, l'UE est un acteur commercial majeur, √©tant le premier exportateur et importateur mondial de biens et services. Elle maintient un r√©seau √©tendu d'accords commerciaux avec des pays tiers. Les instances de l'Union Europ√©enne s'efforcent de r√©duire les obstacles au commerce entre les Etats membres, d'√©tendre l'adoption de la monnaie commune et de progresser vers la convergence des niveaux de vie. Sur le plan international, l'UE vise √† renforcer la position commerciale de l'Europe et de son pouvoir politique et √©conomique. En raison des grandes disparit√©s dans le revenu par habitant entre les Etats membres des animosit√©s historiques entre pays qui persistent, des √©go√Įsmes nationaux et des pr√©occupations √©lectoralistes des dirigeants politiques, l'Union Europ√©enne est sans cesse confront√©e √† des difficult√©s dans l'√©laboration et l'application de politiques √©conomiques communes. Depuis 2003, par exemple, l'Allemagne et la France enfreignent l'obligation qu'ont les Etats membres de maintenir au dessous de 3% le d√©ficit de leur budgets nationaux de fonctionnement.
|
| . |
|
|
|
||||||||
|