| . |
|
||||||
|
|
| . |
|
||||||
|
DĂ©partement de la Martinique |

14 40 N, 61 00 W |
La Martinique
est un département et une région d'Outre-mer de la France depuis 1946.
C'est une des Petites Antilles située à 110 kilomètres au Sud-Est de
la Guadeloupe. Superficie :1128 km²; population
(2025) : environ 350 000 personnes.
-- 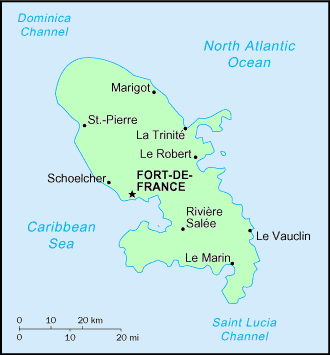
Carte de la Martinique. Source : The World Factbook. (Cliquer sur l'image pour afficher une carte plus détaillée). Géographie physique
de la Martinique.
La partie centrale de l'île forme une sorte de transition entre le nord montagneux et le sud plus plat. On y trouve des plaines et des collines ondulées, comme la plaine du Lamentin ou la région de Saint-Joseph. Cette zone est propice à l'agriculture intensive, notamment à la culture de la canne à sucre et de la banane, en raison des sols volcaniques fertiles et de l'abondance en eau. Elle constitue également un bassin de population important, qui concentre des infrastructures majeures comme l'aéroport international Aimé Césaire. Au sud, la géographie devient plus douce, avec des mornes aux formes arrondies et des altitudes plus modestes. Cette région est caractérisée par un climat plus sec et un réseau hydrographique moins dense. On y observe une importante fragmentation du littoral, avec de nombreuses anses, baies et pointes rocheuses qui contrastent avec les longues plages de sable blanc protégées par des récifs coralliens. C'est une zone fortement tournée vers le tourisme. Le littoral martiniquais, quant à lui, est varié : au nord, les côtes sont abruptes, rocheuses et battues par de fortes houles, tandis qu'au sud, elles sont plus calmes, et accueillent des lagons et des mangroves, comme celle de la baie de Génipa. Enfin, l'île se situe dans une zone sismiquement active, ce qui, en plus de son volcanisme, en fait une région exposée à divers risques naturels : séismes, éruptions, cyclones et glissements de terrain. Biogéographie
de la Martinique.
Sur le plan de la végétation, la Martinique présente une succession d'étages écologiques en fonction de l'altitude, de la pluviométrie et de l'exposition aux vents alizés. Dans les zones montagneuses humides du nord, en particulier sur les versants de la montagne Pelée et les Pitons du Carbet, on trouve une forêt tropicale humide dense, caractérisée par une strate supérieure dominée par des arbres tels que le gommier blanc (Dacryodes excelsa), le bois rivière et le mahogany. Cette forêt abrite une flore épiphyte très développée – fougères arborescentes, orchidées, broméliacées – et constitue un refuge essentiel pour de nombreuses espèces animales. Plus bas, dans les zones de transition au centre de l'île, on rencontre des forêts mésophiles ou des forêts semi-humides, où cohabitent espèces de forêts humides et essences plus tolérantes à la sécheresse. Ces zones ont souvent été modifiées par les activités agricoles, notamment la culture de la canne à sucre, du manioc et de la banane, entraînant la fragmentation des habitats originels. Le sud de la Martinique, plus sec, abrite une végétation xérophile ou de type savane, avec des forêts sèches littorales, des cactus, des gommiers rouges, des poiriers pays et une flore arbustive adaptée aux sols pauvres et à la saison sèche prolongée. Ces milieux, très sensibles à l'érosion et à l'anthropisation, sont aussi les plus vulnérables aux incendies et à l'urbanisation touristique. Du côté de la faune terrestre, l'endémisme insulaire est relativement modéré comparé aux grandes îles océaniques, mais néanmoins significatif. La Martinique héberge plusieurs espèces d'amphibiens, de reptiles et d'oiseaux propres à l'arc antillais. Parmi les espèces emblématiques, on peut citer l'anolis de la Martinique (Anolis roquet), le moqueur gorge-blanche (Ramphocinclus brachyurus, endémique de Sainte-Lucie et de la Martinique), et le crapaud des Antilles (Leptodactylus fallax), aujourd'hui en danger critique. Les mammifères natifs sont peu nombreux; la faune terrestre comprend surtout des espèces introduites comme la mangouste indienne, qui a provoqué le déclin dramatique de nombreuses espèces autochtones. Les écosystèmes marins et littoraux sont particulièrement diversifiés, avec de récifs coralliens, des herbiers marins et des mangroves. Les récifs frangeants du sud et de l'ouest abritent une biodiversité marine tropicale typique : poissons tropicaux, coraux durs, oursins, mollusques, langoustes et tortues marines (comme la tortue verte et la tortue imbriquée). Les mangroves, notamment celles des baies de Fort-de-France et de Génipa, jouent un rôle écologique et hydrologique crucial en servant de nurseries pour les poissons, en stabilisant les sols côtiers et en filtrant les eaux. Cependant, cette richesse biogéographique est soumise à de fortes pressions : déforestation historique, fragmentation des habitats, pollution agricole, développement urbain et touristique, espèces exotiques envahissantes et réchauffement climatique. Des programmes de protection et de conservation sont mis en oeuvre par le Parc naturel régional de la Martinique et des associations locales, qui oeuvrent à la préservation des habitats critiques, à la réintroduction d'espèces et à la sensibilisation des populations locales. Géographie humaine de la Martinique. La population martiniquaise, qui dépasse les 350 000 habitants, est inégalement répartie sur le territoire. La majorité des habitants se concentre sur la façade occidentale de l'île, notamment dans la région Centre-Atlantique et autour de la capitale, Fort-de-France. Cette ville, véritable coeur administratif, économique et culturel de la Martinique, joue un rôle polarisateur à l'échelle insulaire. Elle forme, avec ses communes limitrophes comme Schoelcher, Le Lamentin et Saint-Joseph, une aire urbaine dense où se concentrent les services, les équipements publics, les établissements d'enseignement, les pôles hospitaliers et les zones d'activités industrielles et commerciales. Le Lamentin, en particulier, se distingue comme pôle économique majeur. Il abrite l'aéroport international Aimé Césaire, de nombreuses entreprises, et des zones franches. À l'inverse, les communes rurales du Nord et du Sud présentent des densités de population plus faibles, généralement liées à des activités traditionnelles comme l'agriculture, bien que le tourisme tende à remodeler le littoral sud de façon significative, notamment dans des communes comme Sainte-Anne, Le Diamant ou Les Trois-Îlets. Le tissu urbain de la Martinique reste très marqué par une dualité entre zones urbanisées concentrées dans la moitié ouest et espaces naturels ou agricoles dans la moitié est et le nord montagneux. L'urbanisation rapide au XXe siècle a entraîné une artificialisation des sols, des problèmes de congestion routière, et une dépendance marquée à la voiture individuelle, faute de transports en commun efficaces à l'échelle régionale. Cette structuration spatiale génère des inégalités d'accès aux services et des formes de ségrégation socio-territoriale. L'économie de la Martinique repose historiquement sur l'agriculture de plantation, notamment la canne à sucre, la banane et les cultures vivrières. Toutefois, ce secteur est en recul, fragilisé par les crises agricoles, la concurrence internationale, et les scandales environnementaux (notamment celui du chlordécone). Aujourd'hui, le tertiaire domine largement et représentent près de 80 % des emplois, en particulier dans les administrations publiques, le commerce, les services à la personne et le tourisme. Ce dernier secteur s'appuie sur l'attractivité du patrimoine naturel, des plages et des infrastructures hôtelières, concentrées surtout dans le sud. Sur le plan social et démographique, la Martinique fait face à plusieurs défis majeurs. Le vieillissement de la population est accentué par une forte émigration des jeunes vers la Métropole, en quête de formations et d'emplois. Le taux de natalité en baisse et l'exode de la jeunesse participent à une décroissance démographique observable depuis le début des années 2010. Par ailleurs, le chômage reste élevé, particulièrement chez les jeunes, malgré les politiques de formation et d'insertion. La société martiniquaise est aussi profondément marquée par son histoire coloniale et esclavagiste. Cette mémoire se manifeste dans les revendications identitaires, les tensions autour de la langue créole, les débats sur l'autonomie politique et la place de la culture locale dans l'espace public. Des mouvements sociaux récurrents, portés par des syndicats puissants et des associations, expriment régulièrement des demandes de justice sociale, de reconnaissance historique et d'amélioration des conditions de vie. Les politiques d'aménagement du territoire cherchent à répondre à ces enjeux en promouvant un développement plus équilibré, en renforçant les réseaux de transport, en soutenant l'économie verte et l'agriculture durable, et en protégeant les milieux naturels. La Martinique bénéficie aussi de fonds européens structurels qui visent à réduire les inégalités régionales et à stimuler l'innovation. Principaux centres urbains de la Martinique
|
| . |
|
|
|
||||||||
|