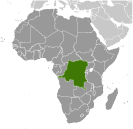0
00 N, 25 00 E
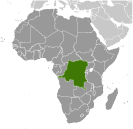 |
La République
Démocratique du Congo (RDC) ,
ou Congo-Kinshasa, qui a aussi porté le nom de Zaïre, est
un Etat de l'Afrique ,
ou Congo-Kinshasa, qui a aussi porté le nom de Zaïre, est
un Etat de l'Afrique équatoriale, frontalier de la République
du Congo (RC), de la Centrafrique, du
Soudan
du Sud, de l'Ouganda, du Rwanda,
du Burundi, de la Tanzanie,
de la Zambie et de l'Angola
équatoriale, frontalier de la République
du Congo (RC), de la Centrafrique, du
Soudan
du Sud, de l'Ouganda, du Rwanda,
du Burundi, de la Tanzanie,
de la Zambie et de l'Angola . .
Comprenant presque tout le bassin
du fleuve Congo, et d'une superficie de 2,344 millions de km², c'est le
second plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie .
Capitale : Kinshasa (7,8 millions d'habitants).
Autres villes importantes : Lubumbashi (1,4 million d'habitants), Mbuji-Mayi
(875 000 hab.), Kisangani (540 000), Masina (486 000), Kananga, Likasi,
Kolwezi (dépassant elles aussi les 400 000 habitants), etc. Population
totale : 73,6 millions d'habitants (2012). Le pays est divisé administrativement
en 10 provinces et une ville (Kinshasa) : .
Capitale : Kinshasa (7,8 millions d'habitants).
Autres villes importantes : Lubumbashi (1,4 million d'habitants), Mbuji-Mayi
(875 000 hab.), Kisangani (540 000), Masina (486 000), Kananga, Likasi,
Kolwezi (dépassant elles aussi les 400 000 habitants), etc. Population
totale : 73,6 millions d'habitants (2012). Le pays est divisé administrativement
en 10 provinces et une ville (Kinshasa) :
Les provinces
du Congo-Kinshasa
Bandundu
Bas-Congo
Equateur
Kasai-Occidental
Kasai-Oriental |
Katanga
Maniema
Nord-Kivu
Province
Orientale
Sud-Kivu |
La côte.
Une étroite bande de terre le long du
cours inférieur du fleuve Congo, entre l'Angola
proprement dit et l'enclave angolaise de Cabinda, lui donne accès à l'Océan
Atlantique sur 37 kilomètres. Le littoral est précédé d'une barre
qui le rend absolument inaccessible aux navires de mer. La crique de Banana
constitue, par contre, un des plus beaux ports naturels de la côte occidentale
d'Afrique. Son entrée est resserrée entre deux vastes bancs de sable,
visibles à marée basse; le banc de Stella, à l'Ouest et le banc de Dialmath
à l'Est, mais sa largeur augmente rapidement jusqu'à 1000 m. La langue
de terre qui sépare cette crique de la mer mesure environ 3 km de longueur;
sa largeur varie de 40 à 100 m. Elle a été jadis plus large qu'elle
ne l'est actuellement. Du côté de l'Océan, la presqu'île de Banana
présente une plage magnifique de sable fin, en pente douce nommée Praia
dos Pescadares (plage des Pêcheurs).
Relief du sol.
Le trait caractéristique du système
orographique du Congo-Kinshasa est l'absence complète de chaînee centrale.
Contrairement à ce qui existe en Europe, les montagnes sont principalement
côtières, il en résulte que le bassin du Congo est entouré d'une région
plus élevée que l'intérieur même des terres . Les monts de Cristal
à travers lesquels le fleuve s'est creusé un passage vers l'Océan ont
à peine 600 m d'altitude. Les hauteurs qui se profilent parallèlement
à la côte Nord du Congo se prolongent au Sud du fleuve en suivant la
même allure. Ce sont des rochers de granit, de gneiss et de schistes anciens
qui, dans leur ensemble, s'orientent dans la direction du Nord-Ouest au
Sud-Est. Sur la ligne de faîte du Congo et du Kouilou, leur altitude moyenne
est de 750 m. A l'Ouest du Kouango moyen quelques cimes dépassent 1100m
et, près des sources, le plateau même atteint 1600 m. C'est là que se
trouve la nappe de partage qui déverse ses eaux d'un côté vers l'Atlantique
par le Kassaï; de l'autre, dans l'Océan Indien par le Zambèze. A l'Est
du bassin du Congo, le relief du sol est moins régulier qu'à l'Ouest,
les chaînes bordières sont beaucoup plus inégales de forme et moins
rectilignes d'allure, mais elles atteignent en quelques endroits une plus
grande hauteur. L'amphithéâtre de montagnes qui s'élève au Sud du lac
Bangouéolo est dominé par les cimes de Lokinga. Celles-ci se rattachent
par des contreforts latéraux aux terrasses des monts Viano et Koni qui
s'étendent des sources du Loualaba jusqu'au Tanganyika.
-

Carte
de la République démocratique du Congo.
Source
: The World Factbook.
(Cliquer
sur l'image pour afficher une grande carte).
A l'Est de ce lac, des plateaux accidentés
continuent la région du faite entre le Congo et les affluents de l'océan
Indien. Entre le Tanganyka et le Victoria-Nyanza se dressent les trois
cimes bleues de Mfoumbiro dont le versant oriental donne naissance à la
Kagera, branche maîtresse du Nil.
L'arête de partage qui rattache le lac
Tanganyika au bassin du Congo passe à l'Ouest de Mouta nzigé où elle
forme une ligne continue de terrains élevés dont le plus haut point atteint
1800 m. A l'est de cette ligne coule le Semliki qui relie le lac Albert-Edouard
(Mouta nzigé) au lac Albert Nyanza dont sort une des branches du Nil.
Son revers occidental descend en pente douce vers les bassins de l'Arouhouimi
et de la Lohoua, affluents du Congo. Au Nord-Est, le faite de partage entre
le Congo et le « pays des Rivières » nilotiques est à peine indiqué
par quelques renflements de terrains de montagnes isolées n'ayant que
500 m d'altitude au-dessus du seuil et des plaines à pente indécise.
Il en est à peu près de même entre le versant du Congo et celui du Chari.
Géologie.
Le sous-sol le long des rives du Congo
intérieur est formé d'un calcaire tendre et impur surmonté de sable,
et d'argile, disposé en couches sensiblement horizontales. Sur le fond
du fleuve, on voit des accumulations considérables d'une espèce fluvio-marine
de Galathée, à valves grandes et épaisses, utilisée pour la fabrication
de la chaux; mais qui ne vit plus dans le fleuve à l'époque actuelle.
Ces calcaires, d'âge probablement tertiaire supérieur, sont visibles
jusqu'à la hauteur de la rivière de Passikondé. Bientôt, en avant de
Boma, s'élève la roche Fétiche et le rocher du Monolithe, annonçant
le commencement d'une autre série de terrains : c'est la région des monts
de Cristal qui se présente. Cette partie montagneuse, qui s'étend jusqu'au
Stanley-Pool, peut se diviser géologiquement en plusieurs zones : la zone
des gneiss avec granit; la zone des micaschistes avec gneiss amphiboliques;
la zone métamorphique des quartzites et des phyllades; la zone des schistes
et calcaires; la zone des psammites et grès rouges à grains fins; enfin
la zone des arkoses et des conglomérats rouges. La zone des roches cristallines
se présente la première à l'observateur, sous forme de beaux granites
au milieu de gneiss dont les feuillets, généralement inclinés vers l'Ouest,
se renversent sur une suite variée de micaschistes, de quartzites et de
gneiss amphiboliques, jusqu'à M'Goma, soit à 15 km avant d'arriver Ã
Isanghila. Cet ensemble représente le terrain paléozoïque. Vient ensuite
la zone des terrains métamorphiques, consistant en quartzites et en phyllades
extraordinairement contournés et plissés formant d'abord un vaste pli
synclinal, à fond très ondulé. Cette zone comprend d'abord des bancs
épais de poudingue qui la séparent des schistes amphiboliques primitifs.
Ces poudingues passent à des phyllades, puis à un puissant massif de
quartzite. Un peu avant d'arriver à Isanghila, la série est interrompue
par une large intrusion de roche éruptive verdâtre, qui est de la diabase,
puis la même série, en couches très inclinées et contournées, de poudingue,
de phyllades et de quartzites reprend, pour passer insensiblement à des
schistes.
Un peu au-dessus d'Isanghila, au grand
coude du Congo, apparaissent subitement, intercalés entre les schistes
plissés, des plis aigus, fortement comprimés, de calcaire parfois rendu
schistoïde par la pression. Quelques fossiles permettent de considérer
cet horizon comme dévonien. Ces plis de calcaire se présentent huit fois
sur 50 Ã 60 kil. On y observe en plusieurs points de nouveaux dykes
de diabase. Enfin, avant Manyanga, le schiste gris verdâtre qui recouvre
le calcaire se trouve remplacé par du psammite rouge qui passe par alternances
au grès rouge; puis, en amont de Manyanga, à l'arkose rouge avec intercalations
de bancs de poudingue.
C'est cette série, commençant par les
psammites rouges supérieurs aux calcaires et finissant par les poudingues
rouges, qui constitue la dernière zone de la région montagneuse ou des
chutes. A partir de Kinshasa, les couches changent immédiatement. Quelques
grès cohérents se montrent à la base des nouveaux dépôts et sont surmontés
d'un grand amas de grès très tendre, d'une blancheur de craie qui forme
les Dover Cliffs au Nord du Stanley-Pool. Ces nouvelles roches se prolongent
loin vers l'intérieur et il y a lieu de croire qu'elles constituent le
sous-sol du Haut-Congo. Quant au sol du Haut Congo il se compose d'immenses
amas d'alluvions que les eaux de l'ancien lac central ont déposées en
s'accumulant avant de déborder sur les premiers contreforts de la chaîne
côtière. Ces alluvions sont fortement ocreuses par suite de la grande
quantité de fer qu'elles renferment et qui est due à une altération
chimique profonde des terres superficielles sous l'action des eaux abondantes
et chaudes de la saison des pluies. Elles atteignent une épaisseur de
10 à 20 m. Ce dépôt est récent ; c'est, avec le creusement des monts
de Cristal, le dernier événement géologique saillant qui se soit produit
dans cette partie de l'Afrique équatoriale.
Climat.
Dans la région du Congo inférieur, l'année
se partage en deux saisons bien distinctes : la saison sèche comprise
entre le milieu de mai et le mois d'octobre, et la saison chaude ou des
pluies qui commence fin octobre pour finir vers le 15 mai. Les pluies,
accompagnées presque toujours de phénomènes électriques, tombent dans
de courts intervalles. De mai à octobre, on observe fréquemment, entre
5 heures et 9 heures du matin, une légère bruine que les Portugais ont
appelée caçimbo. La grêle est inconnue sur le littoral, tandis
qu'elle a été observée au Stanley-Pool pendant des orages.
La température oscille entre 13° et 36°C;
elle s'élève au-dessus de cette moyenne pendant la saison des pluies
et l'humidité qu'il y a alors dans l'air rend souvent la chaleur accablante.
Pendant la saison sèche, au contraire, l'air constamment rafraîchi le
jour par la brise de mer et la nuit par la brise de terre, entretient l'atmosphère
dans une fraîcheur constante; la nuit il est parfois nécessaire de se
couvrir de plus d'une couverture pour ne pas grelotter de froid. Au fur
et à mesure que l'on remonte le fleuve, la division de l'année en deux
saisons est graduellement moins tranchée; sous l'équateur il pleut irrégulièrement
toute l'année. La moyenne de la température y est à peu près la même
qu'à l'embouchure du Congo. Dans les contrées montagneuses du Sud, cependant,
le thermomètre descend très bas. On a vu de la glace se former la nuit
sur le plateau des sources du Kassaï.
La durée du jour et de la nuit est Ã
peu près égale. Le crépuscule comme l'aurore se fait vers les 6 heures
pour ainsi dire brusquement. L'ensemble du régime anémométrique étant
ramené au Nord de l'équateur par suite de la prépondérance des terres
dans l'hémisphère septentrional, le bassin du Congo se trouve en entier
dans la zone des vents alizés du Sud-Est. Mais sur la côte occidentale
jusqu'en amont du confluent de l'Oubangi, les alizés, déviés de leur
marche, se transforment en moussons; ils deviennent vents du Sud-Ouest
et même soufflent franchement de l'occident; dans la partie méridionale
du bassin où les vallées sont régulièrement orientées en sillons parallèles
dans la direction du Sud au Nord, les vents suivent la même direction.
(GE). |
|