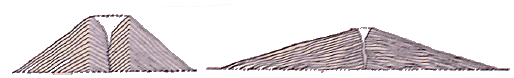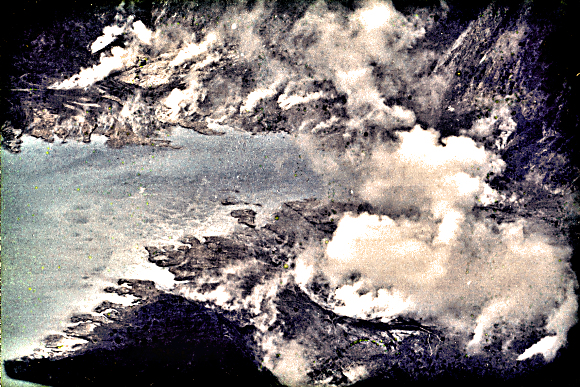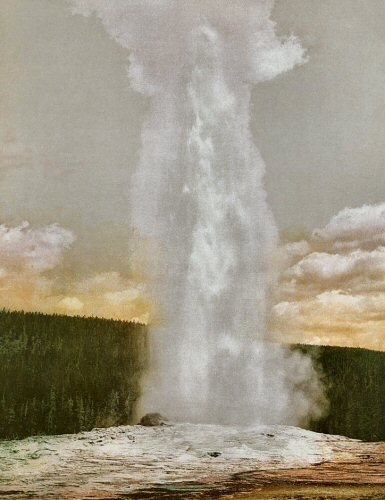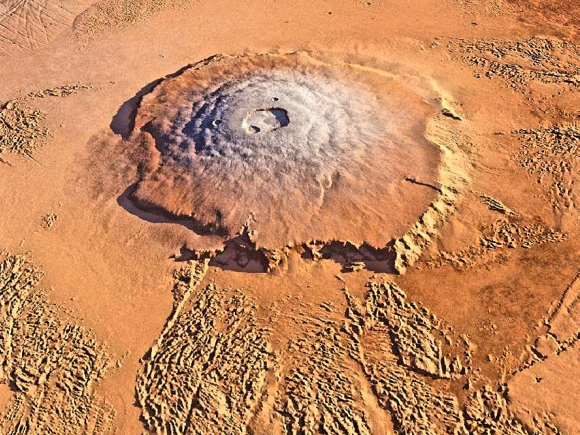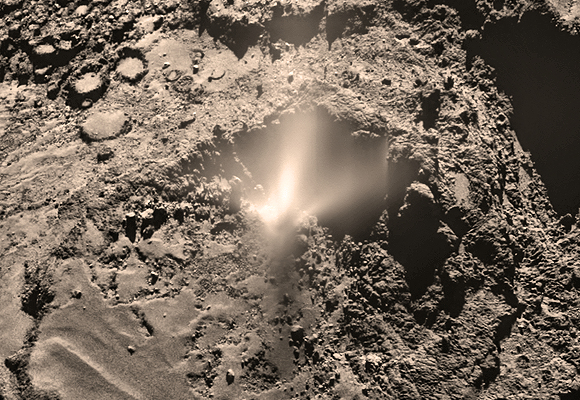|
La formation et distribution
géographique des volcans
Très souvent, la formation
et la distribution géographique des volcans est directement en relation
avec la structure tectonique de la
Terre et les
mouvements des plaques. entre lesquelles se
divise la
lithosphère et la partie supérieure
du manteau (asthénosphère)
de notre planète. Les volcans sont alors associés
aux fronti√®res entre les plaques tectoniques de la cro√Ľte terrestre et
se
situent tout le long la zone de contact entre deux plaques.
Il existe trois types de limites de plaques : divergentes, convergentes
et transformantes. Seuls les deux premiers types ont un r√īle dans
la formation des volcans.
 Les
limites transformantes correspondent aux limites entre deux plaques qui
glissent contre l'autre (zones de friction). De telles limites ne sont
généralement pas associées à une activité volcanique significative,
mais peuvent générer des séismes importants. Les
limites transformantes correspondent aux limites entre deux plaques qui
glissent contre l'autre (zones de friction). De telles limites ne sont
généralement pas associées à une activité volcanique significative,
mais peuvent générer des séismes importants.
Les volcans peuvent
aussi se former à l'intérieur même des plaques
tectoniques, au-dessus de panaches chauds montés depuis les profondeurs
du manteau et qui percent ces plaques pour former un point
chaud.
Le volcanisme
de divergence.
Dans les régions
o√Ļ les plaques tectoniques se s√©parent (dorsales oc√©aniques, rifts terrestres),
on observe un volcanisme qualifié de volcanisme de divergence.
Volcans
des dorsales océaniques.
Les dorsales
ou rides médio-océaniques se forment au fond des océans
et sont le principal moteur de l'expansion des fonds océaniques. Pouvant
s'élever jusqu'à plusieurs kilomètres au-dessus du fond marin, elles
s'étendent en longueur sur plusieurs milliers de kilomètres et sont larges
généralement de quelques kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres.
C'est dans ces zones que le magma (=
mélange de roches en fusion, de gaz dissous et de cristaux) remonte à
travers des fissures (rifts, en anglais) pour venir se solidifier
quand il atteint le plancher océanique et s'accumuler de part et d'autre
de la zone de rift, formant ainsi une nouvelle cro√Ľte oc√©anique. Au fil
du temps, les √©ruptions r√©p√©t√©es de magma cr√©ent une cha√ģne de volcans
sous-marins alignés le long de la dorsale. Ce volcanisme est continu le
long de la dorsale, avec des éruptions fréquentes, mais souvent de faible
intensité : la lave s'écoule lentement des fissures (volcanisme effusif).
Exemples de dorsales médio-océaniques :
 La
dorsale Est-Pacifique dans l'océan Pacifique,
longue de 10 000 km, s'élève à la séparation entre la plaque
Pacifique et, du Nord au Sud, les plaques Juan de Fuca, Nord-Américaine,
Cocos (et Rivera), Nazca et Antarctique. (La limite entre ces diverses
plaques peut aussi être transformante sur divers tronçons en divers point,
notamment en Californie, région non volcanique
mais de très haute sismicité). Cette dorsale est à l'origine d'une expansion
océanique relativement rapide. La
dorsale Est-Pacifique dans l'océan Pacifique,
longue de 10 000 km, s'élève à la séparation entre la plaque
Pacifique et, du Nord au Sud, les plaques Juan de Fuca, Nord-Américaine,
Cocos (et Rivera), Nazca et Antarctique. (La limite entre ces diverses
plaques peut aussi être transformante sur divers tronçons en divers point,
notamment en Californie, région non volcanique
mais de très haute sismicité). Cette dorsale est à l'origine d'une expansion
océanique relativement rapide.
 La
dorsale médio-atlantique dans l'océan
Atlantique marque, du Nord au Sud, la divergence entre la plaque Nord-américaine
et la plaque Eurasiatique, puis entre la plaque Nord-Américaine et la
plaque Africaine, et, enfin, entre la plaque Sud-Américaine et la plaque
Africaine. C'est une région à la fois très sismique et très volcanique.
Le plancher océanique sur lequel
elle s'érige est le plus souvent entre 3000 et 5000 m de profondeur et
ses volcans sont essentiellement sous-marins. Ceux-ci peuvent cependant
grandir suffisamment pour finir par émerger au-dessus du niveau des océans
et former alors des √ģles. C'est ce qui s'est pass√©,
par exemple, avec l'√ģle surtsey apparue au large de l'Islande
en 1963 à la suite d'une éruption sous-marine. L'Islande même est toute
entière le produit du volcanisme de la dorsale médio-atlantique. D'autres
√ģles et archipels ont la m√™me origine : Jan
Mayen, Açores, Fernando
de Noronha, Ascension, Sainte-Hélène,
Tristan
Da Cuhna, Bouvet, etc. La
dorsale médio-atlantique dans l'océan
Atlantique marque, du Nord au Sud, la divergence entre la plaque Nord-américaine
et la plaque Eurasiatique, puis entre la plaque Nord-Américaine et la
plaque Africaine, et, enfin, entre la plaque Sud-Américaine et la plaque
Africaine. C'est une région à la fois très sismique et très volcanique.
Le plancher océanique sur lequel
elle s'érige est le plus souvent entre 3000 et 5000 m de profondeur et
ses volcans sont essentiellement sous-marins. Ceux-ci peuvent cependant
grandir suffisamment pour finir par émerger au-dessus du niveau des océans
et former alors des √ģles. C'est ce qui s'est pass√©,
par exemple, avec l'√ģle surtsey apparue au large de l'Islande
en 1963 à la suite d'une éruption sous-marine. L'Islande même est toute
entière le produit du volcanisme de la dorsale médio-atlantique. D'autres
√ģles et archipels ont la m√™me origine : Jan
Mayen, Açores, Fernando
de Noronha, Ascension, Sainte-Hélène,
Tristan
Da Cuhna, Bouvet, etc.
Volcans
des rifts continentaux.
En Islande, ce n'est pas seulement une
portion de dorsale océanique qui émerge, c'est aussi la zone de rift
centrale qui est apparente, partageant oblique l'√ģle en son centre. Il
existe également des zones de rift proprement terrestres,
située à la divergence de deux plaques tectoniques. Et de la même façon,
les fractures causés par cet écartement forment des fossés d'effondrement
et des failles et donnent naissance à un volcanisme dit de rift. Comme
les volcans sous-marins, les volcans de rift terrestre se caractérisent
le plus souvent par des √©ruptions effusives, o√Ļ la lave
(souvent basaltique, c'est-à-dire qu'elle est riche en silice
et en fer) s'écoule relativement lentement à partir
de fissures le long du rift. Parmi les rifts continentaux, on peut mentionner
:
 Le
rift Baikal, situé en Sibérie orientale,
en Russie, associé au lac
Ba√Įkal. Il est le si√®ge d'une activit√© volcanique pass√©e et pr√©sente,
avec des volcans éteints et des sources thermales. Le
rift Baikal, situé en Sibérie orientale,
en Russie, associé au lac
Ba√Įkal. Il est le si√®ge d'une activit√© volcanique pass√©e et pr√©sente,
avec des volcans éteints et des sources thermales.
 Le
Grand Rift en Afrique de l'Est forme une vallée, longue de 6000 km,
du Malawi à l'Erythrée
en passant par la région des Grands Lacs. Il est prolongé, au Nord, par
une ligne de faille qui s'étend jusqu'en Turquie,
via la mer Rouge (rift océanique), la mer
Morte et les vallées du Jourdain
(Isra√ęl, Palestine,
Jordanie)
et de la Bekaa (Liban). Certaines parties du Grand
Rift connaissent de nos jours une activité volcanique intense. Le
Grand Rift en Afrique de l'Est forme une vallée, longue de 6000 km,
du Malawi à l'Erythrée
en passant par la région des Grands Lacs. Il est prolongé, au Nord, par
une ligne de faille qui s'étend jusqu'en Turquie,
via la mer Rouge (rift océanique), la mer
Morte et les vallées du Jourdain
(Isra√ęl, Palestine,
Jordanie)
et de la Bekaa (Liban). Certaines parties du Grand
Rift connaissent de nos jours une activité volcanique intense.
On peut enore donner
ici mentionner l'exemple d'un volcanisme de divergence ancien, lié à
l'ouverture de la mer Baltique,et dont on
retrouve aujourd'hui les traces dans le massif de l'Eifel, en Allemagne.
Le volcanisme
de collision.
Les r√©gions o√Ļ
deux plaques tectoniques convergent l'une vers l'autre est propice à la
surrection de cha√ģnes montagneuses et √† la formation de volcans.
+ Cela se
produit la plupart du temps quand une plaque océanique entre en collision
avec une plaque continentale (ou, parfois avec une autre plaque océanique
plus épaisse et moins dense) pour former une zone de subduction.
+ Il peut aussi arriver
que la rencontre de deux plaques tectoniques (continentales) donne seulement
lieu à une zone de compression.
Le premier cas donne
naissance à un volcanisme de subduction, le second à un volcanisme
de compression.
Le
volcanisme de subduction. Les arcs volcaniques.
Lorsque deux plaques
tectoniques se rencontrent, la plaque la plus dense et la moins épaisse
peut plonger sous l'autre plaque. Cette dernière est soulevée sur sa
bordure, ce qui donne lieu √† la surrection de cha√ģnes montagneuses (sous-marines
ou subaériennes), mais aussi à l'apparition de fractures, qui sont autant
d'issues pour la montée de magma issu de la fusion partielle de la plaque
subduite. Le magma produit par la subduction
est moins dense que la roche environnante et a tendance à s'élever vers
la surface. Il trouve alors un chemin de moindre résistance à travers
les fractures de la cro√Ľte terrestre et forme une cha√ģne de volcans parall√®le
à la zone de subduction et que l'on appelle un arc volcanique.
Selon leur lieu d'apparition, on distingue ordinairement :
+ les
arcs volcaniques insulaires. - Dans ces arcs, les volcans forment un
chapelet d'√ģles, et correspondent g√©n√©ralement √† des zones de subduction
entre deux plaques oc√©aniques, comme dans le cas des volcans des Cara√Įbes.
+ les
arc volcaniques continentaux. - Ces arcs formés de volcans sont
purement terrestres. Ils, se constituent lorsqu'une plaque océanique plonge
sous une plaque continentale, comme dans les cas, par exemple, des volcans
de la Cordillère des Andes ou du Japon.
Certains arcs volcaniques
peuvent aussi avoir un caractère mixte, à l'exemple de celui formé par
les volcans des √ģles de la Sonde ( Indon√©sie),
par exemple. La Ceinture de Feu du Pacifique, qui est le plus vaste système
d'arcs volcaniques de notre planète, possède aussi ce caractère
mixte.
 L'Arc
Cara√ģbe. - Cette zone, √† l'Est des Antilles (Petites Antilles), est
compos√©e d'√ģles volcaniques n√©es d'un processus qui se poursuit depuis
5 millions d'ann√©es. Le volcanisme y est principalement d√Ľ √† la subduction
de la plaque oc√©anique de l'Atlantique sous la plaque cara√Įbe. Les volcans
de cet arc sont généralement de type explosif. Citons, parmi les volcans
de l'arc Cara√Įbe : la Montagne Pel√©e (Martinique),
la Soufrière (Guadeloupe), Le Morne
Diablotins (Dominique), les Soufrière Hills
(Montserrat), la Soufrière Saint Vincent
(Saint Vincent et Grenadines),
le Qualibou (Sainte-Lucie), ou encore le
mont Kick-'em-Jenny, qui est un volcan sous-marin situé au Nord de la
Grenade.
Notons que,parallèlement à cet arc, un arc plus ancien, formé par une
activité volcanique vieille de y a 55 million d'années, est constitué
d'anciens édifices volcaniques très érodés sont aujourd'hui surmontés
de récifs coralliens (La Barbade, Grande Terre,
Saint-Martin,
Antigua). L'Arc
Cara√ģbe. - Cette zone, √† l'Est des Antilles (Petites Antilles), est
compos√©e d'√ģles volcaniques n√©es d'un processus qui se poursuit depuis
5 millions d'ann√©es. Le volcanisme y est principalement d√Ľ √† la subduction
de la plaque oc√©anique de l'Atlantique sous la plaque cara√Įbe. Les volcans
de cet arc sont généralement de type explosif. Citons, parmi les volcans
de l'arc Cara√Įbe : la Montagne Pel√©e (Martinique),
la Soufrière (Guadeloupe), Le Morne
Diablotins (Dominique), les Soufrière Hills
(Montserrat), la Soufrière Saint Vincent
(Saint Vincent et Grenadines),
le Qualibou (Sainte-Lucie), ou encore le
mont Kick-'em-Jenny, qui est un volcan sous-marin situé au Nord de la
Grenade.
Notons que,parallèlement à cet arc, un arc plus ancien, formé par une
activité volcanique vieille de y a 55 million d'années, est constitué
d'anciens édifices volcaniques très érodés sont aujourd'hui surmontés
de récifs coralliens (La Barbade, Grande Terre,
Saint-Martin,
Antigua).
 La
Ceinture de feu du Pacifique (ou ceinture Péripacifique) est un ensemble
de volcans subaériens et sous-marins, qui entoure la plaque de l'océan
Pacifique et de quelques plaques secondaires (Nazca, Cocos, Mariannes,
Philippines) situées à sa périphérie. C'est la zone volcanique la plus
active du monde. Elle s'étend sur environ 40 000 kilomètres, et se compose
de nombreux segments, certains insulaires, d'autres continentaux ou mixtes.
On peut la faire commencer en Nouvelle-Zélande,
(Ruapehu, Taupo, Tarawera), se poursuivre aux Philippines (mont Pinatubo,
Taal, Paco) au Japon (mont Fuji, Unzen),
aux Kouriles (Tiatia, Alaid), au Kamtchatka
(Kliuchevskoi, Kronotsky, Aváchinski), puis parvenir en Amérique,
des
√ģles Al√©outiennes (Bogoslov, Gareloi)
et de l'Alaska (Iliamna, Spurr, Pavlov) à la
Cordillère des Andes (Cotopaxi, Chimborazo, Aconcagugua), en passant par
la cha√ģne des Cascades, √† l'Ouest des Etats-Unis
(mont Sainte-Hélène, mont Rainier, mont Shasta). Des extensions tels
que l'arc des √ģles de la Sonde (Krakatoa, M√©rapi, Agung), ou l'arc trans-mexicain
(Popocatépetl, Pico de Orizaba, Colima, Chichonal), peuvent y être rattachés. La
Ceinture de feu du Pacifique (ou ceinture Péripacifique) est un ensemble
de volcans subaériens et sous-marins, qui entoure la plaque de l'océan
Pacifique et de quelques plaques secondaires (Nazca, Cocos, Mariannes,
Philippines) situées à sa périphérie. C'est la zone volcanique la plus
active du monde. Elle s'étend sur environ 40 000 kilomètres, et se compose
de nombreux segments, certains insulaires, d'autres continentaux ou mixtes.
On peut la faire commencer en Nouvelle-Zélande,
(Ruapehu, Taupo, Tarawera), se poursuivre aux Philippines (mont Pinatubo,
Taal, Paco) au Japon (mont Fuji, Unzen),
aux Kouriles (Tiatia, Alaid), au Kamtchatka
(Kliuchevskoi, Kronotsky, Aváchinski), puis parvenir en Amérique,
des
√ģles Al√©outiennes (Bogoslov, Gareloi)
et de l'Alaska (Iliamna, Spurr, Pavlov) à la
Cordillère des Andes (Cotopaxi, Chimborazo, Aconcagugua), en passant par
la cha√ģne des Cascades, √† l'Ouest des Etats-Unis
(mont Sainte-Hélène, mont Rainier, mont Shasta). Des extensions tels
que l'arc des √ģles de la Sonde (Krakatoa, M√©rapi, Agung), ou l'arc trans-mexicain
(Popocatépetl, Pico de Orizaba, Colima, Chichonal), peuvent y être rattachés.
Le
volcanisme de compression.
Dans les zones de compression, c'est-à-dire
l√† o√Ļ deux plaques continentales convergent et entrent en collision,
l'activité tectonique est principalement responsable de la formation de
montagnes
et de la déformation et la fissuration des roches. Les séismes sont fréquents
dans ces régions, mais le volcanisme y est moins répandu que dans les
zones de subduction, car la cro√Ľte continentale est moins sujette √† la
fusion que la cro√Ľte oc√©anique, ce qui limite la quantit√© de magma g√©n√©r√©.
Lorsqu'un volcanisme de compression est présent il se produit généralement
sous forme de volcans de type explosif, à l'image des stratovolcans
qui se forment à la suite de l'accumulation de magma visqueux.
Les volcans actifs de compression sont
aujourd'hui tr√®s rares. Mais l'on conna√ģt un volcanisme de compression
ancien, lié en particulier à l'orogénèse alpino-himalayenne causée
par la fermeture de l'océan Thétys (depuis
le d√©but du C√©nozo√Įque) ou, plus anciennement
encore, à l'orogénèse hercynienne (varisque) née de la rencontre de
la Laurussia et du Protogondwana
(Pal√©ozo√Įque).
 Situé
dans une r√©gion √† la g√©ologie complexe, o√Ļ convergent les plaques
Eurasiatique et Arabique, le mont Ararat, qui est un stratovolcan,
fournit sans doute le meilleur exemple de volcan de compression, sinon
actuellement actif, du moins dormant et présentant toujours des signes
d'activité géothermique (sources chaudes et émissions de gaz volcaniques). Situé
dans une r√©gion √† la g√©ologie complexe, o√Ļ convergent les plaques
Eurasiatique et Arabique, le mont Ararat, qui est un stratovolcan,
fournit sans doute le meilleur exemple de volcan de compression, sinon
actuellement actif, du moins dormant et présentant toujours des signes
d'activité géothermique (sources chaudes et émissions de gaz volcaniques).
 L'orogénèse
alpino-himalayenne a produit des exemples de volcanisme intracontinental
plus nombreux, au point qu'on ait pu ici parler d'une ceinture de feu (la
ceinture de feu téthysienne), associée à la surrection de tout un ensemble
de cha√ģne montagneuses en Eurasie (des Alpes
à l'Himalaya, en passant par les monts Zagros).
Les Alpes, nées de la collision de la plaque Eurasiatique et de la plaque
Africaine, présentent des indices d'un volcanisme ancien assez discrets.
Mais il n'en est pas de même des monts Zagros, qui résultent de la collision
entre la plaque Arabique et la plaque Eurasiatique, et présentent une
activité volcanique très manifeste, avec des volcans éteints, des émissions
de gaz, et de nombreux d√©p√īts de roches volcaniques et autres coul√©es
de lave. Même chose pour l'Himalaya dont la surrection provient de la
collision de la plaque Eurasiatique et de la plaque Indienne et qui présente
en divers points des volcans éteints et d'anciens volcans de boue. L'orogénèse
alpino-himalayenne a produit des exemples de volcanisme intracontinental
plus nombreux, au point qu'on ait pu ici parler d'une ceinture de feu (la
ceinture de feu téthysienne), associée à la surrection de tout un ensemble
de cha√ģne montagneuses en Eurasie (des Alpes
à l'Himalaya, en passant par les monts Zagros).
Les Alpes, nées de la collision de la plaque Eurasiatique et de la plaque
Africaine, présentent des indices d'un volcanisme ancien assez discrets.
Mais il n'en est pas de même des monts Zagros, qui résultent de la collision
entre la plaque Arabique et la plaque Eurasiatique, et présentent une
activité volcanique très manifeste, avec des volcans éteints, des émissions
de gaz, et de nombreux d√©p√īts de roches volcaniques et autres coul√©es
de lave. Même chose pour l'Himalaya dont la surrection provient de la
collision de la plaque Eurasiatique et de la plaque Indienne et qui présente
en divers points des volcans éteints et d'anciens volcans de boue.
 L'orogénèse
hercynienne ou varisque, à laquelle se rattache également, en Amérique
du Nord, la surrection des Appalaches,
a produit le très ancien volcanisme dont on observe aujourd'hui encore
la marque, par exemple, dans l'Oural (présence
de basaltes, d'andésites,
de dacites et de rhyolites),
ou dans l'Alta√Į, cha√ģne aux formations volcaniques
variées (volcans boucliers, stratovolcans, caldeiras, avec aussi des régions
pr√©sentant des coul√©es de lave, des d√©p√īts de cendres volcaniques et
des d√īmes de lave), et dont le plus haut sommet, le mont Beloukha, est
lui-même un ancien volcan. En Europe, on trouve
des traces d'activité volcanique remontant au même processus dans l'ouest
de la République tchèque, dans la Forêt-Noire
en Allemagne, ou encore France, dans le massif
Armoricain, qui porte les marques d'un ancien volcanisme effusif et,
dans le massif Central, dont les volcans
sont aussi associables à l'orogénèse alpine. L'orogénèse
hercynienne ou varisque, à laquelle se rattache également, en Amérique
du Nord, la surrection des Appalaches,
a produit le très ancien volcanisme dont on observe aujourd'hui encore
la marque, par exemple, dans l'Oural (présence
de basaltes, d'andésites,
de dacites et de rhyolites),
ou dans l'Alta√Į, cha√ģne aux formations volcaniques
variées (volcans boucliers, stratovolcans, caldeiras, avec aussi des régions
pr√©sentant des coul√©es de lave, des d√©p√īts de cendres volcaniques et
des d√īmes de lave), et dont le plus haut sommet, le mont Beloukha, est
lui-même un ancien volcan. En Europe, on trouve
des traces d'activité volcanique remontant au même processus dans l'ouest
de la République tchèque, dans la Forêt-Noire
en Allemagne, ou encore France, dans le massif
Armoricain, qui porte les marques d'un ancien volcanisme effusif et,
dans le massif Central, dont les volcans
sont aussi associables à l'orogénèse alpine.
Les points chauds.
Le
volcanisme de point chaud.
La dernière catégorie de volcanisme
rassemble des volcans apparemment isol√©s. Ceux-ci peuvent appara√ģtre
à peu près partout à la surface de la Terre,
y compris au milieu de plaques tectoniques, loin des limites de ces plaques.
On doit invoquer pour les expliquer l'existence de grands panaches chauds,
certains nés à la base même du manteau,
ancrés peut-être dans le noyau terrestre, qui traversent verticalement
le manteau, et remontent jusqu'à la surface en perçant la lithosphère,
un peu comme le ferait un chalumeau géant. Lorsqu'un
tel panache chaud parvient √† perforer ainsi la cro√Ľte terrestre, il permet
au magma d'atteindre la surface. Un volcan peut alors se former; on peut
aussi assister à un écoulement de lave sur de grandes étendues (trapp).
Un seul de ces panaches mantelliques, actif
sur de longues périodes géologiques, peut transpercer la lithosphère
en des endroits différents, en fonction des déplacements des plaques
tectoniques entre deux périodes de grande activité. Un unique point chaud
peut ainsi produire une série de volcans alignés, dont le plus ancien
est généralement le plus éloigné du point chaud, tandis que le plus
jeune est situé directement au-dessus de celui-ci.
 Parmi
les volcans de point chaud, on peut mentionner, les volcans de Hawaii
(Mauna-Kea, Mauna-Loa, etc.), des Galapagos et de l'√ģle
de P√Ęques (qui a aussi √©t√© responsable de la formation de l'archipel
des Tuamotu) dans l'océan Pacifique, les volcans
de la Réunion (Piton de la Fournaise,
Piton des neiges) et des Comores (mont
Karthala) dans l'océan Indien, ceux
des Canaries et des Açores, dans l'océan Atlantique, ou
ceux du Cameroun, dans le golfe de Guinée,
de la région de
Yellowstone en Amérique du Nord, etc. Parmi
les volcans de point chaud, on peut mentionner, les volcans de Hawaii
(Mauna-Kea, Mauna-Loa, etc.), des Galapagos et de l'√ģle
de P√Ęques (qui a aussi √©t√© responsable de la formation de l'archipel
des Tuamotu) dans l'océan Pacifique, les volcans
de la Réunion (Piton de la Fournaise,
Piton des neiges) et des Comores (mont
Karthala) dans l'océan Indien, ceux
des Canaries et des Açores, dans l'océan Atlantique, ou
ceux du Cameroun, dans le golfe de Guinée,
de la région de
Yellowstone en Amérique du Nord, etc.
Il existe quelques régions
o√Ļ se rencontrent √† la fois un volcanisme de dorsale oc√©anique et un
volcanisme de point chaud qui b√©n√©ficie de la minceur de la cro√Ľte dans
les voisinage des dorsales.
 L'exemple
peut-être le plus marquant est celui de l'Islande : des volcans tels que
le mont Hekla, le Krafla ou le Snæfellsjökull, y
relèvent du volcanisme de point chaud, alors que le Katla, l'Askja, le
Grimsvötn, ou encore l'Eyjafjallajökull, y sont-ils issus de volcanisme
de dorsale. Certains volcans peuvent même montrer des caractéristiques
des deux types de volcanisme. Parmi les autres √ģles volcaniques de la
dorsale médio-atlantique asociés en même temps à point chaud, on peut
mentionner : les Açores, l'Ascension, Tristan da Cunha
et Bouvet. L'exemple
peut-être le plus marquant est celui de l'Islande : des volcans tels que
le mont Hekla, le Krafla ou le Snæfellsjökull, y
relèvent du volcanisme de point chaud, alors que le Katla, l'Askja, le
Grimsvötn, ou encore l'Eyjafjallajökull, y sont-ils issus de volcanisme
de dorsale. Certains volcans peuvent même montrer des caractéristiques
des deux types de volcanisme. Parmi les autres √ģles volcaniques de la
dorsale médio-atlantique asociés en même temps à point chaud, on peut
mentionner : les Açores, l'Ascension, Tristan da Cunha
et Bouvet.
La structure des
volcans
Les volcans sont des
structures géologiques par lesquelles de la matière à très haute température
(le magma) est achemin√©e jusqu'√† la surface de la Terre, o√Ļ elle
se dépose sous diverses formes (matériaux
pyroclastiques) ou se répand sans l'atmosphère (gaz). Le magma est
comme la matière première dont se nourrissent tous les volcans. Avant
sa montée en surface, il s'accumule dans de vastes réservoirs souterrains,
appelés
chambres magmatiques. Il monte ensuite le long d'un conduit
à partir duquel une partie de la matière est projetée dans l'atmosphère
et une autre s'écoule sous forme de lave. Au fil des éruptions, l'accumulation
de cette lave produit en se refroidissant une masse de matière qui forme
un c√īne volcanique (ce que l'on appelle ordinairement un volcan).
La partie du conduit à l'intérieur du volcan est appelée la cheminée,
et son débouché, plus large, prend le nom de cratère.
Un schéma général qui peut être sujet à de nombreuses variations.
 Par
exemple, plusieurs conduits peuvent partir d'une même chambre magmatique,
certains aboutissant en surface pour permettre l'émission de magma et
de gaz volcaniques à d'autres points du volcan ou même pour former un
autre volcan. Ces conduits secondaires peuvent être le résultat de fractures
ou de cheminées secondaires qui se forment pendant l'éruption. Certains
conduits peuvent également n'aboutir nulle part ou venir alimenter des
fissures par lequelles le magma peut parvenir en surface (éruptions
fissurales) sans √©riger de c√īne volcanique. Par
exemple, plusieurs conduits peuvent partir d'une même chambre magmatique,
certains aboutissant en surface pour permettre l'émission de magma et
de gaz volcaniques à d'autres points du volcan ou même pour former un
autre volcan. Ces conduits secondaires peuvent être le résultat de fractures
ou de cheminées secondaires qui se forment pendant l'éruption. Certains
conduits peuvent également n'aboutir nulle part ou venir alimenter des
fissures par lequelles le magma peut parvenir en surface (éruptions
fissurales) sans √©riger de c√īne volcanique.
Le magma.
Le magma est un
mélange de roches en fusion, de gaz dissous et de cristaux. Il est principalement
composé de silicates (silicate de magnésium,
de fer, d'aluminium,
de calcium, de sodium
et de potassium) combinés avec d'autres éléments
chimiques (oxygène, hydrogène
et soufre). Le magma contient également des gaz
dissous, principalement de la vapeur d'eau, du dioxyde
de carbone et du dioxyde de soufre.
La viscosité du
magma varie en fonction de sa composition chimique et de sa teneur en gaz
dissous. Les magmas riches en silice ont tendance à être plus visqueux,
tandis que les magmas plus pauvres sont plus fluides.
‚ÄĘ Le
magma basaltique est riche en fer, en magnésium et en silice. Il a
généralement une basse viscosité, ce qui facilite son écoulement lors
des éruptions.
‚ÄĘ Le magma and√©sitique
a une composition intermédiaire entre le basaltique et le rhyolitique.
Il contient des quantités modérées de silice, fer et magnésium.
‚ÄĘ Le magma rhyolitique
est riche en silice, ce qui lui confère une viscosité élevée et une
texture plus p√Ęteuse. Il contient √©galement des quantit√©s relativement
faibles de fer et de magnésium.
‚ÄĘ Le magma
dacitique a une composition intermédiaire entre l'andésite et le
rhyolite en termes de teneur en silice, fer et magnésium.
‚ÄĘ Le magma trachytique
est similaire au rhyolitique, mais avec une teneur en potassium plus élevée.
Il est généralement riche en feldspath potassique.
‚ÄĘ Le magma picrobasaltique
est un type de basalte très riche en fer et en magnésium. Il est souvent
associé aux points chauds du manteau terrestre.
‚ÄĘ Le magma phonolitique
est un type de magma felsique (= silicaté), qui se situe sur le
c√īt√© le plus siliceux et le plus alcalin du spectre des compositions
magmatiques. Il est riche en feldspath alcalin (souvent du feldspath potassique
appelé sanidine), et en d'autres minéraux tels que la néphéline
et le feldspath sodique appelé albite.
Il a une viscosité relativement élevée et une température de fusion
relativement basse. Les volcans associ√©s √† ce magma sont plut√īt rares
(citons toutefois le mont Erebus en Antarctique
et le mont Katmai en Alaska).
Le magma se forme généralement
par un processus de fusion partielle des roches préexistantes dans la
partie sup√©rieure du manteau ou dans la cro√Ľte terrestre. La temp√©rature
du magma est de l'ordre de 700¬įC √† 1300¬įC. Cela lui permet de rester
à l'état liquide malgré les pressions très élevées auxquelles il
est soumis.
Moins dense que les
roches environnantes, le magma remonte à la surface terrestre lorsqu'il
trouve une voie d'échappement. Lorsque la pression diminue à mesure que
le magma s'élève, les composés volatils qu'il contient se vaporisent
(processus dégazage des roches) et peuvent former des bulles. La
libération soudaine de ces gaz pendant une éruption volcanique peut conduire
à des explosions et à la projection brutale de matériaux volcaniques.
Lorsque le magma
atteint la surface terrestre lors d'une éruption volcanique, son refroidissement
est rapide. Il se solidifie produisant divers matériaux rocheux : laves,
cendres, pyroclastes.
La
chambre magmatique.
Une chambre magmatique
est un réservoir souterrain qui contient du magma en fusion, ainsi que
des gaz dissous. Les chambres magmatiques se trouvent généralement
en dessous des volcans actifs. Elles peuvent être situées à différentes
profondeurs, allant de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres
sous la surface. Leurs dimensions et leur forme peuvent également
varier considérablement, allant de quelques kilomètres cubes à des centaines
de kilomètres cubes. Elles sont alimentées par des processus de fusion
partielle du manteau et/ou de la cro√Ľte terrestre. Le magma est g√©n√©r√©
dans des zones de fusion et remonte ensuite vers la chambre magmatique
en raison de sa densité inférieure à celle des roches environnantes.
Les chambres magmatiques sont soumises à des pressions élevées en raison
de l'accumulation de magma. À mesure que le magma se refroidit et se solidifie
dans la chambre magmatique, des minéraux cristallins se forment. Ce processus
de cristallisation peut créer des roches magmatiques intrusives (granit,
gabbro,
diorite,
etc.), qui se trouvent dans la
cro√Ľte terrestre.
Lors d'une éruption volcanique, la pression du magma dans la chambre magmatique
peut augmenter de manière significative, provoquant l'ouverture du conduit
et l'éjection du magma à la surface. La taille de la chambre magmatique
et la quantité de magma disponible peuvent influencer l'intensité et
la durée de l'éruption.
Les
conduits éruptifs.
On nomme conduit
le passage étroit par lequel le magma et les gaz volcaniques s'extraient
de la chambre magmatique. Un conduit éruptif bénéficie généralement
de l'existence de fractures, de fissures ou de conduits volcaniques
pr√©existants dans la cro√Ľte terrestre. Ses parois sont constitu√©es de
roches volcaniques plus résistantes (basaltes solidifiés ou tufs
volcaniques consolidés). Les conduits éruptifs mènent à la bouche
du volcan, qui est l'ouverture à la surface de la Terre par laquelle le
magma, les gaz, les cendres et autres matériaux volcaniques sont éjectés
lors d'une éruption. Cette bouche est le plus souvent (mais pas nécessairement)
marquée par la présence d'un cratère. Quand ce n'est pas le cas, on
parle ordinairement d'évent volcanique.
Les
cheminées.
La partie verticale
du conduit qui s'élargit près de la surface, juste en dessous du cratère
du volcan prend le nom de cheminée. C'est par la cheminée que le magma
remonte vers le sommet du volcan lors d'une éruption. Elle peut être
visible sous la forme d'une ouverture circulaire au sommet du c√īne volcanique.
Elle peut aussi √™tre partiellement obstru√©e par des d√©p√īts de mat√©riaux
volcaniques solides.
Le c√īne volcanique.
Les c√īnes volcaniques r√©sultent de l'accumulation
des éjectas solides ou liquides solidifiés rejetées à la surface par
un volcan. Lorsqu'il est entièrement formé par les laves
successivement √©mises, le c√īne est √† base tr√®s large et √† pente douce.
Quand il s'est édifié avec des matériaux meubles, scories, lapilli,
cendres,
ses pentes plus raides sont voisines de celle des talus de chute (c√īnes
de d√©bris). Les c√īnes de laves portent g√©n√©ralement un ou plusieurs
petits c√īnes de d√©bris r√©sultant des derni√®res √©ruptions; les c√īnes
√† crat√®res qui s'ajoutent ainsi au c√īne principal sont dits c√īnes adventifs.
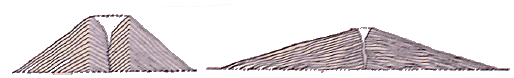
C√īne
de d√©bris (√† gauche) et c√īne de laves.
Les
cratères.
Le cratère commence à l'évasement de
la chemin√©e; il est limit√© par les bords du c√īne. Le crat√®re s'ouvre
souvent au sommet du volcan; mais il arrive aussi qu'il occupe le flanc
de la montagne. Les dimensions en sont parfois
considérables. L'ancien cratère du Vésuve,
dont les ruines sont actuellement représentées par la Somma, mesurait
4000 mètres de diamètre; il est aujourd'hui à peu près comblé par
les laves. Certains cratères des volcans d'Indonésie
mesurent 6000 mètres de diamètre.
-

| Le
cratère du Vésuve. - Ce volcan, situé dans le golfe de Naples
en Italie, est l'un des plus actifs d'Europe.
Son sommet est formé d'un large cratère entouré d'une couronne de montagnes
et de falaises. L'éruption la plus célèbre du Vésuve est celle de l'an
79 ap. J.-C., qui a dévasté les villes de Pompéi, Herculanum et Stabies,
ensevelissant leurs habitants et leurs b√Ętiments sous des cendres et des
débris volcaniques. Depuis, le Vésuve a connu de nombreuses autres
éruptions majeures, notamment en 1631, 1794, 1906 et plus récemment en
1944. La région du Vésuve est densément peuplée, ce qui en fait
l'un des volcans les plus dangereux du monde en termes de risques pour
les populations. |
Les
types de volcans
Les volcans boucliers.
Un volcan bouclier
est un type de volcan qui se caractérise par des pentes douces et une
structure étendue. Ces volcans, couramment associés à des zones volcaniques
très actives, comme les points chauds ou les zones de divergence des plaques
tectoniques, sont généralement formés par des éruptions volcaniques
de lave basaltique fluide, qui s'écoule sur de longues distances avant
de se solidifier. Ils peuvent avoir un cratère central, souvent de petite
taille, à partir duquel la lave est émise. Cependant, en raison de la
nature fluide de la lave, les éruptions peuvent également se produire
le long de fissures latérales. Les éruptions de ces volcans sont
souvent caractérisées par une activité éruptive régulière et prolongée,
avec des coulées de lave continues.
.-
| Le
Mauna Loa est l'un des volcans boucliers les plus grands du monde.
Il est situé sur la Grande Île d'Hawaii et s'élève
à une hauteur de 4169 mètres depuis sa base sous-marine jusqu'à son
sommet. La majeure partie de sa masse se trouve sous la surface de l'océan.
C'est est l'un des volcans les plus actifs de la planète et a connu de
nombreuses éruptions au cours de l'histoire récente.
Le Kilauea
est un autre volcan bouclier majeur situé sur la Grande Île d'Hawaii.
Très actif, il est réputé pour ses éruptions effusives de lave basaltique.
Au cours de sa longue histoire, ce volcan a produit de vastes étendues
de coulées de lave et des fontaines de lave spectaculaires.
Volcans des √ģles
Gal√°pagos. - L'archipel des Gal√°pagos,
situ√© dans l'oc√©an Pacifique √† environ 1 000 km des c√ītes de l'√Čquateur,
abrite plusieurs volcans boucliers. Parmi eux, le volcan Wolf et le volcan
Sierra Negra sont les plus notables. Ces volcans présentent une activité
volcanique régulière et offrent un paysage volcanique unique, ainsi que
des habitats uniques pour la faune et la flore de l'archipel. |
Le
Piton de la Fournaise est un volcan bouclier situ√© sur l'√ģle de La
Réunion, dans l'océan Indien. Il est connu pour ses éruptions
fréquentes et souvent spectaculaires. Il est accessible aux visiteurs
et offre des opportunités d'observation des éruptions en toute sécurité.
Situé en Sicile,
l'Etna est le plus grand volcan actif d'Europe. Il compte lui aussi
parmi les volcans les plus actifs au monde. Ses éruptions produisent des
coulées de lave impressionnantes. Il est classé au patrimoine mondial
de l'Unesco et constitue une attraction touristique majeure.
Le Vulcano
se situe sur l'√ģle √©ponyme dans l'archipel des √ģles √Čoliennes, au large
de la c√īte nord de la Sicile. Il est caract√©ris√© par ses fumerolles
soufrées et ses sources chaudes.
L'Islande possède
plusieurs volcans boucliers. Parmi eux, on peut citer le B√°r√įarbunga,
le Grímsvötn et l'Hekla. Ces volcans ont connu des éruptions
notables au cours des dernières décennies. |
Les stratovolcans.
Les stratovolcans,
ou volcans compos√©s, sont des volcans en forme de c√īne raide et
symétrique, construits par des éruptions alternant entre des coulées
de lave visqueuse et des éruptions explosives. Ces éruptions peuvent
produire des colonnes de cendres, des nuées
ardentes, des lahars ( = coulées de
boue volcanique) et des coulées pyroclastiques qui descendent rapidement
le long des pentes du volcan. Les stratovolcans sont principalement composés
de lave andésitique, une lave visqueuse et tend à s'accumuler autour
de la chemin√©e volcanique plut√īt que de s'√©couler loin du volcan. Les
stratovolcans sont généralement parmi les plus grands volcans de la Terre.
Ils peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres de hauteur et s'étendre
sur des dizaines de kilomètres à la base.
-
Le
mont Vésuve
est un stratovolcan situé près de la ville de Naples ,
en Italie. Il est célèbre pour son éruption dévastatrice en l'an 79,
qui a enseveli les villes romaines de Pompéi ,
en Italie. Il est célèbre pour son éruption dévastatrice en l'an 79,
qui a enseveli les villes romaines de Pompéi et Herculanum
et Herculanum sous les cendres. Toujours considéré comme un volcan actif, il est surveillé
de près en raison de sa proximité avec une population dense.
sous les cendres. Toujours considéré comme un volcan actif, il est surveillé
de près en raison de sa proximité avec une population dense.
Situ√©e sur l'√ģle
de Stromboli, en Sicile, le Stromboli est un autre stratovolcan.
Sa particularité réside dans son activité quasi-permanente de fontaines
de lave et d'éruptions explosives. Il est surnommé "le phare de la Méditerranée"
en raison de ses éruptions régulières qui éclairent la nuit.
Situ√© sur l'√ģle
de Honshu au Japon, le mont Fuji est l'un
des symboles les plus emblématiques du pays. Il s'agit d'un stratovolcan
actif qui culmine à une altitude de 3776 mètres. Il a une forme conique
parfaite.
Le volcan de Fuego,
au Guatemala, est connu pour ses éruptions
explosives fréquentes produisant des coulées pyroclastiques, des nuées
ardentes et des explosions de cendres. Situé près d'Antigua Guatemala,
ce stratovolcan est l'un des volcans les plus actifs d'Amérique
centrale. |
Volcans
Colima et Popocatépetl. - Ces deux stratovolcans se trouvent au Mexique
et sont considérés comme parmi les volcans les plus actifs du pays. Le
volcan Colima présente une activité régulière avec des éruptions explosives.
Le Popocatépetl, situé à proximité de Mexico ,
a également une histoire éruptive importante. ,
a également une histoire éruptive importante.
Situ√© dans l'√Čtat
de Washington, aux √Čtats-Unis, le mont St. Helens est c√©l√®bre
pour son éruption dévastatrice en 1980. Avant l'éruption, le mont St.
Helens avait une altitude de 2 550 mètres. L'éruption a causé l'effondrement
d'une partie du sommet du volcan, laissant une caldeira
en forme de fer à cheval.
Le mont Rainier
est un stratovolcan actif qui fait partie de la cha√ģne des Cascades. Avec
une altitude de 4392 m√®tres, il est le point culminant de l'√Čtat de Washington
et l'un des volcans les plus imposants des √Čtats-Unis. Il est couvert
de glaciers et représente une importante attraction
touristique.
Le Mérapi
(= Montagne de Feu, en langue javanaise )
est situé dans le centre de Java, en Indonésie.
Il s'agit de l'un des volcans les plus actifs et dangereux au monde, avec
une longue histoire d'éruptions. )
est situé dans le centre de Java, en Indonésie.
Il s'agit de l'un des volcans les plus actifs et dangereux au monde, avec
une longue histoire d'éruptions. |
Les caldeiras.
Une caldeira est
une dépression en forme de cratère qui se forme lorsque le sommet d'un
volcan s'effondre après une éruption explosive majeure ou, parfois par
une éruption effusive rapide qui a vidé rapidement la chambre magmatique
sous le volcan. Cela affaiblit la structure du volcan, ce qui peut entra√ģner
l'effondrement de la partie supérieure du volcan. Les caldeiras peuvent
avoir des tailles allant de quelques kilomètres à plusieurs dizaines
de kilomètres de diamètre. Leur forme est généralement circulaire ou
elliptique, bien que certaines puissent présenter des contours plus irréguliers.
L'effondrement à l'origine de la formation de la caldeira ne signifie
pas nécessairement la fin de l'activité volcanique. De nombreux exemples
de caldeiras montrent une activité volcanique continue, avec de nouvelles
éruptions pouvant se produire à l'intérieur même de la caldeiraou à
proximit√© de celle-ci. Des d√īmes de lave, des c√īnes volcaniques et d'autres
structures peuvent se former. Par ailleurs, les caldeiras sont aussi souvent
des zones d'intense activité géothermique, avec des sources chaudes,
des fumerolles et des champs géothermiques.
-
| Située
principalement dans le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des √Čtats-Unis,
la caldeira de Yellowstone est l'une des plus grandes du monde et
est le résultat de plusieurs éruptions majeures au cours des derniers
millions d'années. Le parc abrite également de nombreuses sources thermales
et geysers.
La caldeira de
Santorin, également connue sous le nom de caldeira de Théra,
est située dans les Cyclades, en Grèce.
Elle est le résultat de l'effondrement partiel d'un volcan vers 1600 av.
JC. L'effondrement a formé une baie en forme de croissant qui abrite aujourd'hui
les √ģles de Santorin et de Thirassia. L'endroit est remarquable pour ses
falaises escarpées, ses maisons blanchies à la chaux et son panorama
spectaculaire sur la mer √Čg√©e. |
Située
dans l'Oregon, aux √Čtats-Unis, la caldeira
de Crater Lake est le résultat de l'effondrement d'un volcan ancien
appelé le mont Mazama. L'effondrement s'est produit il y a environ 7700
ans, laissant derrière lui une dépression d'environ 9 km de diamètre,
qui abrite aujourd'hui un lac profond de près de 600 mètres.
La caldeira de
Ngorongoro est située dans le nord de la Tanzanie
et fait partie de la région de conservation de la Ngorongoro, classée
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette caldeira est le résultat de l'effondrement
d'un volcan massif il y a environ 2 à 3 millions d'années. Elle s'étend
sur environ 260 km² et abrite une incroyable diversité d'animaux sauvages,
notamment des lions, des éléphants,
des rhinocéros, des zèbres
et des gnous. |
Les supervolcans.
Un supervolcan est
un type de volcan extrêmement puissant qui est capable de produire des
éruptions cataclysmiques géantes, parmi les plus destructrices de l'histoire
de la Terre. Ces éruptions sont caractérisées par l'émission d'une
quantité massive de matériaux volcaniques, de cendres et de gaz sur une
échelle gigantesque. Elles peuvent éjecter plusieurs centaines
à plusieurs milliers de kilomètres cubes de matériaux volcaniques dans
l'atmosphère. Cela dépasse de loin
les éruptions des volcans ordinaires. La caldeira qui se forme après
une éruption supervolcanique peut atteindre des dizaines de kilomètres
de diamètre.
Très rares, les
éruptions supervolcaniques peuvent tarder plusieurs milliers, voire de
millions d'années, pour se produire. L'éjection massive de cendres volcaniques
et de gaz, en particulier de dioxyde de soufre, dans l'atmosphère peut
entra√ģner un refroidissement global temporaire de la plan√®te.
-
| Le
supervolcan de Yellowstone, situé principalement dans le parc national
de Yellowstone, est considérée comme l'un des supervolcans les plus dangereux
du monde. Il a connu trois éruptions majeures au cours des deux derniers
millions d'années, la plus récente ayant eu lieu il y a environ 640 000
ans. Ces éruptions ont libéré d'immenses quantités de cendres et ont
formé la caldeira de Yellowstone qui mesure environ 55 km sur 72 km.
Située en Californie,
la caldeira de Long Valley est un supervolcan qui s'est formé il
y a environ 760 000 ans lors d'une éruption massive. Elle mesure environ
32 km sur 19. Bien que l'activité volcanique à Long Valley soit relativement
calme depuis des milliers d'années, la région est toujours géologiquement
active, avec des événements sismiques et des émissions de gaz, et le
supervolcan est considéré comme potentiellement actif.
Situés près de
la ville de Naples, en Italie, Les Champs Phlégréens (Campi
Flegrei, soit Champs brulants, en italien) sont un vaste complexe
volcanique qui comprend une caldeira géante. Ce supervolcan a connu plusieurs
éruptions majeures au cours de son histoire, la plus récente ayant eu
lieu en 1538. L'activité volcanique continue dans la région, ce qui suscite
des inquiétudes quant à un éventuel réveil du supervolcan. |
La caldeira
de Taupo est situ√©e sur l'√ģle du Nord de la Nouvelle-Z√©lande.
Elle s'est formée lors d'une éruption cataclysmique il y a environ 26
500 ans, qui a été l'une des plus grandes éruptions volcaniques de ces
derniers milliers d'années. L'éruption a créé un lac dans la caldeira.
La région est toujours sismiquement active et présente des manifestations
géothermiques.
Situé dans l'Extrême-Orient
russe, le supervolcan de l'√ģle de Kouriles comprend une s√©rie
de volcans qui s'étendent sur plusieurs des Kouriles.
L'éruption la plus récente s'est produite en 2010, lorsque le volcan
Sarychev Peak a connu une éruption majeure.
Supervolcans de
la péninsule du Kamtchatka. - La péninsule du Kamtchatka,
à l'Est de la Sibérie, abrite plusieurs supervolcans.
Citons : le Klyuchevskoy, le plus haut volcan actif d'Eurasie, le Tolbachik,
le Bezymianny et le Shiveluch. Ces volcans sont régulièrement en éruption.
Supervolcan de
la caldeira de Toba. - La majeure partie de la caldeira de Toba, l'une
des plus grandes du monde, se trouve en Indonésie. Cette caldeira a été
formée par l'éruption d'un supervolcan il y a environ 74 000 ans. Celle-ci
a été l'une des plus violentes de l'histoire de la Terre. |
--

| Une
√©ruption du volcan Sarychev (√ģles Kouriles), vue depuis l'espace.-
Le Pic Sarychev, situ√© √† l'extr√©mit√© Nord-Ouest de l'√ģle Matua, est
l'un des volcans les plus actifs de l'archipel des Kouriles. Avant le 12
Juin 2009, date à laquelle a été prise cette photo, la dernière éruption
explosive avait eu lieu en 1989. D'autres éruptions ont également eu
lieu en 1986, 1976, 1954 et 1946, chacune ayant aussi produit des coulées
de lave. Plusieurs phénomènes qui se produisent pendant les premiers
stades d'une éruption volcanique explosive sont visibles sur cette image.
La colonne principale est l'une d'une série de panaches qui se sont élévés
au-dessus de l'√ģle de Matua le m√™me jour. Le panache semble √™tre une
combinaison de cendre brune et de vapeur blanche. La montée vigoureuse
panache vigoureusement donne naissance à une grande bulle de vapeur. L'atmosphère
environnante a été bousculée par l'onde de choc de l'éruption : les
nuages ont été écartés. Le nuage lisse de couleur blanche au sommet
du panache peut être l'eau de condensation qui a résulté de l'ascension
rapide et du refroidissement de la masse d'air au-dessus de la colonne
de cendres. Un nuage de plus dense, constitué de cendres grises
- très probablement une coulée pyroclastique - semble pour sa part être
cramponné au sol après avoir dévalé les pentes du volcan. Source
: Nasa. |
Les d√īmes volcaniques.
Les volcans en d√īme
se distinguent par l'accumulation de lave épaisse et visqueuse, généralement
riche en silice, qui s'√©coule lentement. Ces volcans peuvent conna√ģtre
des éruptions explosives lorsqu'il y a accumulation de pression et rupture
du d√īme de lave. Cependant, ces √©ruptions sont souvent moins violentes
que celles des volcans explosifs. Les d√īmes de lave peuvent √™tre instables
et sujets à des effondrements, ce qui peut générer des coulées pyroclastiques
rapides et dangereuses.
-
|
Massif
central
Le Puy de D√īme,
dans le Massif central, est un grand d√īme volcanique qui s'est form√©
il y a environ 11 000 ans.
Le Puy de Sancy
est le point culminant du Massif central, atteignant une altitude de 1885
m√®tres. Il s'agit √©galement d'un d√īme volcanique, bien qu'il soit partiellement
√©rod√©, laissant une forme plus conique que les d√īmes typiques.
Le Puy Mary
est un autre d√īme volcanique c√©l√®bre du Massif central, lui aussi se
trouve dans le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne.
Etats-Unis
D√īme du Mount
St. Helens. - Apr√®s l'√©ruption d√©vastatrice en 1980, un d√īme
volcanique s'est formé dans le cratère, alimenté par des éruptions
ult√©rieures. Le d√īme de ce volcan continue √† ce jour de cro√ģtre par
intermittences.
Le Novarupta
est un volcan situ√© dans la cha√ģne des Al√©outiennes,
en Alaska. En 1912, il a connu une éruption explosive qui a formé un
grand d√īme de lave. Cette √©ruption a √©t√© l'une des plus importantes
du XXe siècle et a déposé d'énormes
quantités de matériaux.
Chili
Le D√īme de Chait√©n
est situé dans la région des lacs du Chili, et
s'est formé à l'intérieur du cratère du volcan lors d'une éruption
en 2008, qui a conduit à l'évacuation de la ville voisine de Chaitén. |
Guatemala.
Le Santiaguito,
situé dans la région de Quetzaltenango, au Guatemala, est caractérisé
par plusieurs d√īmes de lave. Ce volcan, tr√®s actif, a donn√© lieu
à des éruptions explosives modérées et des éruptions effusives.
Arc
antillais
D√īme
de lave de la Montagne Pelée.
- Située en Martinique, la Montagne Pelée
est un volcan célèbre pour son éruption dévastatrice de 1902. Lors
de cette √©ruption, un d√īme de lave s'est form√© autour de la chemin√©e
volcanique.
D√īme de lave
de Chances Peak. - Situé à Montserrat,
le volcan Soufrière Hills a connu une éruption majeure à partir de 1995.
Au cours de cette √©ruption, plusieurs d√īmes volcaniques se sont form√©s,
notamment le d√īme de lave de Chances Peak. Ces d√īmes ont √©t√© instables
et ont produit des coulées pyroclastiques destructrices. L'activité volcanique
√† Soufri√®re Hills a entra√ģn√© l'√©vacuation de la majeure partie de
l'√ģle.
La Grande Soufrière
(Guadeloupe) est le volcan actif le plus élevé
des Petites Antilles. Il a produit plusieurs d√īmes volcaniques au cours
de son histoire, notamment le d√īme de lave de 1976.
Situé à Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
le volcan La Soufrière a également connu des éruptions récentes.
En 2021, un d√īme de lave s'est form√© dans le crat√®re, cr√©ant des risques
d'explosions et de coulées pyroclastiques. |
Les c√īnes de
scories.
Un c√īne de scories
est une structure, souvent avec un sommet pointu et des pentes raides,
qui se forme principalement lors d'éruptions explosives, dans lesquelles
le magma riche en gaz est expulsé violemment dans les airs et, se fragmente
en morceaux plus petits. Ces fragments se solidifient alors qu'ils retombent,
créant des couches de matériaux volcaniques meubles et non consolidés,
souvent de couleur sombre, allant du noir au gris (basaltes ou andésites).
La petite taille de ces fragments (de quelques millimètres à quelques
centim√®tres de diam√®tre), conf√®re aux c√īnes de scories une texture
g√©n√©ralement rugueuse. Quant √† la taille des c√īnes, elle peut,
quant à elle, aller de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres
de hauteur. Ils peuvent √™tre isol√©s, ou former des champs de c√īnes plus
vastes lorsqu'ils se regroupent autour du cratère principal d'un volcan.
--
| Le
MaungapŇćhatu
est un d√īme de scories situ√© dans le parc national de Te Urewera, sur
l'√ģle du Nord de la Nouvelle-Z√©lande. Il s'est form√© lors d'une √©ruption
il y a environ 1000 ans et est constitué de scories rouges et noires.
Le Sunset Crater
est un c√īne de scories situ√© dans l'Arizona,
aux √Čtats-Unis. Il s'est form√© lors d'une √©ruption volcanique qui a
eu lieu il y a environ 900 ans. Ce c√īne de scories est de couleur rouge,
orange et noire. |
Le
volcan Llaima est situé dans la région des lacs du Chili et présente
un d√īme de scories dans son crat√®re sommital. Le Llaima est l'un des
volcans les plus actifs du Chili, et son d√īme de scories est constamment
en évolution.
L'√ģle de Nisyros,
en Gr√®ce, abrite un d√īme de scories appel√© Stefanos. Celui-ci
s'est formé lors d'une éruption volcanique il y a plusieurs milliers
d'années. Il est rempli de soufre et de fumerolles. |
--
Les volcans fissuraux.
Les
volcans fissuraux se caractérisent par des éruptions le long de fissures
linéaires, longues de quelques centaines de mètres à quelques dizaines
de kilom√®tres, plut√īt que par un crat√®re central distinct. Ils peuvent
produire de longues coulées de lave et se trouvent généralement dans
les zones de divergence des plaques tectoniques, principalement le
long des zones de rift océanique, mais ils peuvent également se produire
le long des zones de rift continentales et des zones de subduction. Les
volcans fissuraux, dont la lave est généralement basaltique, de faible
viscosité, produisent des éruptions effusives. Ces éruptions peuvent
durer de quelques jours à plusieurs mois.
Les volcans sous-marins.
Les volcans sous-marins
se rencontrent souvent le long des zones de divergence des plaques tectoniques
ou au-dessus de points chauds. La plupart se trouvent entièrement sous
l'eau, mais ayant grandi à l'occasion de leurs éruptions successives,
certains émergent au-dessus de la surface de l'eau. Ainsi peuvent-ils
former des montagnes sous-marines, des √ģles ou des atolls. Ils ne constituent
pas en soi un type particulier de volcan : leurs morphologies sont sont
similaires à celles des volcans terrestres. Les coulées de lave qui se
forment sous l'eau, généralement dans les environnements océaniques
peuvent prendre une forme particulière, celle de coussins arrondis, en
raison du refroidissement rapide de la lave au contact de l'eau.
Les ensembles
volcaniques.
Les
complexes de caldeira rhyolitiques.
Les
complexes de caldeira rhyolitiques sont de vastes dépressions circulaires
ou elliptiques qui se forment lorsque d'énormes volumes de magma rhyolitique
sont émis lors d'éruptions explosives.
 Parmi
les exemples de complexes de caldeira rhyolitiques, on peut mentionner,
aux Etats-Unis celui dont la caldeira de Yellowstone ou de Long Valley,
en Californie, ou celle de la caldeira de Valles, au Nouveau-Mexique, sont
le centre; ceux aussi de la caldeira de Taupo, en Nouvelle Zélande, ou
des Sete Cidades, aux Açores. En Italie, on nommera le complexe
(que l'on a dit plus haut être associé à un supervolcan), qui comprend
les Champs Phlégréens, près de Naples
en Italie, et des caldeiras plus anciennes, comme celle de Baia et celle
de Pozzuoli; ou encore, près de Rome, la solfatare
de Manziana, complexe constitué de plusieurs caldeiras superposées, qui
présente des manifestations hydrothermales actives, avec des fumerolles
et des sources chaudes. A ranger également ici, le complexe volcanique
du Laacher See, dans la région volcanique de l'Eifel, en Allemagne. Parmi
les exemples de complexes de caldeira rhyolitiques, on peut mentionner,
aux Etats-Unis celui dont la caldeira de Yellowstone ou de Long Valley,
en Californie, ou celle de la caldeira de Valles, au Nouveau-Mexique, sont
le centre; ceux aussi de la caldeira de Taupo, en Nouvelle Zélande, ou
des Sete Cidades, aux Açores. En Italie, on nommera le complexe
(que l'on a dit plus haut être associé à un supervolcan), qui comprend
les Champs Phlégréens, près de Naples
en Italie, et des caldeiras plus anciennes, comme celle de Baia et celle
de Pozzuoli; ou encore, près de Rome, la solfatare
de Manziana, complexe constitué de plusieurs caldeiras superposées, qui
présente des manifestations hydrothermales actives, avec des fumerolles
et des sources chaudes. A ranger également ici, le complexe volcanique
du Laacher See, dans la région volcanique de l'Eifel, en Allemagne.
Les
champs monogéniques volcaniques.
Les champs monogéniques
volcaniques se composent de multiples petits volcans indépendants formés
à partir d'un centre éruptif unique. Chaque volcan monogénique est né
d'une seule éruption, qui a été de courte durée (de quelques jours
à quelques années). Une fois l'éruption terminée, le volcan cesse d'être
actif et d'autres volcans monogéniques peuvent se former à proximité.
Les éruptions dans ces champs, qu'ils soient de nature explosive ou effusive,
produisent g√©n√©ralement des c√īnes de scories et des coul√©es de lave
basaltique. Certains champs peuvent être relativement petits, avec seulement
quelques volcans, tandis que d'autres peuvent comprendre des dizaines ou
des centaines de volcans dispersés sur une vaste zone.
-
| Les
champs volcaniques d'Auvergne, se trouvent dans le Massif central
et forment l'un des plus grands champs volcaniques monogéniques d'Europe.
On nommera ici le Puy de D√īme, le Puy de Sancy et le Puy Mary.
Les champs volcaniques
de San Francisco se trouvent dans la région de la baie de San Francisco,
en Californie. Ils comprennent plusieurs volcans monogéniques, tels que
le Mont Diablo, le Mont Tamalpais et le Mont Saint Helena. Ces volcans
se sont formés au cours des derniers millions d'années et sont considérés
comme éteints.
Les champs volcaniques
de Michoacán-Guanajuato sont situés dans le centre du Mexique. Parmi
les volcans monogénique qu'on y trouve, on citera le Paricutín dans le
Michoacan et le Jorullo. Le Paricutín est particulièrement célèbre
car il s'est form√© en 1943 dans un champ de ma√Įs, offrant un exemple
rare d'observation de l'apparition d'un volcan. Il a connu une phase éruptive
intense pendant neuf ans, laissant une c√īne de scories et des coul√©es
de lave qui ont dévasté les villages environnants. |
Les
champs volcaniques de Victoria se trouvent dans le sud-est de l'Australie.
Ils comprennent plusieurs volcans monogéniques vieux de quelques milliers
d'années tels que le Tower Hill, le Mount Eccles et le Mount Leura.
Le champ volcanique
de Jeju est situ√© sur l'√ģle de Jeju, en Cor√©e
du Sud. C'est une région volcanique active avec plus de 360 volcans
monog√©niques dispers√©s sur l'√ģle. Le volcan Hallasan, le point culminant
de la Corée du Sud, est situé dans ce champ volcanique. La région de
Jeju renferme des c√īnes de scories, des tunnels de lave, des crat√®res
et des formations rocheuses uniques.
Le champ volcanique
de Cappadoce est situé en Anatolie centrale,
en Turquie. Il est connu pour ses formations géologiques inhabituelles
et spectaculaires, résultant de l'érosion de cendres volcaniques et de
tufs
issus d'éruptions volcaniques passées. La région de Cappadoce est célèbre
pour ses cheminées de fées, ses formations rocheuses coniques et ses
villes souterraines creusées dans le tuf volcanique. |
Les
trapps et le volcanisme basaltique en plateau.
Les trapps ( = provinces
ignées basaltique en plateau) sont de grandes provinces volcaniques formées
par de longues et importantes éruptions, au cours desquelles d'immenses
volumes de lave basaltique (souvent associée à des émissions de gaz),
sont répandus sur une superficie étendue. Ainsi, les trapps s'étendent
ordinairement sur des centaines de milliers de kilomètres carrés et peuvent
atteindre des épaisseurs de plusieurs kilomètres. Ils présentent des
surfaces relativement plates et des pentes douces.
Les trapps sont généralement
associés à un type d'activité volcanique qui prend le nom de volcanisme
basaltique en plateau. Ce type de volcanisme qui peut résulter de
la présence d'un point chaud, ou de mouvements tectoniques qui ont fissuréla
cro√Ľte terrestre facilitant l'ascension du magma jusqu'√† la surface (volcanisme
de compression).
| Le
plateau du Deccan est un exemple célèbre de volcanisme basaltique
en plateau. Il couvre une grande partie de la péninsule indienne, et résulte
d'éruptions qui se sont produites il y a une soixantaine de millions d'années,
soit à peu près au moment de la grande extinction de la fin du Crétacé.
Le plateau du
Paraná-Etendeka s'étend sur une vaste région qui comprend le sud
du Brésil (parc national d'Aparados da Serra
), l'Uruguay, l'ouest de l'Argentine
et l'ouest de la Namibie. Ses laves sont
vieilles d'environ 130 à 140 millions d'années.
Le plateau Chilcotin
(Canada) est constitué d'étendues de lave basaltique
qui se sont formées il y a environ 7 à 14 millions d'années. La région
est parsemée de volcans éteints.
Les trapps de
Sibérie (Russie) se sont formés il y a 250 millions d'années, pendant
le Permien-Trias,
et sont associés à la plus grande extinction de masse de l'histoire
de la Terre. Ils s'étendent sur plusieurs millions de kilomètres
carrés |
Le
plateau de la Columbia se trouve dans l'ouest des √Čtats-Unis. Il
couvre une partie de l'Oregon, de l'√Čtat de Washington et de l'Idaho,
et est composé de coulées de lave basaltique qui se sont formées il
y a environ 15 à 17 millions d'années. Le parc national des Craters of
the Moon dans l'Idaho est un exemple emblématique des paysages volcaniques
du plateau de la Columbia.
Les volcans du
Massif Central ont aussi pour origine un volcanisme basaltique en plateau.
Le Massif Central s'est constitué il y a environ 300 millions d'années,
mais l'activité de ses volcans remonte à environ 70 millions d'années,
lorsque la région a été de nouveau traversée par des failles
tectoniques et des rifts associés à l'orogénèse alpine. Les mouvements
tectoniques ont cr√©√© des fractures dans la cro√Ľte terrestre, permettant
au magma chaud de remonter à la surface. Le magma qui a atteint la surface
était principalement du basalte, une lave fluide riche en silice et en
fer. L'activité volcanique du Massif Central s'est encore manifestée
par épisodes, et ne s'est ralentie qu'il y a environ 5 millions d'années. |
Les types
d'activité volcanique
Les
différents types d'activité volcanique et le type d'éruption qui les
caracérisent en premier lieu peuvent souvent être associées aux type
des magmas impliqués. Les éruptions explosives sont souvent liées aux
magmas trachytiques, daciques, rhyolitiques et phonolitiques et à la formation
de d√īmes de laves et de tufs. Les √©ruptions effusives sont souvent associ√©es
aux magmas basaltiques et picrobasaltiques, qui produisent des volcans
boucliers. Mais le lien n'a pas toujours un caractère impératif. Ainsi,
par exemple le magma andésitique (souvent associé aux stratovolcans)
peut produire des éruptions aussi bien explosives ou qu'effusives.
Les
quatre états d'un volcan.
Selon qu'ils sont
actifs ou non, selon leur degré d'activité, on range souvent, par commodité,
les volcans dans quatre catégories : un volcan peut ainsi être dit en
éruption, actif, endormi ou éteint. De telles qualifications caractérisent
non le volcan mais son état à un moment donné de son existence. Les
volcans finissent le plus souvent par s'endormir, les volcans endormis
ou même éteints peuvent parfois reprendre leur activité...
De la même façon,
un même volcan peut être qualifié en fonction d'une activité
qu'il manifeste généralement. Par exemple on peut qualifier de volcan
plinien,
le Pinatubo, aux Philippines, en référence
à l'éruption explosive qu'il a connu en 1991. Mais ce n'est pas la forme
d'activit√© exclusive qu'il peut conna√ģtre : l'√©ruption de 1991 a ainsi
été suivie de plusieurs éruption phréatiques.
En
éruption.
On parle de volcan
en éruption pour qualifier un volcan actuellement en train d'émettre
du magma, des gaz volcaniques et d'autres matériaux à la surface de la
Terre. Les éruptions peuvent être, le plus souvent, explosives, avec
une libération soudaine de gaz et de cendres volcaniques, ou effusives,
quand le magma s'écoule plus doucement.
 Les
éruptions volcaniques sont déclenchées par une combinaison complexe
de facteurs. Le plus important de ces déclencheurs est l'accumulation
de magma dans la chambre magmatique. L'augmentation de la pression qui
en résulte peut provoquer une rupture de la chambre magmatique et déclencher
une éruption. Cette augmentation de pression peut aussi être due des
forces de marée, causées par l'interaction
gravitationnelle entre la Lune, le Soleil et la Terre, et analogues à
celles qui causent les marées océaniques. Les mouvements des plaques
tectoniques peuvent également contribuer au déclenchement d'éruptions,
en provoquant des contraintes et des d√©formations dans la cro√Ľte
terrestre, ce qui peut faciliter la montée du magma vers la surface.
L'activité humaine, enfin, telle que l'extraction de ressources géothermiques
ou les explosions lors de projets miniers, peut influencer la stabilité
des volcans et potentiellement déclencher des éruptions. Les
éruptions volcaniques sont déclenchées par une combinaison complexe
de facteurs. Le plus important de ces déclencheurs est l'accumulation
de magma dans la chambre magmatique. L'augmentation de la pression qui
en résulte peut provoquer une rupture de la chambre magmatique et déclencher
une éruption. Cette augmentation de pression peut aussi être due des
forces de marée, causées par l'interaction
gravitationnelle entre la Lune, le Soleil et la Terre, et analogues à
celles qui causent les marées océaniques. Les mouvements des plaques
tectoniques peuvent également contribuer au déclenchement d'éruptions,
en provoquant des contraintes et des d√©formations dans la cro√Ľte
terrestre, ce qui peut faciliter la montée du magma vers la surface.
L'activité humaine, enfin, telle que l'extraction de ressources géothermiques
ou les explosions lors de projets miniers, peut influencer la stabilité
des volcans et potentiellement déclencher des éruptions.
 Divers
signes précurseurs informent sur l'imminence d'une éruption. L'augmentation
de l'activité sismique peut être un indicateur important d'une activité
magmatique croissante et donc d'une possible éruption. Des mesures de
déformation du sol (élévation ou gonflement du sol autour du volcan),
peuvent également signaler l'accumulation de magma et la pression dans
la chambre magmatique. L'émission de gaz volcaniques peut aussi augmenter
avant une éruption et est souvent surveillée comme un indicateur précoce.
On peut encore observer des changements dans la température de l'eau,
des sols ou de l'air près du volcan, ou, enfin des altérations des sources
hydrothermales voisines. Divers
signes précurseurs informent sur l'imminence d'une éruption. L'augmentation
de l'activité sismique peut être un indicateur important d'une activité
magmatique croissante et donc d'une possible éruption. Des mesures de
déformation du sol (élévation ou gonflement du sol autour du volcan),
peuvent également signaler l'accumulation de magma et la pression dans
la chambre magmatique. L'émission de gaz volcaniques peut aussi augmenter
avant une éruption et est souvent surveillée comme un indicateur précoce.
On peut encore observer des changements dans la température de l'eau,
des sols ou de l'air près du volcan, ou, enfin des altérations des sources
hydrothermales voisines.
Actif.
On considère qu'un
volcan est actif s'il a eu au moins une éruption au cours des derniers
milliers d'années et s'il présente toujours des signes d'activité volcanique
(émissions régulières de gaz volcaniques, sismicité accrue, déformations
du sol).

| Un
volcan actif, le Vulcano (√ģles Eoliennes). - Vulcano est consid√©r√©
comme l'un des volcans les moins actifs de ces √ģles, mais son activit√©
est ancienne. Il a jou√© un r√īle important dans la mythologie grecque,
qui l'a associ√© au dieu du feu, H√©pha√Įstos (dans lequel les latins on
vu leur dieu Vulcain). Il possède des sources thermales, des fumerolles
et des solfatares émettant des gaz volcaniques soufrés. C'est un stratovolcan,
composé de plusieurs cratères, dont le principal aujourd'hui, de forme
elliptique, est le Gran Cratere (500 x 600 m environ). Plus grand encore
(plus de 2 km de diamère) est le Vulcano Piano, ancien cratère qui fut
autrefois comblé par un immense lac de lave solidifiée, et présente
aujourd'hui une surface couverte de cultures et d'habitations. Sur la c√īte,
à l'ouest du volcan se des sources chaudes, connues sous le nom de Piscina
di Venere (Piscine de Vénus).
Photo : © Thierry
Labat, 2009. |
Endormi.
Un volcan est dit
endormi lorsqu'il n'est pas actuellement actif, mais qu'il a le potentiel
de se réveiller et de devenir actif à l'avenir. Les volcans endormis
ont connu des éruptions dans le passé géologique, mais ils sont calmes
depuis une période prolongée.
√Čteint.
Un volcan peut être
qualifié d'éteint lorsqu'il n'a pas connu d'éruption au cours des derniers
milliers d'années et qu'il n'est pas susceptible de se réveiller à l'avenir.
De tels volcans peuvent présenter des caractéristiques morphologiques
anciennes.
Le volcanisme
explosif.
Les éruptions explosives
se produisent lorsque le magma est riche en silice et en gaz, ce qui lui
confère une viscosité élevée. Lorsque la pression devient trop importante,
le magma est expulsé violemment, provoquant des explosions et la fragmentation
du magma. Ces explosions libèrent également de grandes quantités de
gaz et de cendres dans l'atmosphère. Les éruptions explosives peuvent
être très destructrices et générer des nuées
ardentes, des lahars et des retombées
de cendres.
Les
éruptions stromboliennes.
Une éruption strombolienne
(du nom du volcan Stromboli) est un type d'éruption volcanique caractérisée
par des explosions modérées et récurrentes de lave et de gaz. Les fragments
de lave et les cendres peuvent être projetés à plusieurs centaines de
mètres dans les airs. La lave émise lors des éruptions stromboliennes
est généralement plus fluide que celle des éruptions explosives majeures.
Notons, qu'une éruption strombolienne peut également comporter des phases
effusives.
Les
éruptions vulcaniennes.
Les éruptions vulcaniennes
sont nommées d'après le volcan Vulcano. Ce sont des éruptions explosives,
plus violentes que les explosions stromboliennes. Elles impliquent l'émission
de colonnes de cendres, de gaz et de roches éjectées qui peuvent s'élever
jusqu'à plusieurs kilomètres d'altitude, ainsi que des laves visqueuse,
formant des d√īmes et des coul√©es pyroclastiques de faible √©tendue. Ces
éruptions peuvent également générer des nuées ardentes.
Les
éruptions pliniennes.
Les éruptions pliniennes
doivent leur nom à Pline le Jeune qui a décrit l'éruption du Vésuve en l'an 79, qui a détruit les villes
de Pompéi et d'Herculanum. Ces éruptions sont parmi les éruptions volcaniques
les plus violentes. Elles se caractérisent par l'émission de grandes
quantités de cendres, de gaz et de fragments rocheux. La colonne de gaz,
de cendres et de roches éjectés peut s'élever parfois à plusieurs dizaines
de kilomètres. Les éruptions pliniennes génèrent des nuées ardentes,
des chutes de cendres importantes et des avalanches de débris.
qui a décrit l'éruption du Vésuve en l'an 79, qui a détruit les villes
de Pompéi et d'Herculanum. Ces éruptions sont parmi les éruptions volcaniques
les plus violentes. Elles se caractérisent par l'émission de grandes
quantités de cendres, de gaz et de fragments rocheux. La colonne de gaz,
de cendres et de roches éjectés peut s'élever parfois à plusieurs dizaines
de kilomètres. Les éruptions pliniennes génèrent des nuées ardentes,
des chutes de cendres importantes et des avalanches de débris.
 On
distingue parmi les éruptions pliniennes plusieurs sous-types. Citons
pour commencer, les éruptions subpliniennes, moins explosives que
les éruptions pliniennes proprement dites, mais plus que les éruptions
vulcaniennes. Elles produisent des colonnes de cendres épaisses et denses,
mais à des altitudes plus basses que l'éruption plinienne. A l'opposé,
les éruptions ultrapliniennes correspondent à la production d'une
colonne éruptive de hauteur exceptionnelle (plus de 40 km) occasionnant
une importante dispersion de cendres sur des dizaines de milliers de kilomètres
carrés.- On
distingue parmi les éruptions pliniennes plusieurs sous-types. Citons
pour commencer, les éruptions subpliniennes, moins explosives que
les éruptions pliniennes proprement dites, mais plus que les éruptions
vulcaniennes. Elles produisent des colonnes de cendres épaisses et denses,
mais à des altitudes plus basses que l'éruption plinienne. A l'opposé,
les éruptions ultrapliniennes correspondent à la production d'une
colonne éruptive de hauteur exceptionnelle (plus de 40 km) occasionnant
une importante dispersion de cendres sur des dizaines de milliers de kilomètres
carrés.-
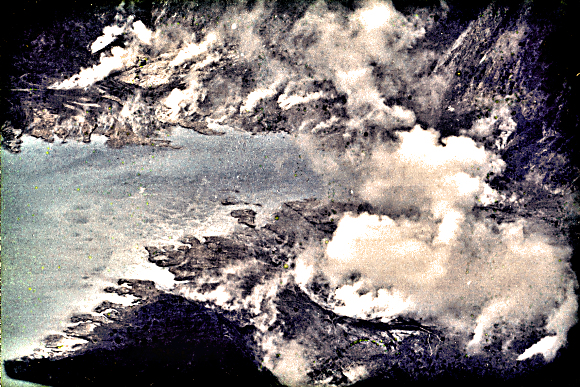
| Lac
acide (avec une forte teneur en acide sulfurique), cratère secondaire
et fumerolles dans la caldeira du volcán Chichón (ou Chichonal), au Sud
du Mexique, photographiés depuis le bord du cratère principal 9 ans
apr√®s l'√©ruption. - Ce volcan and√©sitique en d√īme a connu entre le
28 mars et le 4 avril 1982 une éruption plinienne, qui a été l'une des
plus violentes et dévastatrices dans l'histoire du Mexique. Cette éruption
a émis 20 millions de tonnes de gaz et de cendres. Plus de 8 millions
de tonnes de SO2 ont atteint
des altitudes allant de 17 à 28 km. Les nuées ardentes, puis les
lahars ont provoqué la mort de 2000 personnes et le déplacement de 20
000 autres, ainsi que des dommages importants aux cultures et aux habitations
dans les régions environnantes. Les trois dernières éruptions avaient
eu lieu vers 1850, 1360 et 1170. Photo © Serge
Jodra,1991. |
Les
√©ruptions peŐĀl√©ennes.
Nommées d'après
l'éruption de la Montagne Pelée, en Martinique qui a dévasté la ville
de Saint-Pierre en 1902, les éruptions péléenes, sont, comme les précédentes,
extrêmement explosives et violentes, et parmi les éruptions les plus
destructrices et meurtrières. Les nuées ardentes sont l'élément central
de ces éruptions, ce qui les rend particulièrement dévastatrices.
Le volcanisme
effusif.
Les
éruptions effusives se caractérisent par l'écoulement relativement calme
et lent de la lave qui peu s'étendre sur de grandes distances. Le magma
est généralement basaltique, pauvre en silice, ce qui lui confère une
faible viscosité. Ces éruptions sont typiques des volcans boucliers.
Les
√©ruptions hawa√Įennes.
Les √©ruptions hawa√Įennes
correspondent à éruptions effusives dont le prototype est fourni par
les volcans boucliers d'Hawaii. Elles sont caractérisées par des écoulements
continus de lave fluides, avec des fontaines de lave atteignant parfois
de grandes hauteurs. La lave √©mise peut provoquer la formation de c√īnes
de scories et de fissures √©ruptives. Les √©ruptions hawa√Įennes peuvent
durer pendant des périodes prolongées et les nappes de lave peuvent recouvrir
de grandes étendues.
-

| Fontaine
de lave au sommet du Kilauea (Hawaii), le 12 septembre 2023.
La coulée de lave refroidie au premier plan a été détruite au cours
de l'éruption qui a suivi. - Les fontaines de lave se produisent généralement
lorsqu'il y a une accumulation de gaz dissous dans la lave. Lorsque la
pression des gaz devient suffisamment élevée, elle propulse la lave en
l'air sous forme de jets ou de fontaines. La viscosité de la lave joue
un r√īle crucial dans la formation de ces jets. Si la lave est visqueuse
(épaisse et collante), elle peut piéger les gaz, ce qui augmente la pression
et provoque des explosions de lave puissantes. Certaines peuvent atteindre
des hauteurs considérables.Photo
: USGS, N. Deligne. |
Le
volcanisme fissural.
Le volcanisme fissural
est un type d'activité volcanique effusive, caractérisée par l'émission
de lave et de gaz à partir de fissures dans l'écorce terrestre, souvent
apparues le long de ses zones de faiblesse en raison de tensions tectoniques.
Le volcanisme fissural peut aboutir à la formation de volcans en forme
de montagnes typiques, o√Ļ la lave s'√©coule √† partir d'une zone tr√®s
réduite (volcans fissuraux). Mais, le plus souvent, on observe avec le
volcanisme fissural des éruptions de lave le long d'une ligne étendue
ou d'une série de fissures dans le sol. Les coulées de lave émises par
le volcanisme fissural peuvent s'accumuler et former des plateaux basaltiques
étendus et relever de ce qu'on a appelé plus haut le volcanisme basaltique
en plateau.
Les éruptions
phréatiques.
Les éruptions phréatiques
se produisent lorsque l'eau souterraine entre en contact avec le magma
chaud, provoquant une violente éruption de vapeur et de fragments de roche.
Ces éruptions sont généralement de courte durée et peuvent se produire
soudainement sans signe avant-coureur. Elles peuvent être associées à
des volcans actifs ou endormis, et impliquer l'émission de lave (dans
les éruptions phératomagmatiques) ou seulement de gaz, comme dans les
éruptions limniques.
‚ÄĘ Les
éruptions phréatomagmatiques se produisent lorsque de l'eau
(présente dans les pores du magma ou provenant de sources externes) entre
en contact avec le magma riche en silice. Cela provoque une rapide vaporisation
de l'eau et, par suite, crée une explosion violente qui éjecte des fragments
de roche et de cendres dans les airs, et aboutit éventuellement à la
formation cratère peu profond mais large ( Maar).
Ces éruptions peuvent générer des nuées ardentes, des lahars, des coulées
de lave et des retomb√©es de cendres. Le Merapi (√ģle de Java) est un exemple
particulièrement dangereux de volcan connaissant des éruptions
phréatomagmatiques. Maar).
Ces éruptions peuvent générer des nuées ardentes, des lahars, des coulées
de lave et des retomb√©es de cendres. Le Merapi (√ģle de Java) est un exemple
particulièrement dangereux de volcan connaissant des éruptions
phréatomagmatiques.
‚ÄĘ Les √©ruptions limniques sont
un phénomène qui concerne le rencontre du magma
ou de roches chaudes avec l'eau d'un lac et provoque
une forte émission de gaz, ouvent du dioxyde de carbone (CO2)
ou du méthane, après que ce gaz se soit accumule sous la surface de l'eau
en raison d'activités géothermiques ou volcaniques sous-jacentes. Lorsque
la pression du gaz a atteint un certain seuil, elle peut être libérée
brusquement, créant des bulles de gaz qui remontent à la surface et provoquent
des perturbations violentes dans l'eau.Trois exemples d'éruptions limniques
peuvent être donnés : l'éruption du lac Nyos, au Cameroun,
le 21 ao√Ľt 1986 (1700 personnes tu√©es par le dioxyde de carbone lib√©r√©,
ainsi que des milliers d'animaux), celle du lac Monoum, deux ans plus t√īt
(ao√Ľt 1984) dans la m√™me r√©gion (37 victimes), et celles du lac Kivu,
en République démocratique du Congo et
au Rwanda, en 1986.
Les éruptions surtseyennes.
L'éruption du Surtsey
qui a commenc√© en 1963 et a conduit √† la formation de l'√ģle √©ponyme
au large des c√ītes de l'Islande est le prototype des √©ruptions surtseyennes.
Il s'agit d'éruptions qui se produisent sous l'eau, généralement le
long des fonds marins ou dans des zones submergées. Elles commencent généralement
par des √©ruptions phr√©atomagmatiques o√Ļ l'eau de mer entre en contact
avec le magma chaud, provoquant des explosions et la formation d'une colonne
√©ruptive. Au fur et √† mesure que l'√©ruption progresse, plut√īt sur un
mode effusif, les matériaux éruptifs s'accumulent et peuvent atteindre
la surface de l'eau, formant des √ģles ou des √ģlots.
-

| Le
Whakaari (White Island), au Nord de la Nouvelle-Zélande. - Sa couleur
claire est due au soufre et aux composés soufrés qui recouvrent ses flancs.
Situé dans le zone de subduction de la plaque tectonique australienne
sous la plaque pacifique, le Whakaari présente une activité constante,
avec des émissions de gaz, des fumerolles, des sources chaudes et des
éruptions phréatomagmatiques périodiques. La dernière éruption importante
a eu lieu le 9 décembre 2019 et a fait 22 morts et de nombreux blessés
parmi les touristes qui se trouvaient sur l'√ģle.
Photo : Julius Silver. Licence : Creative Commons. |
Les
produits du volcanisme
√Čmanations gazeuses
des volcans.
Les gaz libérés
par le magma en fusion à l'intérieur du volcan et peuvent être expulsés
en très grandes quantités lors des éruptions ou bien signer simplement
une activité non éruptive, voire être les vestiges d'une activité ancienne.
La vapeur d'eau est
- et de très loin - le principal composant des émanations volcaniques.
On rencontre aussi en abondance du dioxyde de carbone (CO2),
et divers composés soufrés, comme le dioxyde de soufre (SO2),
le sulfure d'hydrogène (H2S) et le disulfure de carbure
(CS2), qui sont susceptibles de provoquer des odeurs
désagréables et qui sont potentiellement nocifs pour la santé. Les gaz
acides, tels que l'acide chlorhydrique (HCl) et l'acide fluorhydrique (HF),
peuvent également être présents dans les émanations gazeuses volcaniques
et peuvent, quant à eux, provoquer des irritations respiratoires et oculaires.
Le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde d'azote (NO2)
et divers composés organiques peuvent également être présents dans
les émanations volcaniques, mais généralement dans des proportions bien
moindres.
 Quand
les gaz volcaniques réagissent avec l'humidité de l'air, ils forment
des acides (l'acide sulfurique (H2SO4)
et acide nitrique (HNO3), notamment), qui peuvent
retomber sous forme de pluies acides,
corrosives pour la v√©g√©tation, les sols et les b√Ętiments. Quand
les gaz volcaniques réagissent avec l'humidité de l'air, ils forment
des acides (l'acide sulfurique (H2SO4)
et acide nitrique (HNO3), notamment), qui peuvent
retomber sous forme de pluies acides,
corrosives pour la v√©g√©tation, les sols et les b√Ętiments.
Les
panaches volcaniques.
Lors
de certaines értuptions, les produits volcaniques sont expulsés à très
haute altitude dans l'atmosphère, atteignant parfois la stratosphère,
formant une colonne ascendante de gaz chauds, de cendres, de particules
rocheuses et d'autres matériaux, et appelée panache volcanique.
Les vents peuvent ensuite les disperser et les déplacer sur de longues
distances, formant parfois des nuages de particules observables en pratiquement
tous les points de la Terre.
-

| Eruption
du mont St Helens (WA), le 18 mai 1980. - Le panache de cendres et
de gaz a atteint une altitude de plus de 24 km. Une
partie du c√īt√© nord de la montagne a √©t√© d√©truite par l'√©ruption,
provoquant une avalanche de débris qui a dévalé le flanc de la montagne
et détruit tout sur son passage. Plusieurs personnes ont perdu la vie.
Source
: USGS. |
Les
nuées ardentes.
Rangeons encore
ici les nuées ardentes, qui sont des écoulements de gaz, mais
aussi de cendres, de lapilli et de blocs volcaniques incandescents (températures
de l'ordre de 800 ¬įC). Les nu√©es ardentes d√©valent rapidement, souvent
à des vitesses supérieures à 80 km/h, les flancs du volcan lors d'une
éruption explosive. Elles peuvent atteindre des distances considérables,
parfois plusieurs dizaines de kilomètres. Après leur passage, ces phénomènes
particuli√®rement dangereux laissent souvent des d√©p√īts pyroclastiques
qui durcissent et forment des roches telles que les ignimbrites (V. ci-dessous).
Les
fumerolles.
Les fumeroles
sont des émanations de gaz chauds et de vapeur d'eau, actives en permanence
ou intermittentes, provenant de l'int√©rieur de la cro√Ľte terrestre, et
qui s'échappent par des ouvertures dans le sol autour du volcan, ou
plus à l'écart, dans une zone affectée par l'activité volcanique et
associées à des activités géothermiques. Elles se produisent lorsque
l'eau souterraine ou issue des précipitations entre en contact avec des
roches chaudes ou des magmas sous la surface de la terre, s'échauffe et
s'évapore.
La composition chimique
des fumeroles est assez diverse. On observe des fumerolles principalement
composées de vapeur d'eau, qui peuvent être présentes aussi bien dans
les champs géothermiques, que dans les geysers et les zones volcaniques
actives. Certaines fumerolles, couramment associées à des volcans actifs,
sont acides et contiennent des vapeurs chargées notamment de dioxyde de
soufre (SO2) ou d'acide chlorhydrique (HCl). D'autres,
moins fréquentes, sont alcalines, et contiennent, principalement de l'ammoniac
(NH3) et des hydrocarbures, ce qui leur donne une
odeur caractéristique d'oeuf pourri. La même odeur est présente aussi
avec les fumerolles riches en sulfure d'hydrogène (H2S),
un gaz toxique. On mentionnera encore les fumerolles sont riches en dioxyde
de carbone (CO2), celle-ci inodores. Certaines fumerolles,
enfin, peuvent contenir un mélange de plusieurs gaz volcaniques.
Les écoulements
liquides.
La
lave.
La lave
est le matériau fondu qui est émis par un volcan lors d'une éruption.
Autrement dit, c'est le nom que prend le magma lorsqu'il atteint la surface
de la Terre o√Ļ il se refroidit et se transforme, pour finir par se solidifier
et se cristalliser sous diverses formes. Le refroidissement de la lave
est parfois tr√®s lent. Cela tient √† ce que la cro√Ľte superficielle
refroidie est très mauvaise conductrice de la chaleur et constitue un
obstacle efficace au rayonnement. Un refroidissement très rapide de la
lave ne permettant pas la cristallisation des minéraux, conduit à la
formation de verres volcaniques (obsidienne).
Parfois, au cours de cette solidification, les blocs en voie de refroidissement
sont bouscul√©s comme les gla√ßons d'une d√©b√Ęcle, prenant la structure
tourmentée des
sciarres de Sicile
et des cheires d'Auvergne.
L'émission
de lave se produit quelquefois par le cratère,
mais plus fréquemment par les fissures qui déchirent les flancs des volcans.
En se déversant, la lave forme des coulées qui peuvent se solidifier
en différentes textures et structures.
‚ÄĘ Les
coulées en cordées (cordées de lave) ressemblent à des cordes ou
des rubans entrelacés. Elles se forment lorsque la lave est suffisamment
visqueuse pour développer des structures filamenteuses ou cordées à
mesure qu'elle s'écoule. Ces cordées peuvent varier en taille et en longueur,
donnant à la lave un aspect tressé ou noueux.
‚ÄĘ Les
coulées en plaques (plaques de lave) sont caractérisées par la formation
de blocs ou de plaques qui se chevauchent ou se superposent les uns sur
les autres. Ces blocs sont généralement angulaires. Ils se forment lorsque
la surface de la lave se solidifie tout en restant suffisamment plastique
en dessous pour permettre le mouvement et la superposition.
‚ÄĘ Les
coulées en aiguilles (aiguilles de lave) se produisent lorsqu'une
lave fluide jaillit ou gicle de manière explosive, formant des filaments
ou des aiguilles qui peuvent être projetées dans les airs. Ces aiguilles,
qui se solidifient ainsi en se refroidissant, sont généralement fines
et allongées.
‚ÄĘ Les colonnes
basaltiques (prismes basaltiques) sont des formations créées
lors du refroidissement de la lave basaltique et constituées de colonnes
régulières en forme d'hexagones (le plus souvent), de pentagones d'heptagones
ou d'autres polygones. Elles se forment lorsque la lave, en fusion pendant
une éruption volcanique, refroidit lentement et se contracte. Ce refroidissement
lent entra√ģne l'apparition de fractures polygonales qui se propagent verticalement
dans la lave en fusion, créant des colonnes. Ces colonnes, s'empilant
verticalement les unes sur les autres et s'organisant en colonnades aux
motifs réguliers, peuvent varier en taille, allant de quelques centimètres
à plusieurs mètres de hauteur, en fonction des conditions de refroidissement
et des caractéristiques de la lave. Nommées orgues basaltiques
dans le langage touristique, ces formations s'observent en divers points
du globe, les plus célèbres sont peut-être celles de la Chaussée des
Géants, en Irlande du Nord.

| Les
orgues basaltiques de la Chaussée des Géants, au Nord de l'Irlande. -
Emise
par une éruption intense il y a une soixantaine de millions d'années,
la lave solidifiée de basalte gris a formé ici environ 40 000 colonnes
hexagonales mises au jour par l'érosion. De telles colonnes se forment
lorsqu'il y a une contraction thermique de la lave au cours de son refroidissement,
créant des fractures régulières qui suivent des motifs géométriques
caractéristiques. |
‚ÄĘ Les
tunnels de lave sont des coulées qui se produisent lorsque la lave
en fusion continue de s'écouler tandis que la surface se refroidit et
se solidifie, cr√©ant une coque ou une cro√Ľte. Lorsque le flux de lave
diminue ou cesse, la lave restante s'√©coule hors de cette cro√Ľte, laissant
derrière elle un tunnel de lave vide. Les tunnels de lave peuvent avoir
différentes tailles et formes. Ils peuvent également comporter
des ramifications et des chambres latérales. Certains peuvent avoir des
sections o√Ļ lle passageest partiellement ou compl√®tement obstru√©. Ils
peuvent aussi contenir des stalactites et
des stalagmites form√©s par des d√©p√īts min√©raux (g√©n√©ralement
de la lave solidifiée) constitués au fil du temps.
‚ÄĘ Les lacs de
lave. - Dans certains cas, la lave avant de s'écouler ou de se refroidir
et de se solidifier, forme des lacs analogues aux lacs
ordinaires, mais composés de roche en fusion. Ces lacs peuvent se trouver
dans des cratères volcaniques, des fissures ou des dépressions sur le
flanc d'un volcan. Certains sont persistants comme celui du volcan Erta
Ale, en √Čthiopie, d'autres sont transitoires,
apparaissant au gré des éruptions. C'est le cas par exemples de ceux
du Nyiragongo, en République Démocratique du Congo, du Kilauea, à Hawaii,
ou de celui du Piton de la Fournaise, à la Réunion. La lave est généralement
composée de roches fondues riches en silice (SiO2),
comme le basalte (lave basaltique) ou l'andésite (lave andésitique).
-

| Lac
de lave au fond du cratère du stratovolcan Nyiragongo (parc national
des Virunga en République démocratique du Congo). - Le Nyiragongo
est l'un des volcans les plus actifs et dangereux d'Afrique (dernières
éruptions : 1977, 2002, 2021). Il est haut de 3470 et son cratère sommital
a un diamètre de 1,2 km et se rempli régulièrement de lave incandescente,
dont la temp√©rature d√©passe les 1000 ¬įC. Photo
: Nina R; licence : Creative Commons. |
Les types de laves dépendent
de la composition chimique du magma, qui, à son tour, influence la viscosité
et la fluidité de la lave. Plus la teneur en silice est élevée, plus
la lave est visqueuse; les laves pauvres en silice sont les plus fluides.
La lave comprend aussi des oxydes de fer, de magnésium et de calcium,
qui, eux, contribuent à la coloration de la lave (teintes sombres dans
le cas de fortes concentrations). Présents en quantités variables, l'aluminium,
potassium, le sodium, le titane, influencent
pour leur part à la fois la couleur et la composition minéralogique de
la lave. Cette composition dépend également de la rapidité de refroidissement
et de la pression à laquelle la lave s'est formée. Parmi les minéraux
courants rencontrés dans les laves on peut mentionner le basalte, l'olivine,
le pyroxène, le feldspath et la péridotite.
La lave la plus commune
sur la Terre est composée de basalte. Le basalte génère des éruptions
volcaniques préférentiellement effusives. La lave andésitique est plus
visquese que la lave basaltique et produit des éruptions modérément
explosives. La lave rhyolitique est, quant à elle, encore plus visqueuse.
Elle entra√ģne des √©ruptions tr√®s explosives et tend √† former des d√īmes
volcaniques.
Les
lahars.
Les lahars, également
connus sous le nom de déluges de boue, sont des flux de débris
volcaniques liquides (mélange de boue fluide, de fragments de roche, de
cendres, d'eau et d'autres matériaux volcaniques), qui se forment généralement
lorsque l'eau interagit avec les matériaux meubles éjectés par
une éruption. Ils peuvent être déclenchés par divers facteurs liés
à l'activité volcanique (éruptions explosives, effondrements de
d√īme, glissements de terrain), √† des pluies intenses
ou à la rapide fonte de neige et de glace
sur les flancs d'un volcan. Les lahars peuvent se déplacer à grande vitesse
(souvent de l'ordre de 30 km/h, parfois au-dessus d'une cinquantaine
de kilomètres par heure), emportant avec eux des rochers, des débris
et d'autres matériaux, causant des dommages importants aux régions environnantes.
Les projections
solides.
On appelle matériaux
pyroclastiques, ou encore scories, les produits solides, de
tailles diverses, variables aussi en composition et forme, qui sont éjectés
par les volcans lors des éruptions explosives. Il s'agit de fragments
de roches et de cendres souvent chauffés à des températures élevées
et projetés violemment dans l'air avant d'être dispersés sur des distances
plus ou moins grandes en fonction de la violence de l'éruption et des
conditions atmosphériques.
 Le
terme de téphra(s) est parfois utilisé comme synonyme de matériau
pyroclastique. Mais on réserve plus souvent ce mot pour désigner les
cendres et les tufs; les lapilli et les blocs, correspondant alors aux
pyroclastes. Le
terme de téphra(s) est parfois utilisé comme synonyme de matériau
pyroclastique. Mais on réserve plus souvent ce mot pour désigner les
cendres et les tufs; les lapilli et les blocs, correspondant alors aux
pyroclastes.
La composition des matériaux
pyroclastiques dépend du type de magma d'origine. Ils peuvent être composés
de basalte, d'andésite, de rhyolite ou d'autres types de roches volcaniques.
 Dans
certains cas, les produits éjectés sont issus d'un magma riche en gaz
(dioxyde de carbone et vapeur d'eau), qui a été libéré rapidement (souvent
par des éruptions de type péléen ou plinien), si bien que des bulles
de gaz se sont formées et sont restent piégées dans la roche lors du
refroidissement, créant une structure poreuse et légère : on a alors
affaire à des ponces, qui flottent sur l'eau,
et à des pouzzolanes qui sont plus
denses que l'eau Dans
certains cas, les produits éjectés sont issus d'un magma riche en gaz
(dioxyde de carbone et vapeur d'eau), qui a été libéré rapidement (souvent
par des éruptions de type péléen ou plinien), si bien que des bulles
de gaz se sont formées et sont restent piégées dans la roche lors du
refroidissement, créant une structure poreuse et légère : on a alors
affaire à des ponces, qui flottent sur l'eau,
et à des pouzzolanes qui sont plus
denses que l'eau
Les
cendres volcaniques.
Les cendres correspondent
à de petites particules de roches volcaniques fragmentées, souvent moins
de 2 millimètres de diamètre et ressemblant parfois à de la poussière.
Elles sont constituées de fragments de roche, de verre volcanique et de
cristaux et microcristaux minéraux. Comme elle sont légères, elles peuvent
être transportées sur de grandes distances par les vents.
Leurs d√©p√īts au sol sont souvent qualifi√© de sables volcaniques.
Les
lapilli.
Les lapilli sont
des fragments de roches plus gros que les cendres, typiquement de 2 millimètres
à quelques centimètres de diamètre, en moyenne de la taille d'une noix.
Ils sont formés par la solidification rapide de gouttelettes de lave en
suspension dans l'air pendant une éruption. Les lapilli peuvent être
constitués de matériaux vitreux et de divers types de roches volcaniques.
Les
blocs.
Les fragments de
roches encore plus gros que les lapilli prennent le nom de blocs ou de
bombes
volcaniques. Leur diamètre peut atteindre plusieurs mètres. Ils proviennent
du magma en fusion et des fragments du conduit volcanique qui sont pulvérisées
ou arrachées pendant l'éruption. Ils peuvent être incandescents à leur
sortie du volcan, et ensuite appara√ģtre comme vitreux, cristallis√©s ou
fragmentés, en fonction de leurs conditions de refroidissement et de solidification.
Les d√©p√īts pyroclastiques.
Les matériaux pyroclastiques
peuvent former des d√©p√īts sur les flancs et dans l'environnement imm√©diat
du volcan qui les a émis. Tels sont en particulier les tufs, les cinérites,
les ignimbrites, qui sont trois types de roches volcaniques sédimentaires,
aux conditions de formation différentes.
Les
tufs.
Les tufs se forment
souvent à partir de l'accumulation, la compactification et la cimentation
des d√©p√īts de cendres volcaniques et secondairement de fragments plus
gros. Certains tufs résultent du mélange de matériaux émis par le volcan
avec de l'eau, créant ainsi une sorte de boue qui se dépose et se solidifie.
La texture des tufs varie en fonction de la taille et de la forme des particules
volcaniques et de la manière dont elles se sont consolidées. Elle peut
être friable, poreuse, ou densément consolidée. Les tufs peuvent
présenter des strates résultant de différentes phases d'éruption ou
de variations dans l'intensité de celle-ci.
Les
cinérites.
Les cinérites résultent
de la consolidation de d√©p√īts principalement de cendres et de lapilli.
Elles ont souvent une texture vitreuse ou partiellement vitreuse. Ici encore,
on observe parfois des strates caractéristiques.
Les
ignimbrites.
Les ignimbrites
sont produites lors d'énormes éruptions volcaniques, souvent d'origine
explosive et r√©sultent de l'accumulation et de la consolidation de d√©p√īts
de nuées ardentes. Les ignimbrites sont souvent riches en silice. Elles
présentent souvent une texture vitreuse caractéristique ou une matrice
cristalline formée par des particules partiellement vitrifiées. Elles
peuvent former des strates distinctes, avec différentes couches correspondant
à des phases d'éruptions successives, et des marques de déformation
dues au mouvement des matériaux pyroclastiques.
Phénomènes électriques
associés aux éruptions.
Les éruptions volcaniques
peuvent être associées à divers phénomènes électriques. Les plus
évidents sont les éclairs volcaniques. Lors d'une éruption, des charges
électriques peuvent s'accumuler dans les cendres, les gaz et les particules
émises par le volcan. Ces charges génèrent alors des décharges électrostatiques
ou des éclairs volcaniques, similaires aux éclairs observés dans les
tempêtes électriques. Ces éclairs peuvent se produire à l'intérieur
du panache éruptif ou entre les particules chargées du panache et le
sol.
Certains des gaz
émis par les volcans peuvent aussi s'ioniser au contact de la chaleur
ou d'autres réactions chimiques pendant une éruption. Ces ions peuvent
générer un champ électrique localisé autour du volcan. Les cendres
et les roches rejetés par les volcans peuvent également subir des processus
de polarisation spontan√©e, entra√ģnant la g√©n√©ration de courants √©lectriques.
Enfin, l'activité volcanique peut provoquer des contraintes et des déformations
dans les matériaux volcaniques et générer alors des charges électriques
à la surface des minéraux, phénomène connu sous le nom d'effet
piézoélectrique.
Phénomènes paravolcaniques
Le paravolcanisme est
une expression de l'activité volcanique sous une forme plus calme. Il
concerne les phénomènes géologiques qui se produisent à proximité
d'un volcan actif ou dans les zones o√Ļ une activit√© volcanique est pr√©dominante,
mais sans éruption volcanique directe. Ces phénomènes sont généralement
liés à la chaleur et aux fluides (eau, gaz) émis par le magma à travers
des fissures et des fractures dans la cro√Ľte terrestre. Les zones dans
lequelles s'observe l'émanation des gaz volcaniques chauds, s'échappant
du sol forment des terrains particuliers, appelés solfatares, souvent
d'un aspect lunaire avec des d√©p√īts de soufre, des fumerolles
, de geysers, des sources chaudes acides. D'autres manifestations de dégazage
ou d'émanation de fluides chauds, dits géothermiques.
Sources chaudes.
Geysers.
Les
sources chaudes.
Une source chaude est une source naturelle
d'eau chaude De telles sources se forment lorsque de l'eau de pluie ou
de surface pénètre dans le sous-sol, est chauffée par le magma ou par
la chaleur géothermique, puis ressort à la surface. Les sources chaudes
peuvent varier en température et en composition chimique.
Les
geysers
Geyser est un mot islandais qui veut dire jaillissant. Les geysers sont des sources
qui veut dire jaillissant. Les geysers sont des sources
jaillissantes d'eau bouillante, avec dégagements
sulfureux; elles sont caractérisées par un quantité considérable de
vapeur d'eau, par l'intermittence de leur jet et par le d√©p√īt min√©ral,
calcaire
ou siliceux, souvent très abondant, qu'elles
produisent.
On rencontrent des geysers en grand nombre
en Islande, au sud de l'Hekla à environ 36 km
de ce volcan, et notamment le Grand Geyser. Celui-ci présente en
général une éruption toutes les demi-heures, et projette alors, à une
hauteur de 40-50 m, une colonne d'eau qui a près de 6 m de diamètre.
Déjà en son temps, Tyndall avait reconnu que l'éruption du grand Geyser d'Islande, se produisait
dès que la colonne d'eau soulevée par les vapeurs chaudes des profondeurs
atteignait un point dont la temperature est celle de l'ébullition. A ce
niveau précis (11 m de profondeur pour le grand Geyser), les eaux dont
la température est déjà très voisine de l'ébullition se résolvent
immédiatement en vapeur d'eau et produisent le phénomène jaillissant.
avait reconnu que l'éruption du grand Geyser d'Islande, se produisait
dès que la colonne d'eau soulevée par les vapeurs chaudes des profondeurs
atteignait un point dont la temperature est celle de l'ébullition. A ce
niveau précis (11 m de profondeur pour le grand Geyser), les eaux dont
la température est déjà très voisine de l'ébullition se résolvent
immédiatement en vapeur d'eau et produisent le phénomène jaillissant.
-
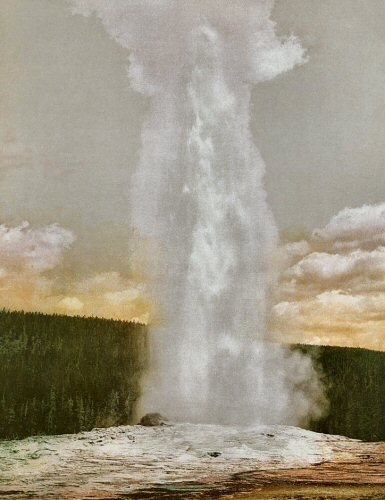
| Le
geyser Old Faithful,
dans le parc de Yellowstone, aux Etats-Unis. C'est un geyser alimenté
par une chambre magmatique profonde et des fractures dans le système hydrothermal
de Yellowstone, qui jaillit d'un c√īne en d√©p√īts min√©raux construit
par des éruptions antérieures. Il entre en éruption environ toutes
les 45 à 125 minutes, expulsant de l'eau chaude et de la vapeur à une
hauteur allant jusqu'à 56 mètres. Chaque éruption d'Old Faithful
dure généralement de 1,5 à 5 minutes. L'eau émise a une température
d'environ 204 ¬įC. |
On rencontre également des geysers
en Nouvelle-Z√©lande, o√Ļ leurs manifestations
ont plus d'intensit√©; enfin, aux √Čtats-Unis,
dans le parc national du Yellowstone, o√Ļ le ph√©nom√®ne se pr√©sente avec
une ampleur grandiose, et o√Ļ les geysers sont au nombre de quatre-vingt-quatre,
presque tous donnant un d√©p√īt siliceux; leurs eaux contiennent √©galement
du chlorure de sodium, des acides borique, sulfurique et carbonique; elles
sont alcalines.
Les principaux geysers du Yellowstone sont
: le Géant, dont les éruptions se produisent généralement par
séries et dont le jet s'élève parfois à une hauteur de 60 mètres;
le jet de la Ruche d'abeille, qui atteint 70 mètres; le Vieux
fidèle (Old Faithful) aux éruptions régulières, le geyser
Architectural,
remarquable par l'allure désordonnée de ses jets multiples, etc.
Un phénomène remarquable que présentent
ces sources, est de contenir, entre autres substances minérales, de la
silice
pure (elle rentre pour un peu plus d'un demi-millième), qui se dépose
à l'état d'hydrate sur le terrain environnant. A la base du grand geyser,
le d√©p√īt qu'elle a form√© a 4 m d'√©paisseur. Cette silice incruste les
feuilles des plantes qui croissent dans le voisinage de telle sorte que
sont conservées parfaitement les empreintes. Il existe aussi dans
l'√ģle de S√£o Miguel (A√ßores ),
des sources chaudes dont la temp√©rature s'√©l√®ve √† 97¬įC, et qui renferment
la même proportion de silice que les geysers d'Islande; mais elles ne
sont pas jaillissantes. ),
des sources chaudes dont la temp√©rature s'√©l√®ve √† 97¬įC, et qui renferment
la même proportion de silice que les geysers d'Islande; mais elles ne
sont pas jaillissantes.
Les
faux geysers.
Un faux geyser est une structure géothermique
qui peut ressembler à un geyser, mais qui n'a pas de régularité dans
ses éruptions. Contrairement aux geysers qui ont des éruptions périodiques,
les faux geysers peuvent avoir des éruptions imprévisibles ou sporadiques.
Ces éruptions peuvent être causées par des pressions variables dans
le syst√®me g√©othermique, ce qui entra√ģne des √©jections d'eau et de
vapeur à des moments irréguliers.
Les soufflards
(Suffioni).
Aux geysers se rattachent intimement les
soufflards, car ces derniers, qui consistent en jets de vapeurs toujours
chargées de gaz sulfureux, ne s'en distinguent guère que par la permanence
des dégagements. On les remarque disposés par groupes sur le trajet de
fentes ouvertes au travers du sol volcanique et toujours portées à une
temp√©rature sup√©rieure √† 100¬įC. Les mieux caract√©ris√©s sont ceux
qui, en Toscane ,
viennent se concentrer, au nombre d'une vingtaine, sur un petit espace
au Sud-Est de Volterra, près de Florence ,
viennent se concentrer, au nombre d'une vingtaine, sur un petit espace
au Sud-Est de Volterra, près de Florence ;
leur approche, signalée par d'épais nuages blancs, se traduit encore
d'une façon non moins expressive par l'odeur caractéristique de l'hydrogène
sulfuré. ;
leur approche, signalée par d'épais nuages blancs, se traduit encore
d'une façon non moins expressive par l'odeur caractéristique de l'hydrogène
sulfuré.
L'eau, très minéralisée, qui résulte
de la condensation de ces vapeurs, vient se concentrer dans des bassins
dits lagonis, envelopp√©s d'abondants d√©p√īts de soufre et surtout
de gypse fournissant l'alb√Ętre c√©l√®bre de Volterra.
Cette circonstance a de plus déterminé la présence, dans cette, région
autrefois déserte de la Maremme toscane, d'une industrie des plus prospères,
car cette eau des lagonis contient, avec de la silice libre, de
l'acide borique qu'on peut facilement extraire par évaporation en utilisant
les vapeurs chaudes du dégagement. Le sol, d'ailleurs, en est à ce point
imprégné qu'on peut, à l'aide de forages, multiplier leurs points de
sortie.
De violentes explosions, marquant le début
de la formation de ces soufflards artificiels, attestent, comme le font
les énormes ampoules qui viennent d'habitude crever à la surface de l'eau
sans cesse agitée des lagonis, que ces gaz sont toujours sous pression.
Il est du reste dans les grands centres volcaniques de Java et de la Nouvelle-Zélande
des soufflards mugissants qui se chargent de le démontrer.
Par contre, il en est de tranquilles, comme
les Ausoles de San Salvador, en Amérique
centrale, qui, ne devenant pour ainsi dire que de simples sources ascendantes
d'eaux chaudes minéralisées, établissent un lien entre les soufflards
et les sources thermo-minérales proprement dites.
Salses, salinelles
et mofettes.
Au dernier échelon des manifestations
volcaniques et paravolcaniques viennent se placer des émanations caractérisées
par leur basse température et de ce fait, qu'au lieu de substances oxydées,
elles ne contiennent plus que des hydrocarbures
gazeux ou liquides.
Les
salses et les salinelles.
Les salses, aussi
appelées volcans de boue, se présentent comme de petites collines
d'argile, tronqu√©es au sommet d'une cavit√© crat√©riforme d'o√Ļ s'√©chappe,
parfois avec projections violentes, une boue salée, de l'eau et des gaz
volcaniques. (méthane, azote, dioxyde de carbone), parfois en abondance,
ce qui justifie le nom de volcans d'air ou maccalabe qu'on
leur donne en Sicile. La boue est souvent
composée de sédiments fins, de matériaux volcaniques broyés et de l'eau
qui s'est infiltrée dans le sol.
Les salses se forment
dans des zones o√Ļ des couches souterraines de s√©diments riches en eau
et en gaz sont présentes. Lorsque la pression augmente dans ces couches,
en raison de l'activité géothermique, du magma ou de la libération de
gaz, la boue et les gaz peuvent être expulsés à la surface, formant
des c√īnes de boue caract√©ristiques. Les √©ruptions sont g√©n√©ralement
moins explosives que celles des volcans traditionnels. La boue, l'eau et
les gaz sont expulsés de manière continue ou périodique, formant des
cratères boueux qui peuvent s'élever au-dessus du sol. Les éruptions
peuvent être accompagnées de bruits de suintement, de gazouillis et de
jets de boue.
Parfois les salses
forment de grands complexes avec plusieurs cratères. Elles peuvent être
associés à des zones géothermales ou à des volcans en activité. Le
volcan de boue de Sidoarjo en Indonésie, par exemple, est un volcan de
boue en éruption depuis 2006.
Les salinelles sont des salses dont l'eau
vaseuse devient très salée, mais le plus souvent elle se charge de naphte
ou de pétrole. Alors se présentent ces fontaines ardentes dont les salsas
célèbres des Apennins, des provinces de Chausi
et du Yunnan en Chine, de l'Ouest des Etats-Unis
(oil springs) offrent de si nombreux exemples, ou, mieux encore,
quand cette fois les jets de gaz combustibles s'élèvent d'un sol sec
et pierreux, que la moindre étincelle peut enflammer, ces terrains ardents
qui pendant longtemps ont fait de Bakou (Azerba√Įdjan) la cit√© premi√®re des anciens adorateurs du feu.
(Azerba√Įdjan) la cit√© premi√®re des anciens adorateurs du feu.
Enfin, en d'autres points, c'est le bitume
qui, à son tour, peut tenir une large place dans les émanations. En Sicile,
aussi bien que dans les Apennins, de larges flaques d'asphalte noir viennent
souvent flotter à la surface des lacs boueux des
salses. En Auvergne, tout près de Clermont ,
le Puy de la Poix offre l'exemple le plus connu d'un pareil suintement
de bitume au travers de scories volcaniques, mais le principal foyer de
ce mode particulier de dégagements d'hydrocarbures, c'est la mer Morte.
En plus de cette grande salure et de cette extraordinaire richesse en brome
(1 à 7 g par litre) qui font du lac asphaltique la nappe d'eau la plus
dense qu'on connaisse (1250), les odeurs fétides (mélange de bitume et
d'hydrogène sulfuré) qui s'en dégagent, ses rochers de bordure qui de
tous c√īt√©s distillent de la poix, attestent clairement qu'on se trouve
en présence d'une immense salse. C'en est assez pour montrer que, même
à ce degré d'atténuation si accentué, les manifestations volcaniques
peuvent encore se traduire par des effets surprenants. ,
le Puy de la Poix offre l'exemple le plus connu d'un pareil suintement
de bitume au travers de scories volcaniques, mais le principal foyer de
ce mode particulier de dégagements d'hydrocarbures, c'est la mer Morte.
En plus de cette grande salure et de cette extraordinaire richesse en brome
(1 à 7 g par litre) qui font du lac asphaltique la nappe d'eau la plus
dense qu'on connaisse (1250), les odeurs fétides (mélange de bitume et
d'hydrogène sulfuré) qui s'en dégagent, ses rochers de bordure qui de
tous c√īt√©s distillent de la poix, attestent clairement qu'on se trouve
en présence d'une immense salse. C'en est assez pour montrer que, même
à ce degré d'atténuation si accentué, les manifestations volcaniques
peuvent encore se traduire par des effets surprenants.
Les
mofettes.
Il en est tout autrement quand il s'agit
des mofettes. Dans ce dernier écho d'une activité depuis longtemps endormie,
ce qui persiste généralement seul, c'est le dioxyde de carbone (CO2),
et ses exhalaisons fort simples, très caractéristiques, des régions
o√Ļ se tiennent les volcans √©teints, n'offrent de variations sensibles
que dans la façon dont se fait le dégagement. S'il s'effectue dans l'eau,
il donnera lieu √† des sources gazeuses, tant√īt tranquilles comme celle
de Nieder-Selters (Hesse-Nassau) dont la forme artificielle est connue
sous le nom fautif d'eau de Seltz, tant√īt jaillissantes comme les fameuses
gerbes de 12 à 15 m de haut des sprudels allemands. S'il se contente,
circonstance plus fréquemment réalisée, de s'échapper par les fissures
du terrain, le gaz, en raison de sa grande densité, vient étendre sur
le sol une couche irrespirable, tapisser le fond des
grottes
ou remplir les dépressions de ses émanations délétères. C'est le cas
de la ¬ę Vall√©e de la Mort ¬Ľ √† Java. Situ√©e pr√®s de la grande solfatare
du Pepandajang, cette dépression sinistre, en forme d'entonnoir renversé,
n'est autre également qu'un ancien cratère, offrant l'image de ce qu'étaient
autrefois, dans les champs Phlégréens, les lacs
avernes ,
quand ces cavités, avant d'avoir été envahies par les eaux, émettaient
de telles quantités d'acide carbonique que les oiseaux, surpris dans leur
sol, y tombaient foudroyés. ,
quand ces cavités, avant d'avoir été envahies par les eaux, émettaient
de telles quantités d'acide carbonique que les oiseaux, surpris dans leur
sol, y tombaient foudroyés.
Les champs hydrothermaux
sous-marins.
Les champs hydrothermaux
sous-marins sont des systèmes géothermiques alimentés par des fluides
chauds, riches en min√©raux dissous, qui sont √©mis √† travers la cro√Ľte
terrestre à proximité de dorsales océaniques, de zones de subduction
ou d'autres régions géologiquement actives sous les océans. Ces fluides
proviennent souvent de l'eau de mer qui s'infiltre dans les fissures et
les failles de la cro√Ľte terrestre, est chauff√©e par l'activit√© magmatique
en profondeur et est ensuite éjectée sous forme de sources chaudes, qui
peuvent elles-mêmes à l'origine de la formation des cheminées hydrothermales.
Les
cheminées hydrothermales.
Les cheminées hydrothermales
sont des structures tubulaires créées par l'émission de fluides hydrothermaux
chauds, provenant du fond de l'océan. Ces fluides hydrothermaux atteignent
des températures allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de
degrés Celsius. Ils contiennent une grande variété de minéraux dissous
provenant des roches environnantes (soufre, le fer, le zinc, le cuivre
et le plomb). -
-

| Cheminées
blanches sur le site de l'évent de Champagne, au nord-ouest du volcan
Eifuku (arc des Mariannes). - Les cheminées mesurent environ 20
cm de diam√®tre et 50 cm de hauteur et √©vacuent des fluides √† 103¬įC.
Remarquez les bulles dans la partie supérieure gauche de l'image.
Source
: Pacific Ring of Fire 2004 Expedition. NOAA Office of Ocean Exploration;
Dr. Bob Embley, NOAA PMEL, Chief Scientist. |
Lorsque ces fluides
entrent en contact avec l'eau froide de l'océan, leur refroidissement
entra√ģne la pr√©cipitation de min√©raux (souvent riches en sulfures m√©talliques,
donnant une couleur sombre à la roche), qui en se déposant forment
des cheminées. Celles-ci. peuvent varier en taille, allant de quelques
mètres à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Elles sont souvent
associ√©es √† des d√©p√īts min√©raux, formant des formations spectaculaires
comme des colonnes, des crêtes et des sculptures minérales.
+ Les
fumeurs noirs, également appelés cheminées sulfureuses, sont
des cheminées hydrothermales, qui doivent leur couleur à leur richesse
en sulfures métalliques, principalement du sulfure de fer. Ces sulfures
sont souvent de couleur sombre et donnent l'apparence de fumée noire sortant
de la cheminée.
Le volcanisme ailleurs
dans le Système solaire.
Plusieurs autres corps
du Système solaire possèdent des volcans
ou présentent des éléments de caractère volcanique. Certains sont très
similaires à ceux que l'on rencontre sur la Terre. Mais deux points peuvent
justifier de différences importantes :
‚ÄĘ La Terre
est la seule planète à posséder des plaques tectoniques en mouvement
actif. Les volcans, ailleurs dans le Système solaire, ne se forment
pas le long des limites de plaques, mais plut√īt √† travers des points
chauds ou des processus volcaniques internes.
‚ÄĘ Les satellites
des planètes géantes manifestent un volcanisme froid ou cryovolcanisme,
une forme de volcanisme qui leur est propre.
Vénus.
Les données obtenues
par les différentes missions spatiales ont révélé que Vénus
est parsemée de milliers de volcans (dont peut-être certains sont encore
actifs ou ont eu une activité récente) répartis sur sa surface. Ces
volcan, aux éruptions effusives, ont largement resurfacé la planète
en recouvrant par de la lave (généralement basaltique) les anciennes
formations géologiques.
Les volcans en bouclier
sont l'un des types de volcans les plus couramment observés sur Vénus.
Ils ont une forme similaire à ceux que l'on trouve sur Terre, mais sont
généralement plus grands. Ils s'étendent sur des centaines de kilomètres
de diamètre et atteignent des altitudes de plusieurs kilomètres. Outre
les volcans boucliers, on observe sur Vénus d'autres formations géologiques
qui peuvent ausi être attribuées à des phénomènes volcaniques, et
qui sont propres √† cette plan√®te : les d√īmes en cr√™pe (pancakes),
les couronnes (coronae), les tiques, les arachno√Įdes.
Mars.
La planète Mars
abrite certains des plus grands volcans du Système solaire.
Les éruptions volcaniques
sur Mars se sont produites il y a des millions, voire des milliards d'années.
La présence de coulées de lave baslatique assez similaire au basalte
terrestre et de cratères d'impact remplis de lave comme sur la Lune, indiquent
que les volcans martiens ont été actifs pendant une période prolongée.
 Plusieurs
systèmes volcaniques de Mars méritent une mention : Tharsis Montes,
situé dans la région de Tharsis Planitia comprend trois volcans principaux
: Arsia Mons, Pavonis Mons et Ascraeus Mons. Ces volcans sont parmi les
plus grands du système solaire, mais ils sonté passés par Olympus
Mons, qui est le plus grand de tous. Dans la région d'Elysium Planitia,
Elysium Mons est caractérisé par des évents latéraux et une caldeira
centrale. Alba Mons est situé dans la région d'Alba Patera. Il a une
forme irrégulière et présente des crevasses et des fractures sur son
flanc. Plusieurs
systèmes volcaniques de Mars méritent une mention : Tharsis Montes,
situé dans la région de Tharsis Planitia comprend trois volcans principaux
: Arsia Mons, Pavonis Mons et Ascraeus Mons. Ces volcans sont parmi les
plus grands du système solaire, mais ils sonté passés par Olympus
Mons, qui est le plus grand de tous. Dans la région d'Elysium Planitia,
Elysium Mons est caractérisé par des évents latéraux et une caldeira
centrale. Alba Mons est situé dans la région d'Alba Patera. Il a une
forme irrégulière et présente des crevasses et des fractures sur son
flanc.
 Outre
les volcans proprement dits, diverses formations gélogiques de Mars peuvent
être associées à des activités volcaniques passées. C'est le cas,
par exemple Echus Chasma, une formation de canyons qui accompagne le volcan
Hecates Tholus. Cerberus Fossae est une zone de fissures dans la région
d'Elysium Planitia qui pourrait être associée à une activité volcanique
récente. Elle présente des indices de coulées de lave et de matériaux
d'origine volcanique. Certaines régions de Mars, qualifiées de
terrains chaotiques, suggérent par leur morphologie des effondrements
de cavités souterraines formées par des éruptions de lave et d'eau.
Enfin, il existe aussi sur Mars des talus de lave, des coulées de lave,
des c√īnes de d√©bris et d'autres formations r√©sultants d'une activit√©
volcanique ancienne. Outre
les volcans proprement dits, diverses formations gélogiques de Mars peuvent
être associées à des activités volcaniques passées. C'est le cas,
par exemple Echus Chasma, une formation de canyons qui accompagne le volcan
Hecates Tholus. Cerberus Fossae est une zone de fissures dans la région
d'Elysium Planitia qui pourrait être associée à une activité volcanique
récente. Elle présente des indices de coulées de lave et de matériaux
d'origine volcanique. Certaines régions de Mars, qualifiées de
terrains chaotiques, suggérent par leur morphologie des effondrements
de cavités souterraines formées par des éruptions de lave et d'eau.
Enfin, il existe aussi sur Mars des talus de lave, des coulées de lave,
des c√īnes de d√©bris et d'autres formations r√©sultants d'une activit√©
volcanique ancienne.
Les volcans de Mars
sont principalement des volcans en bouclier, similaires aux volcans en
bouclier de la Terre et de la Lune. Ils sont caractérisés par des flancs
doux et des pentes régulières. Les éruptions ont été généralement
moins explosives que sur Terre.
-
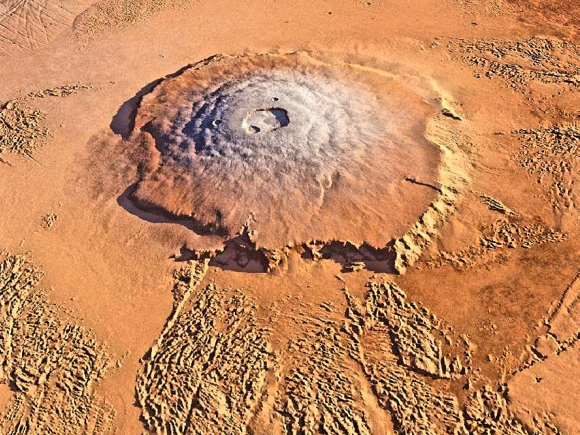
| Le
plus grand volcan du Système solaire : Olympus Mons, sur Mars. - La
planète possède plusieurs volcans géants, qui relèvent tous d'un volcanisme
de point chaud (il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars). Le principal
c√īne volcanique, Olympus Mons, mesure 23 km de haut. Il a un diam√®tre
est de 600 km (la caldeira ayant environ 70 km de diamètre) et est bordé
par un escarpement haut de 10 km. Tout autour, une s√©rie de d√©p√īts lob√©s
s'√©tend sur des centaines de kilom√®tres. Ces d√©p√īts repr√©sentent probablement
des glissements de terrain massifs résultant de l'effondrement d'un flanc
volcanique.
Source : Nasa. |
Les volcans des
planètes naines.
L'activité volcanique
sur la Lune est considérée comme éteinte depuis
des milliards d'années, mais elle a laissé de traces à sa surface. Le
volcanisme lunaire, comme celui de la Terre √©tait d√Ľ √† la mont√© en
surface de magma rocheux (essentiellement basaltique) . Il en est tout
autrement du volcanisme qui existe ou a pu exister dans les régions extérieures
du Système solaire. Les plus gros satellites des planètes géantes (trois
satellites
galiléens de Jupiter, Titan, et Triton) montrent des signes
manifestes de volcanisme. Un volcanisme pourrait aussi avoir été actif
sur Pluton.
Le volcanisme ancien
de ces corps pourrait s'expliquer par la chaleur dégagée interne liée
à la désintégration radioactive des isotopes instables qu'ils contiennent.
Cette chaleur pourrait avoir été suffisante, pendant quelque temps pour
causer une fonte partielle du matériau à l'intérieur de ces corps, générant
ainsi un magma susceptible d'alimenter des volcans.
Mais dans le cas
des satellites des planètes géantes, c'est d'autres mécanismes qu'il
convient d'invoquer. Les forces de marée dues à l'interaction gravitationnelle
avec leur planète et parfois avec d'autres satellites peuvent ainsi déformer
le satellite, générer de la chaleur et provoquer des mouvements de matière
dans ses régions intérieures et, éventuellement la formation de volcans.
La chaleur permet
ainsi l'existence des volcans de soufre d'Io. Les autres satellites, principalement
composés de glaces, sont, eux, le siège d'une forme particulière de
volcanisme, appelée cryovolcanisme. Les volcans cryovolcaniques,
également appelés volcans de glace, sont des volcans qui émettent principalement
des matériaux volatils tels que de l'eau, du dioxyde de carbone, du méthane,
de l'ammoniac ou d'autres compos√©s gel√©s plut√īt que de la lave basaltique.
Les éruptions peuvent produire des jets de gaz, de vapeur et de particules
de glace. Les substances déversées peuvent créer des montagnes de glace
et des plaines recouvertes de glace.
La
Lune.
A l'√©poque o√Ļ
la Lune était géologiquement active, de la lave basaltique a été émise
et a formé des volcans, mais aussi, lorsqu'elle était issue de
la remontée de magma le long des fissures créés par les impacts de gros
corps météoritiques, le remplissage des cavités créées par ces mêmes
impacts; processus qui a été à l'origine de la formation des mers lunaires.
Les anciens volcans
que l'on observe sur la Lune peuvent être classés en deux types principaux
: les volcans en bouclier et les volcans à cratère.
‚ÄĘ Les
volcans en bouclier sont de larges montagnes volcaniques plates et étalées.
Certains volcans en bouclier peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres
de diamètre et atteindre des hauteurs de plusieurs kilomètres.
‚ÄĘ Les volcans √†
cratère ont une forme plus conique avec un cratère au sommet. Les
volcans à cratère sont généralement plus petits, avec des cratères
de quelques kilomètres de diamètre.
Sur la Lune, des d√īmes
volcaniques similaires à ceux de la Terre ont également été identifiés.
Ces formations sont le résultat d'écoulements de lave à partir d'une
fissure volcanique et s'étend pour former une montagne basaltique en forme
de d√īme. Un exemple de d√īme volcanique lunaire est le d√īme Ina,
situé dans la région de Lacus Felicitatis.
Io.
Les volcans d'Io
sont principalement alimentés par des éruptions de soufre et de dioxyde
de soufre, qui créent des coulées de lave de soufre en fusion et des
panaches de gaz et de particules volcaniques s'élevant dans l'espace Ces
volcans de soufre sont extrêmement dynamiques. Il ont des éruptions fréquentes
et sont accompagnés de diverses autres structures volcaniques (des lacs
de soufre liquide, en particulier).
Europe.
Europe
est recouverte d'une cro√Ľte de glace et ses volcans sont des volcans
de glace d'eau. Ils projettent des jets de particules de glace d'eau
provenant de réservoirs souterrains, formant des geysers et contribuant
à la formation de fractures sur la surface de cet autre satellite galiléen.
Encelade.
Encelade,
comme Europe abrite des geysers de glace d'eau. Ceux-ci sont sont éjectés
depuis des fissures pr√®s de son p√īle Sud.
Titan.
Les volcans de Titan
émettent principalement des matériaux organiques (méthane et éthane,
principalement) sous forme de coulées liquides. Ils sont moins actifs
que ceux d'Io, mais ils jouent un r√īle essentiel dans le cycle des hydrocarbures
de ce satellite de Saturne.
Triton.
Triton,
satellite de Neptune, possède des geysers particules de glace d'azote
qui ont été observés par la sonde Voyager 2. Les éruptions de glace
d'azote contribuent à l'atmosphère de Triton et créent des formations
géologiques particulières sur sa surface.
Pluton.
Pluton
possède une source de chaleur interne due à la désintégration radioactive
de certains éléments présents dans son noyau. Cette chaleur interne
peut être suffisante pour provoquer des mouvements et des évolutions
de surface, y compris des manifestations géologiques semblables à des
volcans. Les observations de la sonde spatiale New Horizons qui
ainsi révélé des plaines glacées et des montagnes sur Pluton, pourraient
ainsi s'interpréter comme le résultat d'un cryovolcanisme ancien ou récent.
Des caldeiras, des cratères d'effondrement résultant d'éruptions volcaniques,
pourraient exister sur Pluton. Les images montrent des signes de déformations
tectoniques et de fractures sur sa surface, qui pourraient être attribuables
à des forces de pression et des mouvements de matériaux, souvent associés
aux processus volcaniques.
-
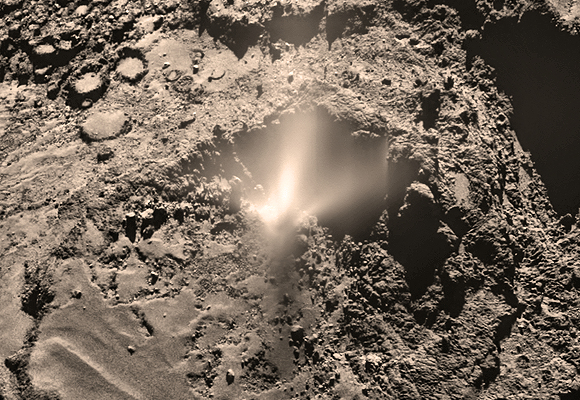
| Panache
de poussière éjecté par la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, photographié
le 3 juillet 2016 par la sonde spatiale Rosetta de l'ESA L'ombre
du panache est jetée à travers le bassin, qui se trouve dans la région
d'Imhotep. La trajectoire de Rosetta l'a conduit à travers le matériau
éjecté, permettant aux instruments de collecter des mesures
in situ
précieuses. L'analyse de ces données indique que certaines sources d'énergie
souterraines encore indéterminées ont aidé à alimenter le panache.
Crédit
: ESA/Rosetta/MPS pour l'équipe OSIRIS MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/UPM/DASP/IDA |
Les comètes.
Les noyaux cométaires
sont le siège de phénomènes que l'on peut rattacher au cryovolcanisme.
En se rapprochant du Soleil, qui réchauffe leur surface et sublime la
glace qui les compose, certaines comètes peuvent
expulser des matériaux glacés (eau, l'ammoniac, dioxyde de carbone) éventuellement
sous forme éruptive, donnant lieu ainsi à des geysers de gaz et de poussières,
dispersés ensuite dans l'espace et constituer la queue de la comète.
Cependant, on est ici assez loin de ce que l'on entend ordinairement par
volcanisme.
 |
 Philippe
Bourseiller, Catherine Guigon, La
Terre en feu, Editions de la Martinière, 2009. - Philippe
Bourseiller, Catherine Guigon, La
Terre en feu, Editions de la Martinière, 2009. -
 Jacques
Bardintzeff, Volcanologue,
de la vocation à la passion, Vuibert, 2009. Jacques
Bardintzeff, Volcanologue,
de la vocation à la passion, Vuibert, 2009.
 François Cariou, Les
Volcans, Ouest-France, 2005.
François Cariou, Les
Volcans, Ouest-France, 2005.
 Bernhard Edmaier, Volcans,
Nathan, 2005.
Bernhard Edmaier, Volcans,
Nathan, 2005.
 Patrick Barois, Guide
encyclopédique des volcans, Delachaux et Niestlé, 2004.
Patrick Barois, Guide
encyclopédique des volcans, Delachaux et Niestlé, 2004.
 Bertrand,
Mythologies
de l'Etna, Presses universitaires de Clermont-Ferrand, 2004. Bertrand,
Mythologies
de l'Etna, Presses universitaires de Clermont-Ferrand, 2004.
 Charles
Frankel, Les volcans du système solaire, Dunod, 1993. Charles
Frankel, Les volcans du système solaire, Dunod, 1993.
Pour
les plus jeunes.
 Arnaud
Guérin, Les
volcans, cracheurs de feu, Milan, 2007. Arnaud
Guérin, Les
volcans, cracheurs de feu, Milan, 2007.
 Bernhard
Edmaier, Angelika Jung-H√ľttl, Volcans, Nathan, 2004. Bernhard
Edmaier, Angelika Jung-H√ľttl, Volcans, Nathan, 2004.
|
|