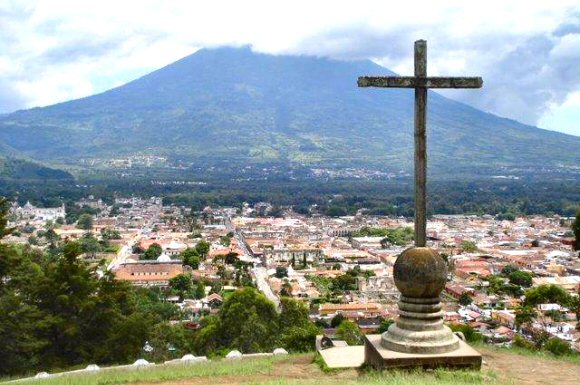15
30 N, 90 15 W |
Le Guatemala est un Etat de l'Amérique
centrale, frontalier du Mexique au Nord et Ă
l'Ouest, du Belize au Nord-Est, du Honduras
au Sud-Est, du Salvador au Sud. Sa superficie
représente 108,890 km² et sa population est de 13,3 millions d'habitants
(2009). C'est une république constitutionnelle
démocratique,
divisée en 22 départements (departaments; singulier : departamento).
La capitale est Guatemala (Guatemala la Nueva)
est un Etat de l'Amérique
centrale, frontalier du Mexique au Nord et Ă
l'Ouest, du Belize au Nord-Est, du Honduras
au Sud-Est, du Salvador au Sud. Sa superficie
représente 108,890 km² et sa population est de 13,3 millions d'habitants
(2009). C'est une république constitutionnelle
démocratique,
divisée en 22 départements (departaments; singulier : departamento).
La capitale est Guatemala (Guatemala la Nueva) .
Autres grandes villes : Quetzaltenango, Escuintla, Petén. .
Autres grandes villes : Quetzaltenango, Escuintla, Petén.

Carte
du Guatemala. Source : The World Factbook.
(Cliquer
sur l'image pour afficher une carte détaillée).
-
Les 22 départements
du Guatemala
Alta
Verapaz
Baja
Verapaz
Chimaltenango
Chiquimula
El
Progreso
Escuintla
Guatemala
Huehuetenango |
Izabal
Jalapa
Jutiapa
Petén
Quetzaltenango
Quiche
Retalhuleu
Sacatepequez |
San
Marcos
Santa
Rosa
Solola
Suchitepequez
Totonicapan
Zacapa |
GĂ©ographie physique
du Guatemala
Côtes et îles.
Le Guatemala regarde au Sud-Ouest l'océan
Pacifique, Ă l'Est la Mer des CaraĂŻbes
(océan Atlantique). La côte
du Pacifique, longue d'environ 280 km, ne compte que des baies sans importance;
les îles et les presqu'îles ne sont que d'étroits
bancs de sables. La côte est particulièrement sablonneuse; des barras
ou barres masquent l'embouchure des rivières
et en rendent l'accès difficile; la forêt commence très près du rivage;
la plaine qui sépare la côte de la sierra Madre
n'a aucune épaisseur; la montagne forme une muraille coupée par quelques
vallées; c'est pourtant sur cette côte, faisant face aux deux vallées
les plus importantes, que se trouvent Champerico et San José, les deux
ports les plus importants de la république. La côte de l'Atlantique,
longue de 150 km, forme une profonde indentation, le golfe d'Amatique que
couvre la longue péninsule de Tres Pontas.
Relief du sol.
La grande chaîne de montagnes,
qui borde au Mexique l'océan
Pacifique, après s'être abaissée à l'isthme
de Tehuantepec, se relève peu à peu et atteint au Guatemala de grandes
altitudes. La portion guatémaltèque comme plusieurs autres parties de
la chaîne porte le nom de sierra Madre (chaîne Mère). On rencontre en
entrant au Guatemala le Tocana, puis le Volcan Tajumulco (4211 m) qui est
le point culminant du Guatemala, le Cerro Quemado (3540 m), volcan
tout couvert de fumerolles
qui domine Quezaltenango, ville située à 2346 m d'altitude, le pic de
Santa Maria (3500 m) et le Santa Clara, le groupe d'Atitlan, qui comprend
un grand nombre de pics élevés et dont la plus haute cime atteint 3572
m; enfin, les deux pics jumeaux d'Acatenango (4150 m) et de Fuego (4250
m). Après ce groupe de hautes montagnes, une vaste dépression, la vallée
de Antigua Guatemala, coupe la chaîne. Dans cette première partie, les
points culminants s'élèvent très près du rebord Sud-Ouest de la chaîne
et surgissent brusquement en s'appuyant sur le mur de 2000 m de hauteur
qui tombe presque à pic sur l'Océan à peine coupé par quelques vallées
dont la plus importante est celle du rio Samala ou de Quezaltenango. A
partir de la vallée de Antigua Guatemala, la muraille qui fait face au
Pacifique est moins élevée et moins abrupte; la chaîne s'abaisse et
les pics élevés sont un peu plus éloignés de l'Océan. On trouve dans
cette partie de la chaîne les volcans de Aqua et de Pacaya. Le volcan
de Aqua est une magnifique montagne quoiqu'elle ne soit pas une des plus
élevées; à ses pieds est la ville d'Antigua Guatemala et ses flancs
sont couverts d'une riche végétation; les palmiers qui croissent à sa
base font place aux chĂŞnes, puis aux pins, Ă mesure que l'altitude augmente.-
Au Nord-Est, plusieurs chaînes courent
parallèlement à la sierra Madre et au Pacifique; ce sont les montagnes
de Vera Paz (Verapaz), massif auquel s'appuie le plateau
de Petén, prolongé par les montagnes basses du Yucatan,
les monts des MĂ©taux, les monts de Chama et de Chisee, les monts Cokscomb
(2100 m). Ces montagnes soutiennent le plateau étroit qui forme la région
peuplée et tempérée du Guatemala; leurs derniers contreforts s'abaissent
en pentes douces vers les plaines chaudes qui
bordent le Pacifique. Les monts élevés
de Grita et d'Espiritu Santo suivent la frontière qui sépare le Honduras
du Guatemala. D'une manière générale, les pentes du plateau guatémaltèque
sont peu accusées quand on les aborde du côté de la Mer
des Caraïbes; du côté du Pacifique, elles tombent brusquement sur
les plaines d'alluvion.
La sierra Madre est d'une nature volcanique;
les sommets élevés de la chaîne sont composés de tufs et de conglomérats
trachytiques
qui forment un étage de plusieurs centaines de mètres et recouvrent des
porphyres
souvent métallifères. Le sol est agité par des tremblements de terre
fréquents; vingt et un volcans donnent des traces
d'activité, fumerolles, éruptions aqueuses; des éruptions ont lieu de
temps Ă autre.
RĂ©gime des eaux.
Le Guatemala comprend deux bassins
fermés : le petit lac sans issue d'Atitlan ou Panahachel
au milieu d'un chaos de montagnes, la lagune
de Petén sur le plateau du même nom, dans la direction du Yucatan, et
trois bassins maritimes, ceux du Pacifique, de la baie d'Amatique et du
golfe de CampĂŞche. Sur le versant du Pacifique, on ne rencontre que des
cours
d'eau de peu de longueur tombant rapidement d'une hauteur de 2000 m
au niveau de la mer. Ces torrents sont du Sud au Nord : le rio Paz, le
rio de los Esclavos que traverse la route de Guatemala Ă San Salvador
sur un pont à sept arches, célèbre dans l'Amérique
centrale; le rio Michatoya, qui reçoit les eaux du beau lac d'Atitlan
et forme une chute de 60 m de haut; le rio Gualacate, qui descend de la
vallée d'Antigua Guatemala; le rio Naguelate, le rio Samala, qui descend
de la vallée de Quezaltenango; le rio Chiapan. Contre la frontière du
Salvador, le lac Guija emprunte au Guatemala les eaux de plusieurs petits
torrents qu'il verse dans le rio Lempa.
-
La baie d'Amatique reçoit deux fleuves principaux
: le Motagua, qui descend des altos ou montagnes du massif de Quezaltenango,
malgré son cours de 550 km, n'est guère navigable et seulement sur un
parcours de 200 km qu'aux parques ou bongos; il reçoit comme
principal affluent le Gualan. Le Polochic est plus navigable; il tombe
par sept bouches dans le lac d'lzabal ou Goffo dulce (golfe d'eau douce).
Le lac d'lzabal est relié à la mer par un pittoresque canal de 20 km
de long, la Angostura, bordé par des rochers à pic de 90 à 120 m de
haut, qui servait autrefois de voie commerciale pour pénétrer dans l'intérieur.
Au Nord du Guatemala, le rio Usumacinta
emporte vers la baie de CampĂŞche, oĂą il se joindra au delta
du Grijalva, les eaux du rio Lacandones, du rio de la Passion. Il reçoit
un grand nombre d'affluents. Toute cette partie Nord et Nord-Est du Guatemala
est chaude, humide, couverte de lagunes, entièrement boisée. Les eaux
qui ne vont pas à l'Usumacinta forment la lagune de Petén.
Climat.
Le climat est sec dans la plaine très
Ă©troite du Pacifique. Tout le reste du
Guatemala est situé dans une région pluvieuse où il tombe plus de 2
m d'eau. On y retrouve la division du sol en tierras calientes,
tierras
templadas et tierras frias. Dans les terres chaudes (jusqu'Ă
1000 m), la température est humide et excessive, la végétation tropicale;
la température moyenne est de 31 °C. Les terres tempérées (de 1000
à 2000 m) sont presque seules peuplées et contiennent toutes les villes
importantes; la température moyenne est de 23 à 25 °C. Les terres froides
forment la région des pins. Il y a deux saisons au Guatemala, l'été
ou saison des pluies (tiempo de aguas) et
l'hiver ou saison sèche (tiempo de secas).
Les deux vents principaux sont le vent du Nord,
chaud et humide, et le vent du Sud, sur la cĂ´te du Pacifique. (GE).
Risques naturels.
La géologie du
Guatemala, situé à la confluence des plaques tectoniques nord-américaine,
caraïbe et de Cocos, explique la forte sismicité et l'activité volcanique.
Le pays est régulièrement frappé par des tremblements de terre puissants,
souvent associés à l'activité volcanique. De plus, sa situation géographique
et sa topographie le rendent vulnérable à d'autres risques naturels,
notamment les ouragans et les tempĂŞtes tropicales (qui peuvent provoquer
des inondations dévastatrices et des glissements de terrain dans les zones
montagneuses), ainsi que les glissements de terrain et les coulées de
boue, particulièrement fréquents pendant la saison des pluies dans les
régions à forte pente.
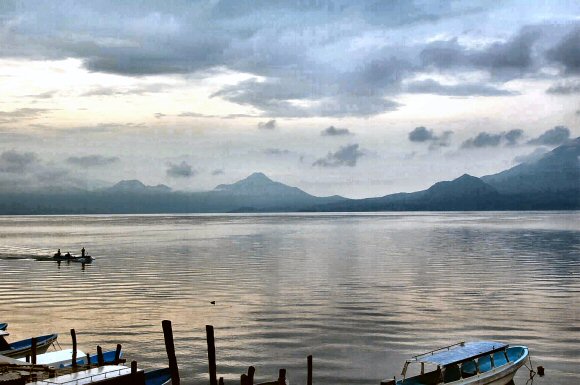
Le
lac Atitlan, au Guatemala. Images : The World
Factbook.
Biogéographie du Guatemala
Le territoire guatémaltèque
se divise en plusieurs grandes régions biogéographiques distinctes. La
côte Pacifique est caractérisée par une plaine côtière étroite mais
fertile, historiquement couverte de forêts sèches tropicales et de savanes,
aujourd'hui largement convertie en terres agricoles (canne à sucre, café,
coton) et pâturages. Les zones côtières abritent des mangroves
et des zones humides importantes, jouant
un rôle crucial pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et résidentiels,
ainsi que des crustacés et poissons. Le climat y est chaud et humide,
avec une saison des pluies marquée.
Remontant vers l'intérieur,
on rencontre la chaîne volcanique, partie de l'arc volcanique d'Amérique
Centrale, qui constitue l'Ă©pine dorsale du pays et abrite les plus hauts
sommets, dont le Tajumulco. Cette région est le théâtre d'une remarquable
zonation altitudinale. À basse et moyenne altitude sur les flancs volcaniques,
on trouve des forêts humides ou semi-décidues, laissant place à des
plantations de café à mesure que l'altitude augmente et que le climat
devient plus frais. Plus haut encore, entre 1800 et 3000 mètres, se déploient
les forĂŞts de pins et de chĂŞnes, ainsi que des zones de broussailles
et de prairies d'altitude. Au-delà de 3000 mètres, la végétation se
raréfie pour laisser place à une végétation subalpine et alpine sur
les sommets les plus élevés, bien que peu étendue.
Les hautes terres
centrales, situées entre la chaîne volcanique et les plaines du Petén
au nord, présentent un paysage de montagnes, plateaux et vallées, avec
des climats variés allant du tempéré frais en altitude à des conditions
plus sèches dans certaines vallées intérieures (l'Oriente, par exemple).
Cette diversité a favorisé le développement d'écosystèmes variés,
qui comprennent des forĂŞts de nuages (forĂŞts
de montagne humides), particulièrement riches en épiphytes comme les
orchidées et les broméliacées, ainsi qu'une faune unique, notamment
le Quetzal resplendissant, oiseau emblématique associé à ces forêts.
Les forêts de pins et de chênes sont également très présentes dans
cette région. Elles sont adaptées à des sols plus secs ou perturbés.
L'agriculture y est également intensive, et modèle significativement
le paysage.
Vers l'est, la région
du Caribéen est caractérisée par des basses terres humides recevant
d'importantes précipitations toute l'année. La végétation dominante
est la forêt tropicale humide de basse altitude. Cette région abrite
des écosystèmes fluviaux (Rio Dulce, Lac Izabal) et côtiers (mangroves,
marais), avec une biodiversité différente de celle du Pacifique ou des
hautes terres, et comprend des espèces adaptées à un environnement plus
saturé en eau.
Enfin, la vaste région
septentrionale du Petén, couvrant près d'un tiers du territoire, est
majoritairement constituée de basses terres calcaires. Le climat y est
tropical chaud et humide, avec une saison sèche marquée. C'est ici que
l'on trouve la plus grande Ă©tendue de forĂŞt tropicale humide au Guatemala,
partie intégrante de la Selva Maya, la plus grande étendue de forêt
tropicale restante en Amérique du Nord. Cette forêt est caractérisée
par une grande diversité d'arbres de canopée, un sous-bois dense, et
abrite une faune spectaculaire ( jaguars, tapirs, singes, toucans et une
multitude d'insectes et de reptiles). Le Petén comprend également des
zones de savanes et de forêts inondées (les bajos). L'histoire
humaine y est profondément imbriquée dans la nature, avec de nombreux
sites archéologiques Mayas (Tikal, El Mirador).
Cette mosaĂŻque d'habitats
– forêts tropicales humides et sèches, forêts de nuages, forêts de
pins-chênes, zones alpines, savanes, mangroves, lacs et rivières –
confère au Guatemala un niveau de biodiversité exceptionnel, le plaçant
parmi les hotspots de biodiversité mondiale. La richesse spécifique
est particulièrement élevée chez les oiseaux, les amphibiens et les
reptiles, avec un taux d'endémisme notable, surtout dans les écosystèmes
isolés ou d'altitude comme les forêts de nuages.
Cependant, cette
richesse est sous forte pression anthropique. La déforestation, l'expansion
agricole, la fragmentation des habitats, la croissance démographique,
le trafic d'espèces sauvages et les effets du changement climatique menacent
sérieusement de nombreux écosystèmes et espèces. Des efforts de conservation
sont déployés, notamment à travers la création de parcs nationaux,
de réserves biosphères (comme la Réserve de biosphère Maya) et d'autres
aires protégées, mais les défis demeurent immenses pour préserver ce
patrimoine naturel d'une valeur inestimable pour le Guatemala et pour le
monde.
GĂ©ographie humaine
du Guatemala
Population.
Le Guatemala est
le pays le plus peuplĂ© de la rĂ©gion, avec une population estimĂ©e Ă
plus de 17 millions d'habitants. Il se caractérise par une forte proportion
de la population qui a moins de 30 ans, ce qui pose des défis considérables
en termes d'emploi, d'éducation et de services sociaux. Le taux de natalité,
bien qu'en légère baisse, reste relativement élevé par rapport à d'autres
pays d'Amérique Latine. L'espérance de vie est plus basse que la moyenne
régionale, notamment en raison de problèmes de santé liés à la pauvreté
et à un accès inégal aux soins médicaux. La répartition géographique
de la population montre une concentration croissante dans les zones urbaines,
en particulier dans l'aire métropolitaine de la capitale, Guatemala City,
bien qu'une part significative de la population réside encore en milieu
rural.
Le pays est caractérisé
par une stratification sociale très prononcée, où l'appartenance ethnique
se superpose largement aux clivages de classe. Les populations autochtones,
particulièrement celles résidant dans les zones rurales, sont surreprésentées
parmi les plus pauvres et les plus marginalisées. Elles font face à des
discriminations systémiques en matière d'accès à la terre, à l'éducation,
à la santé, à la justice et à la représentation politique. Le taux
de pauvreté général est élevé, et la pauvreté extrême touche de
manière disproportionnée les populations autochtones rurales. Cette inégalité
socio-économique est l'héritage d'une histoire longue de domination et
du conflit armé interne (1960-1996) qui a eu des conséquences dévastatrices,
en particulier pour ces populations, cibles principales des violences Ă©tatiques.
L'urbanisation rapide
et l'émigration massive, en particulier vers les États-Unis, a transformé
les tructures familiales traditionnelles et entraîné parfois la séparation
des familles et posant de nouveaux défis sociaux, bien que les envois
de fonds des émigrés constituent une source de revenus vitale pour de
nombreuses familles et pour l'Ă©conomie nationale.
Aujourd'hui, le Guatamala
reste confronté à des niveaux élevés de violence et de criminalité,
souvent liés au trafic de drogue, aux gangs (maras) et à une culture
de l'impunité. Cette insécurité a un impact profond sur la vie quotidienne
des citoyens, sur la cohésion sociale et sur les perspectives de développement.
L'accès à des services publics de qualité, tels que l'éducation et
la santé, reste inégalitaire, avec des disparités marquées entre les
zones urbaines et rurales, et entre les populations ladinas et autochtones.
Le système éducatif, bien qu'en expansion, peine à fournir une éducation
pertinente et de qualité pour tous, et les taux d'analphabétisme sont
plus élevés parmi les femmes autochtones rurales. De même, le système
de santé est sous-financé et l'accès aux soins de base est difficile
pour une grande partie de la population.
Quelques-unes
des principales villes du Guatemala
| •
Ciudad
de Guatemala (Guatemala City). - Capitale et plus grande
métropole du pays, la ville de Guatemala concentre l'essentiel de l'activité
politique, économique et culturelle. C'est une ville vaste, parfois décrite
comme chaotique et animée, avec un trafic intense. Elle est divisée en
zones distinctes, allant du centre historique (Zone 1) avec ses bâtiments
gouvernementaux et religieux, aux quartiers modernes et aisés (Zones 10,
14, 15) abritant des centres d'affaires, des centres commerciaux et des
restaurants. Malgré les défis liés à la criminalité et à la pollution,
la ville est un moteur de développement et un carrefour de transport national.
Moins pittoresque que d'autres destinations, elle possède toutefois des
musées (musée national d'archéologie et d'ethnologie, musée Ixchel
du vêtement indigène), des galeries d'art et des lieux de vie nocturne.
• Antigua Guatemala,
située à une courte distance à l'ouest, dans une vallée entourée de
volcans majestueux (Agua, Fuego, Acatenango), est l'ancienne capitale
du royaume de Guatemala. Elle a été largement détruite par un tremblement
de terre en 1773, mais ses ruines et son architecture coloniale bien conservée
lui ont valu d'être classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Flâner
dans ses rues pavées, bordées de maisons colorées, visiter ses églises
et couvents en ruine, et admirer les volcans en toile de fond sont les
principales attractions. Antigua est un centre touristique majeur, qui
offre une atmosphère plus détendue que la capitale, de nombreux hôtels
de charme, restaurants, cafés et écoles d'espagnol, tout en conservant
un riche héritage historique et culturel.
•
Quetzaltenango,
communément appelée Xela (prononcé shéla). C'est la deuxième
ou troisième plus grande ville du Guatemala et un centre économique et
culturel vital pour la rĂ©gion de l'AltĂplano. Xela est situĂ©e Ă une
altitude plus élevée qu'Antigua ou Ciudad de Guatemala, ce qui lui confère
un climat plus frais. Elle est réputée pour être un centre d'apprentissage
de l'espagnol, qui attire de nombreux étudiants étrangers. Xela possède
une forte identité culturelle indigène, visible dans ses marchés locaux
et la présence de populations K'iche' et Mam. Bien qu'elle possède aussi
une belle architecture néoclassique autour de son Parque Central, son
charme réside davantage dans son atmosphère authentique, moins orientée
vers le tourisme de masse qu'Antigua, et dans sa position stratégique
pour visiter les villages indiens environnants, les volcans et les sources
chaudes.
• Escuintla,
sur la plaine côtière sud, est un centre agro-industriel majeur, notamment
dans la production de sucre, de bananes et de café. Grâce à sa proximité
avec le port de Puerto Quetzal et la capitale, elle joue un rôle clé
dans la logistique et l'exportation. Escuintla est également exposée
aux risques volcaniques et sismiques, mais sa position géographique stratégique
en fait un pivot de l'économie guatémaltèque.
• Cobán,
située dans le département d'Alta Verapaz, se signale par ses paysages
verdoyants, ses plantations de café, et sa culture q'eqchi' maya. Elle
est un centre régional du tourisme écologique, avec des sites renommés
comme Semuc Champey et les grottes de LanquĂn. Son climat humide, ses
traditions culturelles et son dynamisme agricole lui confèrent une importance
grandissante dans la région centrale du pays. |
•
Chiquimula
est une ville de l'est du Guatemala, proche de la frontière avec le Honduras.
Elle constitue un point de passage important pour le commerce transfrontalier
et joue un rôle régional en matière de services, de santé et d'éducation.
Elle est surnommée la Perla de Oriente et bénéficie d'un climat chaud
et sec. Elle est également un bastion de l'identité métisse et ladina
de l'est guatémaltèque.
• Huehuetenango,
proche de la frontière mexicaine, est une ville d'altitude caractérisée
par sa diversité ethnique, avec une forte population mam et d'autres groupes
mayas. C'est un carrefour stratégique pour le commerce régional et l'accès
aux marchés mexicains. La ville est également le siège de projets éducatifs
et agricoles, avec une croissance soutenue malgré les défis logistiques
imposés par le relief montagneux.
• Puerto Barrios
est le principal port caraïbe du pays, situé dans le département d'Izabal.
Il joue un rĂ´le majeur dans le commerce maritime et constitue un point
de contact avec la mer des Caraïbes. La ville est également connectée
Ă Livingston et au fleuve Dulce, ce qui en fait une Ă©tape touristique
importante. Sa population est fortement influencée par la culture afro-caribéenne
(Garifunas).
• Santa LucĂa
Cotzumalguapa est une ville importante dans le sud-ouest agricole du
pays. Elle est connue pour ses plantations de canne Ă sucre et ses sites
archéologiques précolombiens liés à la civilisation de Cotzumalguapa.
Bien que moins connue que d'autres villes, elle joue un rĂ´le significatif
dans l'Ă©conomie rurale du pays.
• Totonicapán
est une ville des hauts plateaux occidentaux, très enracinée dans la
culture k'iche'. Elle est un centre de production artisanale, de textiles
traditionnels, et elle est réputée pour sa forte organisation communautaire
indigène. Totonicapán symbolise la résistance culturelle et politique
maya contemporaine et maintient un lien Ă©troit avec ses traditions ancestrales.
• Jalapa,
dans la région sud-est, est une ville moyenne au climat tempéré et propice
Ă l'agriculture. Elle est connue pour sa production de lait, de fruits
et de légumes, ainsi que pour sa vie communautaire paisible. Bien qu'elle
ne soit pas un centre industriel majeur, Jalapa est vitale pour l'alimentation
de nombreuses régions du pays.
• Zacapa,
une ville située dans une vallée sèche de l'est, est réputée pour
sa production de rhum, son élevage de bétail et ses fruits tropicaux.
Sa position géographique lui donne un rôle dans la liaison entre la capitale
et le Honduras, en particulier via la route Atlantique. Elle incarne l'identité
culturelle de l'Oriente guatémaltèque.
• Flores
est une ville pittoresque, Ă l'extrĂŞme nord du Guatemala, qui sert
de porte d'entrée au majestueux site de Tikal. Sa particularité réside
dans le fait qu'elle est située en partie sur une petite île au milieu
du Lac Petén Itzá, reliée au continent par une courte chaussée. Flores
est une ville colorée avec des rues étroites et pentues, bordées d'hôtels,
de restaurants et de cafés touristiques. C'est principalement une base
pour les voyageurs se rendant aux ruines Maya de Tikal, l'un des sites
archéologiques les plus importants d'Amérique Centrale. L'atmosphère
sur l'île est très détendue et tropicale, contrastant avec l'agitation
de la capitale ou l'austérité relative des hautes terres. |
Groupes ethnolinguistiques.
On peut distinguer
principalement trois grands groupes, au sein desquels existent de nombreuses
subdivisions : les peuples autochtones (majoritairement Maya, mais aussi
Xinca), la population Ladino/Mestizo, et le groupe Garifuna. La population
autochtone représente une part très importante du total. Elle est estimée
à environ 40-50%, voire plus selon les sources et les critères de recensement.
L'histoire de la coexistence de ces divers groupes est marquée par des
inégalités, le racisme systémique et la marginalisation des peuples
autochtones et Garifuna.
Maya.
Loin de former une
entité monolithique, les populations Maya actuelles se répartissent en
de nombreux groupes distinctes, chacun possédant ses propres traditions,
coutumes et, élément central de leur identité, sa propre langue. Le
Guatemala reconnaît officiellement 22 langues
mayas différentes, ainsi que la langue achi (souvent considérée
comme très proche du K'iche'). Cette diversité linguistique est frappante
: on trouve des groupes comme les K'iche', historiquement l'un des plus
puissants Etats Maya, dont la langue est aujourd'hui parlée par plus d'un
million de personnes, principalement dans les départements du Quiché,
Sololá et Totonicapán. Les Q'eqchi' forment également un groupe très
nombreux et dont la langue est largement répandue dans le Petén, l'Izabal,
l'Alta Verapaz et certaines parties du Quiché. Parmi d'autres groupes
importants sont les Kaqchikel, présents dans les régions proches de la
capitale et autour du Lac Atitlán, les Mam dans l'ouest du pays (Huehuetenango
et San Marcos), les Tz'utujil autour du Lac Atitlán, ainsi que de nombreux
autres comme les Poqomchi', Ixil, Q'anjob'al, Chuj, Akatek, Jakaltek, etc.,
chacun avec sa zone géographique prédominante, ses variantes culturelles,
ses formes d'organisation sociale, et ses magnifiques trajes (vĂŞtements
traditionnels) souvent spécifiques à chaque village. Malgré cette diversité,
ces groupes partagent des éléments culturels communs, une profonde religiosité
liée à la nature et aux ancêtres, un artisanat riche (notamment le tissage),
et une histoire de résilience face aux siècles de marginalisation et
de discrimination depuis la conquĂŞte espagnole.
Xinca.
Parallèlement aux
peuples Maya, on trouve un autre groupe autochtone distinct : les Xinca.
Leur présence est concentrée dans le sud-est du pays. Linguistiquement,
ils sont totalement distincts des Maya. Leur langue appartient Ă une famille
linguistique isolée, aujourd'hui en danger critique d'extinction, bien
que des efforts soient faits pour la revitaliser. La culture xinca a été
fortement impactée par la ladinisation.
Ladino.
Le groupe démographique
majoritaire au Guatemala est la population Ladino, qui représente environ
50 à 60% de la population totale. Ce terme désigne généralement les
personnes de langue espagnole qui ne
s'identifient pas comme autochtones. Il englobe Ă la fois les personnes
métisses (descendants d'unions entre Espagnols et autochtones) et, dans
un sens culturel, les personnes d'ascendance principalement européenne
ou autre qui ont adopté la culture dominante hispanophone. Les Ladinos
sont présents dans tout le pays, majoritaires dans les zones urbaines
et les départements de l'est, mais également dans les zones rurales.
Historiquement, ils ont souvent détenu le pouvoir politique et économique
au Guatemala. Leur culture est un mélange d'influences espagnoles et autochtones,
mais centrée sur la langue et les traditions hispaniques. Il existe bien
sûr une grande diversité socio-économique et culturelle au sein même
de la population ladina.
Garifuna.
Enfin, un groupe
plus petit mais culturellement très actif est celui des Garifuna. Ils
résident principalement sur la côte caraïbe du Guatemala, notamment
dans la ville de Livingston. Les Garifuna sont les descendants de populations
africaines et d'indigènes Caraïbes et Arawak des Caraïbes, arrivés
au Guatemala au début du XIXe siècle.
Ilsparlent le garifuna (une langue arawak avec de fortes influences africaines),
et une culture distincte caractérisée par une musique (comme la punta),
des danses, une cuisine et des pratiques religieuses qui les différencient
clairement des populations Maya, Xinca ou Ladino.
-
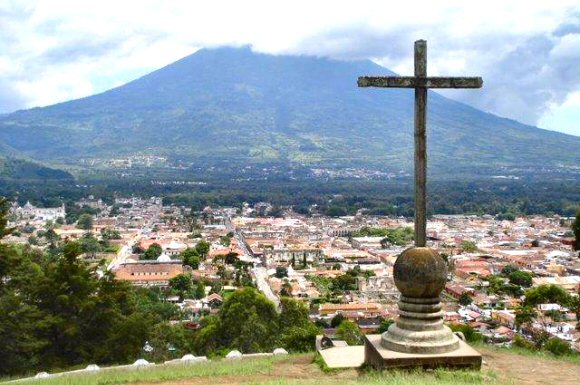
La
ville d'Antigua, Ă une heure de route de Guatemala City, sur les hautes
terres.
Au
fond, le volcan de Agua.
Culture.
Le pays, on l'a
dit, est majoritairement peuplé de deux grands groupes culturels : les
peuples autochtones, principalement d'ascendance maya (comprenant diverses
ethnies comme les K'iche', Kaqchikel, Mam, Q'eqchi', etc.), et les Ladinos,
terme désignant la population métisse ou hispanisée. Cette distinction
n'est pas seulement ethnique mais aussi culturelle, se manifestant dans
les langues parlées, les modes de vie, les croyances et les expressions
artistiques. Si l'espagnol est la langue officielle, plus d'une vingtaine
de langues mayas sont toujours vivantes et constituent un pilier essentiel
de l'identité de nombreuses communautés.
La religion occupe
une place centrale dans la vie guatémaltèque. Le catholicisme, introduit
par les Espagnols, est la religion dominante, mais il est généralement
teinté d'un syncrétisme fort avec les croyances et rituels mayas ancestraux.
On observe des pratiques oĂą les saints catholiques coexistent avec les
divinités et les forces de la nature vénérées traditionnellement. Les
cérémonies mayas traditionnelles continuent d'être pratiquées, habituellement
en parallèle des offices religieux. Parallèlement, le protestantisme
a connu une croissance rapide ces dernières décennies.
Les traditions rythment
la vie quotidienne et les célébrations. Les fêtes patronales dédiées
aux saints protecteurs des villes et villages sont l'occasion de grandes
festivités qui mêlent processions religieuses, musique, danse, feux d'artifice
et foires. La Semaine Sainte à Antigua Guatemala est particulièrement
célèbre pour ses tapis de fleurs et de sciure colorée éphémères et
ses processions solennelles. Les marchés (los mercados) ne sont
pas de simples lieux de commerce mais de véritables centres sociaux où
les gens se rencontrent, Ă©changent et maintiennent les liens sociaux.
L'artisanat est l'un
des piliers de la culture matérielle, mondialement reconnu pour sa qualité
et sa beauté. Les textiles mayas, notamment les huipiles (chemisiers
traditionnels portés par les femmes), sont célèbres pour leurs couleurs
vives, leurs motifs complexes et symboliques qui varient d'une région
et d'un groupe Ă l'autre. Chaque motif, chaque couleur peut raconter une
histoire, indiquer l'origine de la porteuse ou transmettre des messages.
La poterie, la sculpture sur bois, la vannerie, la fabrication de masques
rituels et le travail du jade sont d'autres formes d'artisanat importantes.
L'instrument de musique
national est la marimba, dont le son mélodieux accompagne fêtes,
célébrations et moments du quotidien. La musique traditionnelle maya
utilise des instruments comme la flûte, le tambour et la guitare. Les
genres modernes, comme la cumbia, la salsa, le merengue
et le rock, sont également très populaires.
La gastronomie guatémaltèque,
à base de maïs, d'haricots et de piments, intègre des influences précolombiennes
(comme les tamales, les différents recados ou sauces épaisses)
et espagnoles (l'utilisation de viandes, de riz, d'Ă©pices). Des plats
comme le pepián et les subaniks (ragoûts épicés) ou le
jocĂłn
(poulet en sauce verte) sont des exemples de cette cuisinel.
Economie.
L'Ă©conomie du Guatemala
est la plus importante d'Amérique Centrale en termes de produit intérieur
brut (PIB). Traditionnellement basée sur l'agriculture, elle a connu une
diversification notable au cours des dernières décennies, avec une part
croissante des services et de l'industrie. Cependant, l'agriculture reste
un secteur clé, et contribue de manière significative aux exportations
et Ă l'emploi, notamment en milieu rural. Les principaux produits agricoles
exportés sont le café, la canne à sucre, les bananes, le cardamome et
divers fruits et légumes. Ce secteur est vulnérable aux variations des
prix mondiaux des matières premières et aux conditions climatiques.
Le secteur industriel
s'est développé, en particulier dans le domaine de la fabrication légère,
notamment le textile et l'habillement, généralement dans le cadre de
maquiladoras
bénéficiant de l'accès préférentiel aux marchés, en particulier aux
États-Unis
grâce à l'accord de libre-échange CAFTA-DR (Accord de libre-échange
d'Amérique centrale-République dominicaine). D'autres industries concernent
la transformation des aliments, la fabrication de matériaux de construction
et l'assemblage de produits manufacturés.
Le secteur des services
est désormais le plus important contributeur au PIB guatémaltèque. Il
englobe le commerce, les transports, les communications, la finance, l'administration
publique et le tourisme. Le tourisme, en particulier, motivé par la richesse
culturelle (sites mayas comme Tikal) et les paysages naturels du pays,
représente une source importante de devises étrangères. Un moteur économique
essentiel et une source de revenus vitale pour de nombreuses familles guatémaltèques
sont les envois de fonds (remesas) des émigrés, principalement
établis aux États-Unis. Ces transferts constituent une part significative
du PIB et un soutien majeur à la consommation privée. Ils joue un rôle
important dans la balance des paiements et la résilience de l'économie
face aux chocs externes.
L'économie guatémaltèque
est relativement ouverte et fortement intégrée dans les échanges régionaux
et internationaux. Ses principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis,
les pays d'Amérique Centrale et le Mexique.
Les exportations sont dominées par les produits agricoles et les textiles,
tandis que les importations comprennent principalement des biens d'Ă©quipement,
des matières premières, des carburants et des biens de consommation.
Le pays a généralement
maintenu une stabilité relative au cours des dernières années, avec
une inflation modérée et une monnaie (le quetzal) qui a montré une stabilité
appréciable. La politique monétaire est gérée par la Banque du Guatemala
(Banco de Guatemala) avec un objectif de stabilité des prix. Cependant,
la politique budgétaire est contrainte par une base fiscale relativement
faible, qui limite la capacité du gouvernement à investir massivement
dans les infrastructures, l'éducation, la santé et les programmes sociaux.
La dette publique est gérée, mais l'espace budgétaire pour des dépenses
de développement ou de relance est limité.
Malgré une croissance
économique souvent positive, le Guatemala est confronté à des défis
structurels majeurs. Le taux de pauvreté est élevé, particulièrement
dans les zones rurales et parmi les populations autochtones, et l'inégalité
de revenus est l'une des plus marquées d'Amérique Latine. Le secteur
informel représente une large part de l'emploi, et offre peu de sécurité
sociale et de droits aux travailleurs. D'autres défis sont la vulnérabilité
aux catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre), des problèmes
persistants de gouvernance, la corruption, l'insécurité et un environnement
des affaires qui, bien qu'en amélioration, peut encore être entravé
par des facteurs institutionnels et bureaucratiques. Ces éléments freinent
l'investissement privé et la capacité du pays à réaliser son plein
potentiel économique et social. La dépendance aux envois de fonds et
aux exportations de quelques produits rend Ă©galement l'Ă©conomie sensible
aux conditions économiques externes, notamment aux États-Unis. |
|