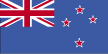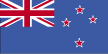
41
00 S, 174 00 E |
La Nouvelle-Zélande,
pays membre du Commonwealth, est un grand archipel du Pacifique
Sud découvert en 1642 par Tasman ,
et situé au Sud-Est de l'Australie.
Il est composé principalement de deux grandes îles-:
l'île du Nord ou Ika-Namawi (833 km de long) et l'île
du Sud ou Tavaï-Pounamou, séparées par le détroit
de Cook. Ces îles sont traversées, toutes deux du Nord-Est
au Sud-Ouest, par de grandes chaînes de montagnes couvertes de forêts
où se voient de nombreux volcans éteints et en activité
(tremblements de terre fréquents). Elles ont ensemble à peu
près l'étendue de la Grande-Bretagne. On y trouve de riches
mines d'or, surtout dans l'île du Sud, dans le district d'Otago,
et de la houille dans l'île du Nord. ,
et situé au Sud-Est de l'Australie.
Il est composé principalement de deux grandes îles-:
l'île du Nord ou Ika-Namawi (833 km de long) et l'île
du Sud ou Tavaï-Pounamou, séparées par le détroit
de Cook. Ces îles sont traversées, toutes deux du Nord-Est
au Sud-Ouest, par de grandes chaînes de montagnes couvertes de forêts
où se voient de nombreux volcans éteints et en activité
(tremblements de terre fréquents). Elles ont ensemble à peu
près l'étendue de la Grande-Bretagne. On y trouve de riches
mines d'or, surtout dans l'île du Sud, dans le district d'Otago,
et de la houille dans l'île du Nord.
-
|
Les îles
de la Nouvelle-Zélande
|
| Grandes
îles |
Ile
du Nord (Te Ika-a-Maui = le poisson de Maui).
Ile
du sud (Te Wai Pounamu = les eaux de Jade). |
| Iles
du Sud-Ouest |
Ile
Stewart ( île Rariouka), The Snares, Iles Auckland, Iles Campbell. |
| Iles
de l'Ouest |
Iles
des Antipodes, Iles Bounty, Iles Chatam, Iles Kermadec. |
| N.B.
- Niue, les îles Cook
et Tokelau ont à des degrés divers
des liens de dépendance avec la Nouvelle-Zélande. |
|
--

Auckland,
la plus grande ville de Nouvelle-Zélande,
dans l'île du Nord.
Près
du tiers de la population du pays y habite.
L'île du Nord, de
forme tourmentée, est constituée par un plateau élevé
que couronnent des volcans : le Tongariro (2248 m), le Rouapehou (2804
m), groupe de cônes dont le cratère principal enferme un lac.
Les nappes lacustres sont d'ailleurs nombreuses. Au centre même de
l'île, à 351 mètres d'altitude, le lac Taupo (775 km²)
étale au pied des grands sommets la belle nappe bleue de ses eaux;
son émissaire, le Waikato, est le principal cours d'eau néo-zélandais.
La beauté des montagnes volcaniques, celle des geysers, a fait appeler
l'île du Nord la « Terre des Merveilles ».
L'île du Sud possède
une ossature constituée par une large chaîne orientée
Sud-Ouest-Nord-Est les Alpes néo-zélandaises, où l'on
trouve de hautes montagnes : l'Aspiring (3030 m), le mont Cook (3775 m),
dont les immenses névés s'épanchent en magnifiques
fleuves de glace : celui de Tasman est un vrai glacier alpestre de 19 kilomètres
de long. La chaîne descend à l'Est, par de multiples chaînons,
sur la côte orientale et la vaste plaine de Canterbury (220 km de
long sur 60 km de large), puis elle se brise et remonte avec le Franklin
à une altitude de 3050 mètres environ, pour atteindre en
déclinant le cap Farewell.
Toute l'île du Sud a été
modelée par les glaciers qui l'ont entièrement recouverte.
A l'intérieur, ils ont marqué la trace de leur passage par
d'innombrables lacs (Tekapo, Manipori, Wakatiko), allongés, encaissés,
ramifiés comme des lacs alpestres; sur la côte occidentale,
les sounds sont de véritables fjords (Milford Sound) dont l'entrée
est barrée par des seuils, anciennes moraines frontales. La côte
orientale est plate et s'étale en une large plaine d'ailleurs bien
arrosée.
-
-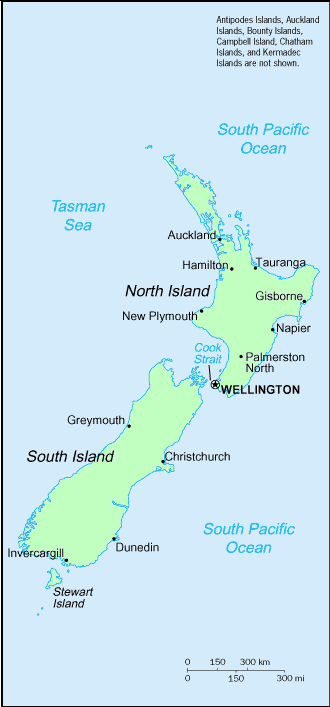
Carte
de la Nouvelle-Zélande.
Source
: The World Factbook.
(Cliquer
sur l'image pour afficher une carte plus détaillée).
Histoire de la
Nouvelle-Zélande. - Le premier peuplement de la Nouvelle-Zélande,
d'origine polynésienne semble remonter à la fin du XIIIe
siècle. La colonisation polynésienne était complète
au milieu du XIVe. Les habitants, aujourd'hui
connus sous le nom de Maoris, ont appelé cette terre Aotearoa, qui,
selon la légende, était le nom du canoë que Kupe, le
premier Polynésien de Nouvelle-Zélande, avait utilisé
pour naviguer vers ce pays; le nom Aotearoa est maintenant largement utilisé
comme nom maori du pays.
La concurrence pour
l'appropriation des terres et des ressources a conduit à des combats
intermittents entre différents iwi (tribus) maoris au cours
du XVIe siècle alors que le gros
gibier s'éteignait.
L'explorateur néerlandais
Abel Tasman a été le premier Européen à voir
les îles en 1642, mais après une rencontre avec des Maoris,
il a continué sa navigation. Le capitaine britannique James Cook
fut l'Européen suivant à arriver en Nouvelle-Zélande
en 1769, lui ont succédé des baleiniers, des chasseurs de
phoque et des commerçants.
Le Royaume-Uni n'a
revendiqué que nominalement la Nouvelle-Zélande et l'a incluse
dans la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. En 1832, les inquiétudes
concernant l'augmentation de l'anarchie ont conduit le Royaume-Uni à
nommer son premier résident britannique en Nouvelle-Zélande.
Il n'avait que peu de pouvoirs juridiques. En 1835, certains iwi
de l'île du Nord ont déclaré leur indépendance
en tant que tribus unies de Nouvelle-Zélande. Craignant une prise
de contrôle française imminente, ils ont bientôt demandé
la protection des Britanniques.
En 1840, les Britanniques
ont négocié leur protection dans le traité de Waitangi,
qui a finalement été signé par plus de 500 chefs maoris
différents, bien que de nombreux chefs n'aient pas signé
ou n'aient pas été invités à signer. Dans la
version anglaise du traité, les Britanniques pensaient que les Maoris
cédaient leurs terres au Royaume-Uni, mais les traductions du traité
semblaient donner aux Britanniques moins d'autorité, et les problèmes
de régime foncier découlant du traité sont toujours
lobjet de négociations en Nouvelle-Zélande.
Le Royaume-Uni a
fait de la Nouvelle-Zélande une colonie distincte en 1841 et lui
a donné une autonomie gouvernementale limitée en 1852. Différentes
traditions d'autorité et d'utilisation des terres ont conduit à
une série de guerres depuis le années 1840 jusqu'aux aux
années 1870 entre les Européens et divers iwi. Ces
conflits, ajoutés aux maladies, ont réduit de moitié
la population maorie. Dans les années 1890, la Nouvelle-Zélande
a d'abord exprimé son intérêt à se joindre aux
pourparlers d'indépendance avec l'Australie, mais a finalement opté
contre et a changé son statut en un dominion indépendant
en 1907.
La Nouvelle-Zélande
a fourni plus de 100 000 soldats au cours de chaque guerre mondiale, dont
beaucoup ont combattu dans le cadre du Corps d'armée australien
et néo-zélandais. La Nouvelle-Zélande a réaffirmé
son indépendance en 1947, a signé le traité Australie,
Nouvelle-Zélande et États-Unis et a soutenu militairement
les États-Unis dans les guerres de Corée et du Vietnam.
À partir de
1984, la Nouvelle-Zélande a commencé à adopter des
politiques anti-nucléaires, contribuant à un différend
avec les États-Unis sur les visites de navires de guerre. Par mesure
de rétorsion, les États-Unis ont suspendu leurs obligations
de défense envers la Nouvelle-Zélande en 1986.
Ces dernières
années, la Nouvelle-Zélande a envisagé de réduire
certains de ses liens avec le Royaume-Uni. Un mouvement minoritaire, mais
actif, pousse à transformer de la Nouvelle-Zélande en république.
En 2015-2016, un référendum sur le changement du drapeau
néo-zélandais pour supprimer l'Union Jack (le drapeau
britannique) a échoué (57% des voix contre ce changement,
43% pour).
Climat.
La latitude de la
Nouvelle-Zélande place la plus grande partie de l'archipel dans
la zone tempérée chaude. Sa situation maritime fait prédominer
les influences adoucissantes de la mer. De là un climat en général
modéré, avec des écarts moyens, ainsi Auckland donne
comme moyenne de juillet (mois le plus froid) + 10,8°C et comme moyenne
de janvier (le plus chaud) + 19,3°C soit un écart de 8,5°C
qui est assez caractéristique du climat maritime. A Wellington par
41,16°C (latitude de Madrid) par 40 mètres d'altitude on a la
moyenne suivante : juillet + 80,3°C; janvier + 16,6 °C, écart
80 3. Dans l'île Sud les températures sont plus basses.
Les écarts
moyens sont au final très modérés puisque partout
ils demeurent d'environ 8°C et normalement par l'effet de la latitude,
la moyenne annuelle fléchit en allant vers le sud, de 15°C environ
à Auckland, elle n'est plus que de 10°C à Dunedin. Cette
différence s'accuse surtout par les hivers, les hivers de l'île
du Nord tout assez proches des hivers méditerranéens, les
hivers de l'île du Sud rappellent plutôt les températures
de la Bretagne. En revanche partout les étés gardent une
modération très accentuée, la moyenne d'Auckland est
de peu supérieure à celle de Paris et à Dunedin avec
14°C, elle rappelle les étés frais de Grande-Bretagne.
La pluviosité
est forte en général; mais tandis que l'île du Nord
appartient à la zone des pluies saisonnières, l'île
du Sud est sous le régime des pluies prolongées de la zone
tempérée froide. Partout ces pluies sont abondantes à
cause du caractère maritime et du relief, à Auckland la hauteur
des précipitations est de 1,1 m, à Wellington elle est même
de 1,28 m. Dans l'île Sud elles sont plus abondantes encore, ainsi
à Hokitika, elles s'élèvent à près de
3 mètres; cependant à Dunedin, qui occupe le versant moins
humide, le niveau ne dépasse pas 0,87 m. Dans l'ensemble, en effet,
il y a une différence très grande entre le versant occidental
qui, dans l'île du Sud, reçoit plus de 2 m et dans l'île
du Nord, plus de 1,25 m et la côte orientale qui est plus sèche,
surtout dans l'île du Sud où au nord de Dunedin, dans la plaine,
se marque une zone qui reçoit moins de 75 centimètres.
La différence
est aussi dans la répartition de ces pluies; pendant la saison chaude,
d'octobre à mai, il pleut très peu dans l'île du Nord,
et les grandes pluies se concentrent sur la saison de mai à septembre.
Dans l'île du Sud les pluies sont plus régulièrement
réparties et s'il y a un maximum, il y a des pluies toute l'année.
Sur les Alpes néo-zélandaises, les pluies se transforment
en neiges qui alimentent les glaciers, mais soufflent vers le versant oriental
des vents chauds analogues au foehn, qui hâtent la fonte des glaciers.
Flore.
Ce climat est favorable à la végétation.
De plus, l'isolement géographique de la Nouvelle-Zélande
a permis la présence d'espèces d'arbres qui sont restées
relativement inchangées au cours des 190 millions d'années
passées. Les forêts, formées en majeure partie de fougères arborescentes et d'un nombre considérable de conifères
arborescentes et d'un nombre considérable de conifères ,
rappellent la végétation de l'époque carbonifère
(phormium tenax, eucalyptus, etc.). La
patate, le taro ,
rappellent la végétation de l'époque carbonifère
(phormium tenax, eucalyptus, etc.). La
patate, le taro étaient cultivés de temps immémorial par les Maoris
(premiers habitants de la Nouvelle-Zélande, arrivés dans
l'archipel vers l'an 800 ap. J.-C). Les céréales, les légumes
étaient cultivés de temps immémorial par les Maoris
(premiers habitants de la Nouvelle-Zélande, arrivés dans
l'archipel vers l'an 800 ap. J.-C). Les céréales, les légumes ,
les fruits ,
les fruits d'Europe
d'Europe y ont été introduits et y réussissent très
bien.
y ont été introduits et y réussissent très
bien.
-

Wellington,
la capitale de la Nouvelle-Zélande, vue depuis l'espace. Source
: Nasa.
Faune.
Lors de la découverte de la Nouvelle-Zélande
par les Européens, il n'y avait pas que peu de mammifères
(des phoques, des chauves-souris) dans ces îles; on y trouvait l'Aptéryx,
oiseau de la famille de l'Autruche. Anciennement, la Nouvelle-Zélande
possédait aussi un autre oiseau, de la même famille, le Dinornis
ou Moa, qui a disparu à cause de la chasse : dans un lointain passé,
les habitants autochtones de Nouvelle-Zélande avaient allumé
des incendies pour chasser le dinornis géant et avaient déjà
tué la plupart des oiseaux au moment où le peuple maori a
colonisé la Nouvelle-Zélande vers 1350 de notre ère.
En 1800, le dinornis était éteint.
de la famille de l'Autruche. Anciennement, la Nouvelle-Zélande
possédait aussi un autre oiseau, de la même famille, le Dinornis
ou Moa, qui a disparu à cause de la chasse : dans un lointain passé,
les habitants autochtones de Nouvelle-Zélande avaient allumé
des incendies pour chasser le dinornis géant et avaient déjà
tué la plupart des oiseaux au moment où le peuple maori a
colonisé la Nouvelle-Zélande vers 1350 de notre ère.
En 1800, le dinornis était éteint.
L'arrivée
des premiers quadrupèdes a entraîné l'extinction généralisée de
nombreuses démunies contre ces nouveaux prédateurs. Une introduction
particulièrement néfaste a é été celle
des lapins. Les premiers colons qui se sont installés en Nouvelle-Zélande
ont apporté des lapins pour leur fourrure et leur viande, mais la
forte capacité de reproduction de ceux-ci s'est rapidement avérée
problématique et, dès les années 1880, les lapins
avaient un effet négatif considérable sur l'agriculture.
La solution a alors été d'introduire des hermines, des furets
et des belettes, prédateurs naturels des lapins. Malheureusement,
ces espèces se sont avérées dévastatrices pour
les espèces d'oiseaux locales et n'ont eu qu'un impact minime sur
la population croissante de lapins. Les chats ont été introduits
de la même manière, mais ils ont également provoqué
l'extinction de plusieurs espèces d'oiseaux et d'une chauve-souris
indigène.
a entraîné l'extinction généralisée de
nombreuses démunies contre ces nouveaux prédateurs. Une introduction
particulièrement néfaste a é été celle
des lapins. Les premiers colons qui se sont installés en Nouvelle-Zélande
ont apporté des lapins pour leur fourrure et leur viande, mais la
forte capacité de reproduction de ceux-ci s'est rapidement avérée
problématique et, dès les années 1880, les lapins
avaient un effet négatif considérable sur l'agriculture.
La solution a alors été d'introduire des hermines, des furets
et des belettes, prédateurs naturels des lapins. Malheureusement,
ces espèces se sont avérées dévastatrices pour
les espèces d'oiseaux locales et n'ont eu qu'un impact minime sur
la population croissante de lapins. Les chats ont été introduits
de la même manière, mais ils ont également provoqué
l'extinction de plusieurs espèces d'oiseaux et d'une chauve-souris
indigène.
Economie.
Depuis la fin des années 1980 le
gouvernement néo-zélandais a impulsé une politique
de transformation de l'économie du pays, qui initialement était
basée sur l'agriculture et dépendant fortement des échanges
avec le Royaume-Uni ,
en une économie plus industrielle, et ouverte sur le marché
international. Il en a résulté une importante croissance,
un enrichissement global du pays, mais aussi un creusement des inégalités
sociales. Cela a sucité au cours des dernières années
un regain des revendications de Maoris, principaux laissés pour
compte de la croissance. ,
en une économie plus industrielle, et ouverte sur le marché
international. Il en a résulté une importante croissance,
un enrichissement global du pays, mais aussi un creusement des inégalités
sociales. Cela a sucité au cours des dernières années
un regain des revendications de Maoris, principaux laissés pour
compte de la croissance.
-

Le
lac Pukaki, au pied du mont Cook (Aoraki). Source
: The World Factbook.
|
|