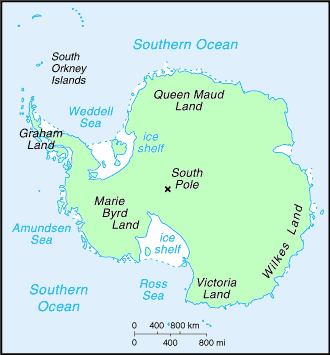|
 Paul-Emile
Victor, Jean-Christophe Victor, Adieu
l'Antarctique, Hachette (Pluriel), 2009. Paul-Emile
Victor, Jean-Christophe Victor, Adieu
l'Antarctique, Hachette (Pluriel), 2009.
2012794319
Pourquoi
l'Antarctique, vide, froid, hors de proportion, fascine-t-il tant, Peut-être
parce qu'aucun des explorateurs partis à l'assaut de cette terre n'est
venu à bout de son infinité, de sa beauté, de son mystère. Tardivement
exploré,
très tôt démilitarisé (1959) et protégé dès 1991, l'Antarctique,
premier parc naturel mondial, est aujourd'hui dédié à la recherche scientifique.
En matière de protection de l'environnement, il constitue un poste d'observation
unique.
Jean-Christophe
Victor nous donne, avec Adieu l'Antarctique, une version intégralement
revue, mise à jour, de Planète Antarctique, livre écrit à quatre
mains en 1992. Un portrait amoureux de l'Antarctique. Le regard de l'aventurier
et du scientifique croise celui du géopolitologue. L'utopiste et le réaliste
se trouvent réconciliés autour d'une même passion : celle de la découverte.
(couv.).
 François
Garde, Paul-Emile
Victor et la France de l'Antarctique, Louis Audibert, 2006.
- Il se disait "nomade" et le fut sans aucun doute,
par amour de l'aventure, des navires et des avions. A vingt-six ans, en
1934, Paul-Emile Victor quitte la vie paisible que lui offrait l'usine
familiale de Lons-le-Saunier pour aller
vivre chez les Esquimaux. Dès son retour, il devient célèbre grâce
à ses reportages, ses conférences et ses livres. Après guerre, il se
tourne vers l'extrême Sud et déploie ses talents d'organisateur pour
mettre sur pied les "Expéditions polaires françaises". La France de De
Gaulle veut être présente en Antarctique en ces années de Guerre
froide où les grandes puissances découvrent
l'intérêt stratégique du continent blanc - les observations de la haute
atmosphère que l'on y fait vont permettre la conquête spatiale. En terre
Adélie, tout est alors à inventer : "PEV" réussit à obtenir les moyens
de construire la base Dumont-d'Urville, offrant aux scientifiques un terrain
exceptionnel pour la connaissance de la planète. Toujours en quête de
nouveaux horizons, il se lance dès la fin des années 1960 dans la défense
de l'environnement et se bat pour la préservation de l'Antarctique. Au
faîte de sa popularité, il se retire à Bora Bora où il peaufine sa
légende. C'est l'histoire d'un mythe que raconte ce livre, celle d'un
homme qui fit rêver plusieurs générations. (Edit.). François
Garde, Paul-Emile
Victor et la France de l'Antarctique, Louis Audibert, 2006.
- Il se disait "nomade" et le fut sans aucun doute,
par amour de l'aventure, des navires et des avions. A vingt-six ans, en
1934, Paul-Emile Victor quitte la vie paisible que lui offrait l'usine
familiale de Lons-le-Saunier pour aller
vivre chez les Esquimaux. Dès son retour, il devient célèbre grâce
à ses reportages, ses conférences et ses livres. Après guerre, il se
tourne vers l'extrême Sud et déploie ses talents d'organisateur pour
mettre sur pied les "Expéditions polaires françaises". La France de De
Gaulle veut être présente en Antarctique en ces années de Guerre
froide où les grandes puissances découvrent
l'intérêt stratégique du continent blanc - les observations de la haute
atmosphère que l'on y fait vont permettre la conquête spatiale. En terre
Adélie, tout est alors à inventer : "PEV" réussit à obtenir les moyens
de construire la base Dumont-d'Urville, offrant aux scientifiques un terrain
exceptionnel pour la connaissance de la planète. Toujours en quête de
nouveaux horizons, il se lance dès la fin des années 1960 dans la défense
de l'environnement et se bat pour la préservation de l'Antarctique. Au
faîte de sa popularité, il se retire à Bora Bora où il peaufine sa
légende. C'est l'histoire d'un mythe que raconte ce livre, celle d'un
homme qui fit rêver plusieurs générations. (Edit.).
 Mc
Gonigal, Antarctique,
le continent bleu, Nathan (Beaux livres), 2004. Mc
Gonigal, Antarctique,
le continent bleu, Nathan (Beaux livres), 2004.
 Sébastien
Panou, Grand
Sud, reportages en Antarctique, Marines Nantes, 2004. Sébastien
Panou, Grand
Sud, reportages en Antarctique, Marines Nantes, 2004.
|