| . |
|
||||||
|
|
| . |
|
||||||
|
Republica Bolivariana de Venezuela |

8 00 N, 66 00 W |
Le Venezuela - 
Carte du Venezuela. Source : The World Factbook. (Cliquer sur l'image pour afficher une carte détaillée). Le Venezuela est divisé administrativement
en 23 Etats (estados; singulier : estado), 1 district fédéral
(distrito federal) o√Ļ se trouve la capitale Caracas Les 23 Etats du Venezuela
G√©ographie physique du VenezuelaRelief du sol.Dans son ensemble, le relief du Venezuela se divise tr√®s nettement en trois parties les montagnes c√īti√®res, les montagnes guyanaises sur la rive droite de l'Or√©noque, et l'immense plaine des Llanos entre les deux r√©gions montagneuses, et qui sont des pays d'√©levage extensif. La cha√ģne c√īti√®re se divise en deux parties distinctes par leur formation g√©ologique, par leur aspect et par leur direction : la cordill√®re cara√Įbe dirig√©e de l'Est √† l'Ouest, et la cordill√®re de M√©rida dont la direction tourne au Sud-Ouest √† partir du golfe Triste; la s√©paration entre les deux cha√ģnes est bien marqu√©e par un seuil de 360 m d'altitude qui s√©pare les eaux qui s'√©coulent d'une part vers le rio Yaracui, d'autre part vers le rio Coejdes, affluent de l'Or√©noque, par le rio Portugueza et le rio Apure. Le sierra de M√©rida a un caract√®re franchement andin, tandis que la cordill√®re cara√Įbe para√ģt se rattacher, par l'√ģle de Trinidad, √† la cha√ģne des petites Antilles. La cordill√®re cara√Įbe se compose d'abord de la cha√ģne de Paria qui s'avance √† l'Est en face de la pointe de Trinidad et s'√©tend jusqu'√† la baie de Cariaco; elle est r√©guli√®re et peu √©lev√©e. Au Sud de cette premi√®re
cha√ģne court celle des monts de Cumana, beaucoup plus √©lev√©e; le Turumiquire
y atteint 2049 m; le Bergantin; 1668 m. Ces deux cha√ģnes s'interrompent
√† I'Ouest; la cha√ģne de Paria est totalement coup√©e entre la p√©ninsule
d'Araya et le cap Codera; les monts de Cumana s'abaissent fortement dans
leur prolongement des montagnes du Paraulata, qui ne sont que des collines
discontinues. Puis, à partir du rio Unare, les montagnes
élevées reparaissent, formant des alignements parallèles, dont le plus
voisin de la c√īte est la silla de Caracas La cordill√®re de M√©rida est la seule qui, au Venezuela, m√©rite le surnom de nevada = neigeuse; plusieurs de ses pics atteignent 4000 m et cinq d'entre eux d√©passent la limite des neiges perp√©tuelles sous ce climat √©quatorial; les deux principaux sont le Pico Bolivar (La Columna) 5007 m, qui est le point culminant du Venezuela, et le Concha, qui atteint les 4700 m d'altitude; le glacier du Concha alimente de glace la ville de M√©rida. Les hautes vall√©es situ√©es √† plus de 3500 m ne sont pas rares, et la rigueur du climat y est telle que ce sont des paramos, r√©gions sans arbres, couvertes seulement d'herbe, de mousses et de lichens. Entre les montagnes c√īti√®res et l'Or√©noque s'√©tendent les immenses plaines des Llanos qui occupent une surface de 500.000 km¬≤. Cette plaine n'offre cependant pas un aspect uniforme. On y distingue d'abord les Llanos altos, au Sud de la cordill√®re de M√©rida, et les Llanos bajos, au bord de l'Apure et de l'Or√©noque. En beaucoup d'endroits le sol se renfle en formant des bancos, et les vall√©es des cours d'eau, creus√©es par une √©rosion puissante, forment des pr√©cipices √† parois verticales appel√©s barrancas, s√©parant de v√©ritables plateaux, les mesas ou tables. Dans la r√©gion guyanaise le relief n'a pas de direction d√©finie, sauf √† la fronti√®re m√™me du Venezuela; peut-√™tre d'ailleurs ne faut-il consid√©rer les sierras Parima et Pacara√Įma que comme le bord du plateau guyanais, s√©par√© du plateau br√©silien par la d√©pression de l'Amazone. Dans l'int√©rieur du pays, il n'y a de montagnes que l√† o√Ļ l'√©rosion n'a pas enlev√© la couche de gr√®s tertiaire; dans l'intervalle de ces t√©moins s'√©tendent des savanes. La sierra Parima
a reçu ce nom en souvenir du lac mythique de Parim ou de la Grande Eau
sur les bords duquel Walter Raleigh Au Nord-Ouest de
la sierra Parima, de hautes montagnes sont disposées
irrégulièrement jusqu'à l'Orénoque : telles
sont le cerro Duida, pyramide de 2474 m, qu'on aperçoit de fort loin sur
le fleuve, le mont Maraguaca (2508 m), le Maparana
(2187 m), le cerro de Neiva (1838 m), le Yaruari (2258 m), le Canavana
(1884 m). Au Nord de la sierra de Pacara√Įma, on peut distinguer quelques
alignements du Sud-Est au c.-à-d. continuant la direction des monts Parima.
Ces montagnes sont en général peu élevées; on peut y citer le Chanaro
(1672 m), le Turagua (1838 m), le Tacuto (1048 m). Enfin, à l'extrémité
Sud-Est du Venezuela, l'énorme masse du Roraima se dresse à 2286 m, terminé
par un plateau long de 6 km. Le Roraima fut gravi pour la première fois
en 1885 par lm Thurn et Perkins, et depuis
il est visité régulièrement par les chercheurs d'orchidées.

Une montagne tabulaire (tepui), caractéristique du plateau Guyanais : le mont Kukenan, au Vénézuéla. Photo : Peter Fenda; licence : Creative Commons. Géologie.
Dans la cordill√®re de M√©rida ce sont les gneiss et les schistes argileux qui forment la plus grande partie du socle montagneux; dans la partie orientale de la cordill√®re c√īti√®re, appel√©e par Sievers cha√ģne Cara√Įbe, ce sont les quartzites et les ardoises; en Guyane, le granit et le gneiss alternent. Il est remarquable que la s√©rie g√©ologique est interrompue totalement entre le Pr√©cambrien et le Cr√©tac√©; on ne trouve pas trace de Silurien, D√©vonien, Carbonif√®re, Permien, Triassique ni Jurassique. Le Cr√©tac√© forme au-dessus des roches cristallines, dans toutes les parties montagneuses du Venezuela, de puissantes couches de gr√®s blanc, rouge ou jaune, accompagn√©es de gr√®s bitumineux et de marnes gris bleu et gris fonc√©. On ne trouve pas de craie pure. Ce gr√®s, qui donne un relief beaucoup plus abrupt que les granits et les gneiss, subsiste surtout √† l'√©tat de t√©moins; ainsi le Cerro Duida est recouvert par une masse de gr√®s quartzeux √©paisse de 1200 √† 1500 m; le mont Rora√Įma se termine par un √©norme bloc tabulaire de gr√®s rose; sans fossiles, dont les parois √† pic ont longtemps rendu l'ascension impossible. De nombreux autres massifs gr√©seux de m√™me forme tabulaire, appel√©s tepuis ou tepuyes (tepuy, au singulier), jalonnent le paysage de la Guyane venezolane. Les formations tertiaires sont form√©es de gr√®s brun avec des silex et des rognons d' ferrugineuse, de calcaire clair, de schistes houillers; on y trouve aussi du gypse, de l'alun, du sel gemme, du sulfate de fer, de l'ocre. Le tertiaire se rencontre surtout dans l'Etat de Tachira, √† la fronti√®re colombienne, au Nord de la sierra de M√©rida, mais tr√®s rarement au Nord de la cordill√®re cara√Įbe. A Tachira, le tertiaire ocreux forme une montagne de 1300 m d'altitude, aux flancs de couleur jaune d'or, ce qui l'a fait appeler Cerro de Oro. Il est vraisemblable que les formations tertiaires s'√©tendent sous les terrains pl√©istoc√®nes des Llanos. Ces terrains, tr√®s analogues √† ceux de l'Amazonie, paraissent √™tre form√©, dans toute l'√©tendue des Llanos, par un gr√®s rouge, compos√© de fragments arrondis de quartz ciment√©s par une argile ferrugineuse. Ces terrains sont tr√®s riches en fossiles de grande taille : M√©gatherium, Paresseux g√©ant, Toxodon, Glyptodon, Cheval, etc. Il n'y a pas de volcans
dans la cordill√®re de M√©rida, ni dans la cordill√®re cara√Įbe, ni en
Guyane, mais on a trouvé quelques traces d'éruptions très anciennes
que sur deux points : en Guyane, o√Ļ l'or du Cuyuni
est allié à la diabase et à la diorite, et au
Sud de la cha√ģne cara√Įbe o√Ļ l'on a d√©couvert quelques diabasporphyrites
et même des phonolithes. Il existe par ailleurs des sources d'eau très
chaude qui jaillissent entre Cumana et Cariaco, à Calabozzo, dans les
Llanos d'Orituro et surtout entre Puerto-Cabello et Valencia, o√Ļ la source
de las Trincheras est un véritable geyser dont la température dépasse
90 ¬įC. Les tremblements de terre sont aussi tr√®s fr√©quents; celui du
jeudi saint de L'année 1812 fit périr 12.000
personnes à Caracas Climat.
Pour la Guyane venezolane, on a mesur√© au mois de septembre, √† 7 heures du matin, une moyenne de 22,4 ¬įC pour la temp√©rature de l'air et une temp√©rature de 24¬įC √† 25¬įC pour les eaux du rio Mazaruni et du rio Cuyuni; or on sait que la temp√©rature de l'eau, dans les pays tropicaux, est sup√©rieure d'environ un degr√© √† la temp√©rature moyenne annuelle de l'air. Sur la c√īte, l'aliz√© de l'h√©misph√®re Nord souffle toute l'ann√©e, mais sa direction change un peu avec les saisons en raison du d√©placement des faibles pressions √©quatoriales. De novembre-d√©cembre √† avril-mai, l'aliz√© souffle de l'Est et du Nord-Est, pendant le jour, et est remplac√© la nuit par la brise de terre. Mais de novembre √† janvier, l'aliz√© est aussi parfois remplac√© par des vents du Nord qui ne sont autres, probablement, que les ¬ę Northers ¬Ľ venus de la partie Nord du continent. De mai √† novembre, l'aliz√© du Nord-Est tombe souvent et est remplac√© par des vents faibles et variables du Sud-Est, du Sud-Ouest et de l'Ouest, appel√©s vendavales ou vents calmes. L'aliz√© et les vendavales apportent des pluies, mais surtout les derniers; d'ailleurs les pr√©cipitations sont relativement faibles et certains points, comme Macara√Įbo et Cumana, sont particuli√®rement pauvres en pluies. Sur les for√™ts du delta de l'Or√©noque, il pleut au contraire toute l'ann√©e, et la masse annuelle d√©passe 2,50 m. Mais sur les Llanos, il y a des saisons humides et des saisons s√®ches nettement d√©limit√©es. De novembre √† mars, il pleut √† peine; m√™me les nuages sont une raret√©, quoiqu'on en ait observ√© √† plusieurs reprises. En g√©n√©ral, le ciel est d'une puret√© extraordinaire et l'air extr√™mement sec. Le vent, qui n'est autre que l'aliz√© des s√©ch√© par les montagnes c√īti√®res, souffle alors de l'Est et de l'Est-Nord-Est. En mars, l'air devient plus humide et les √©toiles sont souvent entour√©es d'un halo; le vent devient irr√©gulier et souvent entrecoup√© de calmes complets; dans le Sud montent des nuages. En avril commence la saison des pluies qui dure jusqu'en novembre, sauf pendant une petite interruption vers la fin de juin, que l'on appelle Veranito de San Juan. Pendant la saison des pluies, le vent souffle de l'Ouest et du Sud-Ouest, et le ciel est constamment gris. On voit donc que l'aliz√© n'est cause de pluie dans ces r√©gions que sur la c√īte; √† l'int√©rieur, la pluie est apport√©e par, des vents d'Ouest. D'ailleurs, c'est le r√©gime commun √† toute la partie de l'Am√©rique du Sud tropicale, situ√©e √† l'Est des Andes; c'est dans la forte √©vaporation qui se produit au-dessus des for√™ts amazoniennes qu'il faut chercher l'origine de la vapeur d'eau pr√©cipit√©e sur le continent sud-am√©ricain. Il faut ajouter que ces fortes pluies, dont la masse annuelle d√©passe 2 m sur la plus grande partie du Venezuela et 3 m dans les for√™ts du Casiquiare et du Haut-Or√©noque, sont toujours le r√©sultat d'orages qui √©clatent r√©guli√®rement tous les jours de la saison des pluies entre heures et 6 heures de l'apr√®s-midi. La tension √©lectrique est alors tr√®s consid√©rable, et, dans les for√™ts de Zulia, Sievers a observ√© pendant toute la dur√©e de l'orage une lueur √©lectrique ininterrompue. Il est remarquable aussi que, comme dans toute l'Am√©rique du Sud tropicale, il est rare que la foudre cause des incendies, m√™me quand la foudre tombe sur la terre. Hydrographie.
Les cours d'eau venezolans qui ne d√©pendent pas de l'Or√©noque sont peu importants. A l'Est, le rio Cuyuni n'a que son cours sup√©rieur en Venezuela et le rio Mazaruni sert quelque temps de fronti√®re; tous deux s'en vont rejoindre l'Essequibo. Parmi les cours d'eau de la cha√ģne c√īti√®re, il n'y a gu√®re √† citer que l'Unare qui sort des monts de Cumana; les ruisseaux qui descendent de la cordill√®re de M√©rida comblent peu √† peu la lagune de Maraca√Įbo. Tout √† fait √† l'Ouest, le Catatumbo vient de Colombie et re√ßoit le Zulia, grossi du Tachira. La lagune de Maraca√Įbo ou lac de Venezuela a des eaux douces jusqu'√† quelques kilom√®tres du goulet qui est ferm√© par deux seuils recouverts de 3 m d'eau; cependant la mar√©e s'y fait un peu sentir. La lagune a une profondeur maxima de 120 m, 600 km de tour et une superficie de 21.740 km¬≤. Entre les cha√ģnons
de la cordillère se trouvent plusieurs lacs d'effondrement
dont le principal est celui de Tacarigua ou de Valencia, célèbre pour
la beauté de ses rives. Actuellement sa profondeur maxima est de 92 m
et sa profondeur moyenne de 32 m. Mais le niveau a baiss√©, ce que Humboldt Ajoutons que c'est au Sud-Est du Venezuela, dans l'Auyan Tepuy (massif de la Gran Sabana), que se trouve la plus haute chute d'eau du monde, celle de l'Angel, qui fait tomber ses eaux d'une hauteur de 980 m dans un des affluents du Caroni, qui lui-m√™me se jette dans l'Or√©noque pr√®s de Ciudad Guyanna, apr√®s avoir aliment√© le principal lac de retenue du pays, le R√©servoir Raul Leoni, ferm√© par le barrage Guri. Biog√©ographie du VenezuelaLe nord du Venezuela est caract√©ris√© par une bande littorale bord√©e par la mer des Cara√Įbes. Cette zone c√īti√®re est domin√©e par des mangroves, des lagunes saum√Ętres et des for√™ts s√®ches tropicales. Elle abrite de nombreuses esp√®ces end√©miques adapt√©es √† des conditions salines et arides, notamment dans les zones de la p√©ninsule de Paraguan√° ou autour du lac Maracaibo. Ce dernier, vaste √©tendue d'eau douce avec des apports marins, constitue un √©cosyst√®me o√Ļ se m√™lent esp√®ces fluviales et marines.√Ä l'est, le delta de l'Or√©noque repr√©sente un vaste territoire mar√©cageux et inondable. Ce milieu complexe, compos√© de bras fluviaux, d'√ģles alluviales et de for√™ts mar√©cageuses, est l'un des plus riches en biodiversit√© du pays. Il sert de refuge √† des esp√®ces embl√©matiques telles que le jaguar, le lamantin ou encore le ca√Įman noir. La r√©gion est √©galement essentielle pour de nombreuses esp√®ces d'oiseaux migrateurs. Au centre du pays s'√©tend la grande plaine des Llanos, un vaste territoire de savanes inondables alternant avec des for√™ts-galeries le long des rivi√®res. Pendant la saison des pluies, ces savanes sont recouvertes d'eau et accueillent une faune abondante : anacondas, capybaras, cerfs, ibis rouges, h√©rons et ca√Įmans. √Ä la saison s√®che, l'eau se retire, concentrant la faune autour des zones humides r√©siduelles. Les Llanos constituent une zone cl√© pour l'observation des relations entre biodiversit√© et cycles hydrologiques tropicaux. Le sud du Venezuela est occup√© par le massif des Guyanes, une r√©gion ancienne et g√©ologiquement stable. Elle se distingue par ses paysages spectaculaires domin√©s par les tepuis qui donnent naissance √† des √©cosyst√®mes isol√©s, comparables √† des √ģles biologiques. La for√™t tropicale humide y est omnipr√©sente, avec une richesse floristique in√©gal√©e, notamment en orchid√©es, brom√©liac√©es et foug√®res arborescentes. Ces for√™ts abritent √©galement des amphibiens et insectes end√©miques, certains ne se trouvant que sur un seul tepui. √Ä l'ouest, la cordill√®re des Andes p√©n√®tre le Venezuela par les √Čtats de M√©rida, T√°chira et Trujillo. Ce relief escarp√© cr√©e une diversit√© altitudinale propice √† une vari√©t√© de niches √©cologiques, depuis les for√™ts nuageuses jusqu'aux p√°ramos andins. Ces derniers sont des √©cosyst√®mes froids de haute montagne, domin√©s par des plantes comme les frailejones, et abritent des esp√®ces adapt√©es au froid et √† l'humidit√© comme le condor des Andes ou le cerf nain andin. Cette zone constitue √©galement un point chaud d'end√©misme v√©g√©tal. Les √ģles c√īti√®res et l'archipel de Los Roques forment des milieux marins et insulaires d'une grande importance biog√©ographique. R√©cifs coralliens, herbiers marins et lagons abritent une biodiversit√© marine remarquable. Les tortues marines viennent y pondre, et de nombreux poissons tropicaux trouvent refuge dans les r√©cifs. L'archipel est aussi reconnu pour ses colonies d'oiseaux marins. Enfin, la biodiversit√© du Venezuela est √©troitement li√©e √† ses gradients climatiques, son relief contrast√© et ses sols anciens. Plus de 50 % du territoire est couvert de for√™ts naturelles, dont plusieurs sont prot√©g√©es dans des parcs nationaux comme Canaima, Henri Pittier ou la Sierra Nevada. Cependant, la d√©forestation, l'exploitation mini√®re ill√©gale, la fragmentation des habitats et le changement climatique constituent des menaces croissantes pour ces √©cosyst√®mes fragiles. G√©ographie humaine du VenezuelaPopulation.La population du Venezuela, estim√©e √† environ 28 millions d'habitants en 2025, pr√©sente une structure relativement jeune, avec une m√©diane d'√Ęge autour de 29 ans. Toutefois, cette jeunesse est en d√©clin progressif en raison de la baisse du taux de natalit√©, qui a chut√© ces deux derni√®res d√©cennies sous l'effet de l'urbanisation, de l'acc√®s √† la contraception et de la crise √©conomique qui d√©courage les familles nombreuses. La croissance d√©mographique naturelle a √©t√© historiquement forte jusqu'au d√©but du XXIe si√®cle, mais elle est aujourd'hui consid√©rablement ralentie par l'√©migration massive. Depuis les ann√©es 2010, le Venezuela a connu l'un des plus importants exodes de population de l'histoire contemporaine de l'Am√©rique latine. Environ 7 √† 8 millions de V√©n√©zu√©liens vivent aujourd'hui √† l'√©tranger, principalement en Colombie, au P√©rou, au Chili, aux √Čtats-Unis et en Espagne. Cette migration de masse est li√©e √† la d√©gradation des conditions de vie, √† l'hyperinflation, √† l'ins√©curit√© et √† la situation politique. Plus de 90 % de la population r√©side dans des zones urbaines. Caracas, la capitale, concentre une part importante de la population urbaine, mais d'autres villes comme Maracaibo, Valencia, Barquisimeto et Maracay jouent √©galement un r√īle central. L'urbanisation rapide du XXe si√®cle s'est accompagn√©e d'un d√©veloppement d√©s√©quilibr√©, qui a favoris√© l'apparition de quartiers informels, g√©n√©ralement surpeupl√©s et d√©pourvus d'infrastructures de base. Ces zones marginalis√©es, appel√©es ¬ę barrios ¬Ľ, sont devenues embl√©matiques des in√©galit√©s sociales au Venezuela. Les in√©galit√©s sociales sont particuli√®rement marqu√©es. Le coefficient de Gini, qui mesure l'in√©galit√© de distribution des revenus, reste √©lev√©, malgr√© une rh√©torique politique orient√©e vers la justice sociale. La pauvret√© mon√©taire touche une grande majorit√© de la population, et les classes moyennes ont √©t√© fortement √©rod√©es par la crise √©conomique. En parall√®le, une √©lite restreinte continue d'acc√©der √† des biens et services souvent inaccessibles pour la majorit√©. Le syst√®me √©ducatif, bien que th√©oriquement universel et gratuit, souffre d'un manque chronique de ressources, de la fuite des enseignants et de l'abandon scolaire croissant. Le Venezuela poss√©dait historiquement l'un des taux d'alphab√©tisation les plus √©lev√©s de la r√©gion, mais les difficult√©s √©conomiques ont affaibli les acquis. La sant√© publique est confront√©e aux m√™mes d√©fis : effondrement des infrastructures, exode du personnel m√©dical, p√©nurie de m√©dicaments et r√©√©mergence de maladies √©vitables (paludisme, rougeole, tuberculose). La soci√©t√© v√©n√©zu√©lienne se caract√©rise par une forte politisation depuis la fin des ann√©es 1990, accentu√©e par la polarisation entre chavistes (partisans du mouvement bolivarien) et opposants. Cette division traverse les familles, les institutions, et influence la perception des services publics, des m√©dias, de l'√©ducation et m√™me des rapports de voisinage. L'√©conomie informelle, le client√©lisme politique et les r√©seaux de solidarit√© communautaire constituent des strat√©gies d'adaptation √† la crise. Les femmes jouent un r√īle essentiel dans la r√©silience sociale, en particulier dans les quartiers d√©favoris√©s, o√Ļ elles assurent la survie des familles en g√©rant les r√©seaux d'entraide, les cuisines communautaires et les soins aux enfants et aux personnes √Ęg√©es. Toutefois, les violences de genre, la pr√©carit√© √©conomique f√©minine et la sous-repr√©sentation dans les sph√®res de pouvoir demeurent des probl√©matiques majeures. Quelques-unes des principales villes du Venezuela
Groupes ethnolinguistiques. La soci√©t√© v√©n√©zu√©lienne est tr√®s diverse sur le plan ethnolinguistique et culturel. La majorit√© de la population se compose de M√©tis (environ 52 %), r√©sultat du m√©tissage entre Espagnols, Africains et populations autochtones. Environ 43 % des habitants se d√©finissent comme blancs, tandis que les Afro-V√©n√©zu√©liens repr√©sentent 3 √† 5 % et les populations indig√®nes environ 2 %. Ces derni√®res,sont principalement localis√©es dans des r√©gions isol√©es du sud et de l'est du pays. Bien que reconnues constitutionnellement, ces communaut√©s subissent des discriminations persistantes et des pressions environnementales mena√ßant leur mode de vie traditionnel. Les populations autochtones sont aujourd'hui constitu√©s d'environ 51 groupes ethniques reconnus, r√©partis principalement dans les r√©gions frontali√®res et amazoniennes, notamment dans les √Čtats de Zulia, Amazonas, Bol√≠var, Delta Amacuro et Apure. Les groupes les plus nombreux sont les Wayuu (dans la Guajira v√©n√©zu√©lienne), les Warao (dans le delta de l'Or√©noque), les Pem√≥n (dans le sud-est, autour de la Gran Sabana), les Yanomami (dans la zone amazonienne frontali√®re avec le Br√©sil), et les Piaroa (dans le centre-sud de l'Amazonas). Chacun de ces groupes poss√®de sa propre langue et des syst√®mes de repr√©sentation du monde radicalement distincts. Bien que l'espagnol soit la langue officielle du pays, la Constitution reconna√ģt √©galement les langues indig√®nes comme langues officielles dans leurs territoires respectifs. Cependant, beaucoup de ces langues sont menac√©es d'extinction en raison de la pression de l'espagnol, de l'urbanisation, et du manque de transmission interg√©n√©rationnelle. Des efforts de revitalisation linguistique ont √©t√© entrepris localement, notamment par des enseignants autochtones et des ONG culturelles, mais les r√©sultats restent in√©gaux. La population afro-v√©n√©zu√©lienne, issue principalement de la traite transatlantique, est concentr√©e dans des r√©gions c√īti√®res comme Barlovento (√Čtat de Miranda), la c√īte de Carabobo, ou dans les Llanos. Bien que leurs langues d'origine aient √©t√© perdues au fil des si√®cles, les afro-descendants ont conserv√© des √©l√©ments linguistiques et culturels issus d'Afrique subsaharienne, notamment dans la musique, les danses (comme le tambor), la religion (syncr√©tisme avec le catholicisme), et certaines expressions lexicales dans l'espagnol vernaculaire. L'espagnol parl√© par cette population pr√©sente parfois des traits phon√©tiques ou rythmiques particuliers. Les m√©tis, issus du m√©lange entre Europ√©ens, Africains et autochtones, constituent la majorit√© de la population. Leur langue est l'espagnol v√©n√©zu√©lien, une variante riche de r√©gionalismes, d'influences indig√®nes (lexique, toponymie) et d'apports africains. Cette variante se distingue par son accent chantant, des expressions idiomatiques propres, et des diff√©rences notables entre les r√©gions andines, c√īti√®res et amazoniennes. Le Venezuela a aussi accueilli, au XXe si√®cle, d'importantes vagues migratoires europ√©ennes et moyen-orientales, notamment d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Syrie et du Liban. Ces populations ont maintenu un usage partiel de leurs langues d'origine, souvent √† des fins culturelles ou familiales. L'italien, le portugais et l'arabe sont encore parl√©s dans certaines enclaves urbaines, bien que leur usage diminue chez les g√©n√©rations n√©es au Venezuela. On trouve aussi des descendants d'Allemands, notamment dans la ville de Colonia Tovar, o√Ļ une forme archa√Įque de l'allemand badois (l' "aleman coloniero") est encore parl√© par quelques habitants. D'autres groupes plus restreints, comme les Chinois, les Trinidadiens ou les Guyaniens, apportent leur propre patrimoine linguistique et culturel. Le cantonais et le hakka, par exemple, sont parl√©s au sein de la communaut√© chinoise v√©n√©zu√©lienne, surtout dans les grands centres urbains comme Caracas, Maracay ou Valencia. Enfin, dans les zones frontali√®res, notamment avec la Colombie et le Br√©sil, des dynamiques transfrontali√®res viennent enrichir le panorama linguistique. Des communaut√©s binationales parlent un espagnol influenc√© par le portugais ou par des dialectes r√©gionaux colombiens. Cela se manifeste par un lexique hybride, une intonation influenc√©e par la langue voisine, et parfois des pratiques linguistiques altern√©es selon le contexte social ou √©conomique. Culture.
Le joropo est consid√©r√© comme la musique nationale. Il s'agit d'un style √† la fois instrumental et vocal, caract√©ris√© par des rythmes rapides, une harpe, un cuatro (petite guitare √† quatre cordes) et des maracas. Originaire des plaines (Llanos), il est souvent accompagn√© de la danse du m√™me nom, tr√®s rythm√©e et symbolique du lien entre l'es humains et la terre. Mais le pays regorge de nombreuses autres expressions musicales : la gaita, venue de l'√Čtat de Zulia, jou√©e principalement pendant la p√©riode de No√ęl; le tambor afro-v√©n√©zu√©lien, li√© aux racines africaines et c√©l√©br√© dans les r√©gions c√īti√®res √† l'occasion de f√™tes religieuses syncr√©tiques; ou encore la calypso de El Callao, issue de l'influence carib√©enne des travailleurs antillais venus au XIXe si√®cle. La religion au Venezuela est majoritairement catholique, mais elle se d√©cline en une multitude de formes syncr√©tiques. Le culte marial est omnipr√©sent, en particulier √† travers la v√©n√©ration de la Vierge de Coromoto, patronne nationale. Parall√®lement, des cultes populaires occupent une place essentielle dans la vie religieuse : le plus c√©l√®bre est celui de Mar√≠a Lionza, figure v√©n√©r√©e dans tout le pays. Le spiritisme marialioncero et les cultes aux esprits ou "corte espiritual" t√©moignent de la complexit√© religieuse populaire du pays. La cuisine v√©n√©zu√©lienne est aussi un miroir du multiculturalisme du pays. L'arepa, galette de ma√Įs blanc ou jaune, constitue l'aliment de base du quotidien et se d√©cline en une infinit√© de variantes r√©gionales et personnelles. Le pabell√≥n criollo, plat national, associe riz, haricots noirs, viande effiloch√©e et bananes plantains frites. D'autres mets embl√©matiques sont l'hallaca, consomm√©e durant No√ęl et consid√©r√©e comme un symbole d'unit√© culturelle, faite de p√Ęte de ma√Įs farcie d'un m√©lange de viandes, l√©gumes, olives et raisins, envelopp√©e dans une feuille de bananier. La richesse gastronomique se manifeste √©galement dans la diversit√© des produits tropicaux, poissons, fruits de mer, ainsi que dans les influences andines, cara√Įbes et m√™me arabes, introduites par les diasporas. Les arts plastiques v√©n√©zu√©liens ont connu un essor particulier au XXe si√®cle, avec des figures majeures telles qu'Armando Rever√≥n, c√©l√®bre pour ses oeuvres aux tonalit√©s lumineuses et presque spirituelles, ou encore Carlos Cruz-Diez et Jes√ļs Rafael Soto, ma√ģtres de l'art cin√©tique, dont les installations et sculptures ont marqu√© l'art contemporain international. Ces artistes sont embl√©matiques d'un pays qui conjugue l'ancrage local et une ouverture vers l'avant-garde. L'art populaire, quant √† lui, est omnipr√©sent dans les communaut√©s rurales et urbaines, exprim√© √† travers des fresques murales, des repr√©sentations religieuses sculpt√©es, des masques de carnaval ou des objets en bois peints. Les traditions festives sont nombreuses, fortement ancr√©es dans les calendriers religieux et agricoles. Parmi les plus notables, on trouve la Feria de la Chinita √† Maracaibo, qui allie musique, foi et r√©jouissances populaires; les Diablos Danzantes de Yare, class√©s patrimoine immat√©riel de l'humanit√© par l'Unesco, o√Ļ des danseurs masqu√©s rendent hommage au Saint-Sacrement; le carnaval de Car√ļpano, riche en couleurs et en danses; et la Semana Santa (Semaine sainte), tr√®s suivie, avec des processions et repr√©sentations th√©√Ętrales dans tout le pays. La litt√©rature v√©n√©zu√©lienne offre √©galement une richesse th√©matique et stylistique. Elle a √©t√© marqu√©e, au XIXe si√®cle, par le romantisme et les r√©cits de la guerre d'ind√©pendance, avec des figures comme Andr√©s Bello et Cecilio Acosta. Au XXe si√®cle, la litt√©rature s'ouvre aux grands courants latino-am√©ricains : Arturo Uslar Pietri m√™le histoire et fiction, tandis que R√≥mulo Gallegos, auteur de Do√Īa B√°rbara, traite des tensions entre civilisation et barbarie dans les Llanos. Des voix plus r√©centes comme Ana Enriqueta Ter√°n ou Salvador Garmendia offrent une vision plus introspective ou urbaine. La culture populaire est aussi fortement pr√©sente dans les expressions orales comme les proverbes, les devinettes, les r√©cits de chasseurs ou les chants improvis√©s (coplas), notamment dans les r√©gions rurales. Le llanero, figure mythique des plaines, incarne la bravoure, la libert√© et le lien avec la nature, souvent c√©l√©br√© dans la po√©sie orale et la chanson. Dans les pratiques quotidiennes, les codes de la vie sociale sont marqu√©s par une convivialit√© expressive, un go√Ľt pour l'humour, une forte importance accord√©e √† la famille √©largie, et une culture de la solidarit√©, surtout en p√©riode de crise. Le tutoiement est courant, les gestes affectifs nombreux, et les conversations souvent anim√©es. Economie.
Le Venezuela poss√®de les plus grandes r√©serves prouv√©es de p√©trole au monde, concentr√©es principalement dans la ceinture de l'Or√©noque, une vaste r√©gion riche en p√©trole extra-lourd. L'entreprise publique Petr√≥leos de Venezuela S.A. (PDVSA) a longtemps √©t√© l'acteur central de l'√©conomie v√©n√©zu√©lienne, g√©n√©rant des devises, de l'emploi, et finan√ßant les d√©penses sociales. Cependant, la chute des prix du p√©trole √† partir de 2014, combin√©e √† une forte baisse de la production due au sous-investissement, √† la corruption, √† la fuite des comp√©tences et aux sanctions internationales, a provoqu√© un effondrement de l'√©conomie nationale. Parall√®lement, l'agriculture et l'industrie manufacturi√®re ont connu un net d√©clin. Le secteur agricole, autrefois strat√©gique, a √©t√© largement n√©glig√© et souffre d'un manque d'√©quipements, de financements, et d'acc√®s aux intrants. Cela a conduit √† une forte d√©pendance aux importations alimentaires. L'industrie, quant √† elle, s'est contract√©e sous l'effet des nationalisations massives, des restrictions aux importations de mati√®res premi√®res, de la perte de main-d'oeuvre qualifi√©e et de l'instabilit√© institutionnelle. La situation mon√©taire a √©t√© profond√©ment affect√©e par des ann√©es d'hyperinflation, qui a atteint des sommets mondiaux entre 2017 et 2020. La monnaie nationale, le bolivar, a subi plusieurs d√©valuations et reconversions mon√©taires, sans parvenir √† enrayer la perte de pouvoir d'achat. Cette spirale inflationniste a favoris√© une dollarisation de facto de l'√©conomie, avec une part croissante des transactions courantes qui se r√©aliseen dollars am√©ricains, notamment dans les grandes villes. Le ch√īmage et l'informalit√© sont tr√®s √©lev√©s. Une grande partie de la population active survit gr√Ęce √† l'√©conomie informelle ou aux transferts d'argent en provenance de la diaspora v√©n√©zu√©lienne, qui a massivement √©migr√© depuis la fin des ann√©es 2010. Ces envois de fonds (remesas) constituent aujourd'hui une source vitale de revenus pour de nombreuses familles. En d√©pit de la crise, certaines activit√©s √©conomiques ont r√©sist√© ou connu des mutations. Le commerce de proximit√©, notamment dans les zones frontali√®res, les petites entreprises de services, et les secteurs li√©s √† l'√©conomie num√©rique ont √©merg√© comme alternatives. Des zones franches ou des accords bilat√©raux avec des alli√©s g√©opolitiques ont permis des formes de commerce parall√®le ou de compensation (trocs p√©trole contre biens ou services), contournant partiellement les sanctions impos√©es par les √Čtats-Unis et l'Union europ√©enne. Les politiques √©conomiques r√©centes du gouvernement se caract√©risent par une certaine flexibilisation : r√©duction du contr√īle des prix, autorisation tacite des devises √©trang√®res, r√©ouverture partielle au secteur priv√© et tentatives de stimuler l'investissement √©tranger dans des secteurs strat√©giques. N√©anmoins, ces r√©formes demeurent limit√©es, dans un cadre juridique instable, avec un environnement des affaires jug√© peu attractif en raison du risque politique, de l'absence de garanties judiciaires, et des contraintes internationales. L'√©conomie parall√®le et l'√©conomie ill√©gale jouent √©galement un r√īle significatif, en particulier dans les zones mini√®res du sud du pays (comme le bassin de l'Arco Minero), o√Ļ l'or, les diamants et autres minerais sont extraits dans des conditions g√©n√©ralement opaques et √©chappant partiellement au contr√īle de l'√Čtat. Ce secteur est entach√© d'accusations de violations des droits humains, d'exploitation clandestine et de r√©seaux transfrontaliers de contrebande. En mati√®re de commerce ext√©rieur, le Venezuela a vu ses partenaires traditionnels se r√©orienter. La Chine, la Russie, l'Iran et la Turquie sont devenus des acteurs importants dans les √©changes, notamment en fournissant produits alimentaires, carburants raffin√©s ou services techniques, en √©change d'acc√®s pr√©f√©rentiels aux ressources √©nerg√©tiques ou mini√®res. En d√©pit d'une l√©g√®re reprise de certains indicateurs depuis 2021, notamment dans les zones urbaines les plus connect√©es √† l'√©conomie dollaris√©e, les in√©galit√©s sociales restent tr√®s marqu√©es. La pauvret√© multidimensionnelle touche une majorit√© de la population, et l'acc√®s aux services de base (sant√©, √©lectricit√©, eau potable, transports) demeure largement d√©grad√©. |
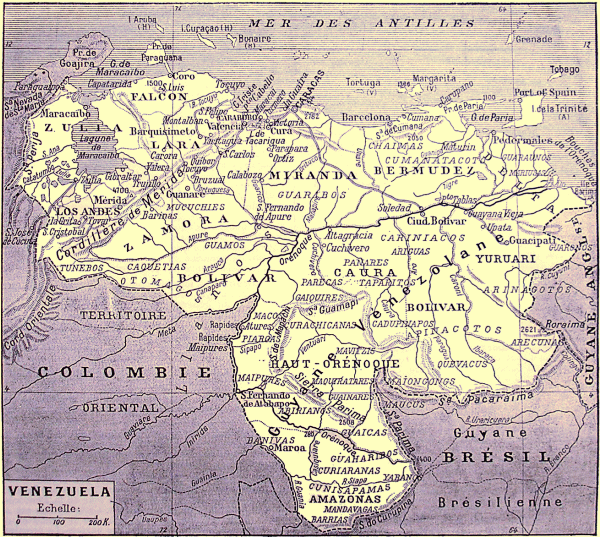
| . |
|
|
|
||||||||
|