| . |
|
||||||
|
|
| . |
|
||||||
|
Republika Srbija |
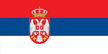
44 00 N, 21 00 E |
La Serbie
est un Etat enclavé de la Péninsule
des Balkans - 
Carte de la Serbie. Source : The World Factbook. (Cliquer sur l'image pour afficher une carte plus dĂ©taillĂ©e). GĂ©ographie physique de la SerbieRelief du Sol.Si l'on excepte la grande plaine de la VoĂŻvodine, au Nord de Belgrade, et qui forme la partie mĂ©ridionale de la plaine hongroise, le relief du sol de la Serbie est très complexe et prĂ©sente un vĂ©ritable dĂ©dale. Les Alpes orientales du cĂ´tĂ© de l'Ouest, les Alpes transylvaines du cĂ´tĂ© Nord-Est, les chaĂ®nes du Rhodope et des Balkans du Sud-Est se donnent rendez-vous-en Serbie, formant un enchevĂŞtrement d'une rare beautĂ© pittoresque. Mais, malgrĂ© le caractère Ă©minemment montagneux du pays, les sommets les plus Ă©levĂ©s dĂ©passent Ă peine 2000 m. Il est intĂ©ressant de remarquer que les monts les plus Ă©levĂ©s se trouvent le long de la frontière Sud et Sud-Est, de sorte que le pays accuse une pente assez prononcĂ©e vers le Nord. Pour la facilitĂ© de la description, on peut diviser les chaĂ®nes montagneuses de Serbie en trois parties : 1° les montagnes de la Serbie occidentale, entre la Drina d'un cĂ´tĂ© et la Koloubara et l'Ibar de l'autre;Les montagnes de la Serbie occidentale se dĂ©tachent des Alpes orientales, spĂ©cialement du colossal massif montagneux de Montenegro. Les points culminants de ce rameau, le Yavor (1700 m.) et le Golia (1981 m) s'Ă©lèvent le long de la frontière Sud-Ouest mĂŞme de la Serbie. Parmi les autres sommets de la Serbie occidentale, les plus importantes sont le Moutchan (1517 m), la Tchigota (1344 m), le Tchemerno (1649 m), le Troglav (1481 m), le Ovtchar (998 m), le Kablar (983 m), le Povlen (1480 m), le Yablanik (1306 m), le Medvednik (1246 m), le Vlachitch et le Tzer (600 m). Les montagnes de la Choumadia (pays des forĂŞts) ou de la Serbie centrale se rattachent Ă celles de la Serbie occidentale par le mont Malien (997 m). Les monts les plus Ă©levĂ©s de cette rĂ©gion sort le Grand Chtouratz (1169 m), le Petit Chtouratz (1031 m), le Yentchatz (675 m), la Boukoulia (720 m), le KosmaĂŻ (624 m), le mont Avala (560 m), le Tzrni-Vrh, dominant la ville de KragouĂŻĂ©vatz (577 m). Parmi les montagnes de la Serbie centrale, le Kopaonik occupe la première place. Sa chaĂ®ne Sud-Sud-Est entre en Turquie pour une distance de 36 km. Le sommet le plus Ă©levĂ© de ces montagnes est le Souho Roudichte (2140 m). Au Nord de Kapaonik s'Ă©lèvent le JĂ©line (1836 m), les Stolovi (1443 m), au Nord-Est le grand Yastrebatz (1566 m). Les montagnes de la Serbie orientale, Ă
l'E. de la Morava méridionale et de la grande Morava, sont dans leur partie
du Sud la continuation du système du Rhodope, dans leur partie du Nord
elles sont la continuation des Carpates du Banat Dans le groupe appartenant aux Carpates, le pic Malinik, sur la chaîne des Gouloubinié planiné, atteint l'altitude de 1142 m, le Deli Yovan (1201 m), etc. En général, les flancs des montagnes de la Serbie sont couverts de belles forêts. Géologie.
RĂ©gime des eaux.
La Binatchka Morava reçoit : à droite, la Vlassina (80 km), la Nichava (100 km) et la Moravitza (45 km); à gauche, la Véternitza (54 km), la Yablanitza (67 km), la Pousta Reka (36 km) et la Toplitza (180 km). La Goliska Morava reçoit : à gauche, le Rzav (45 km), la Diétina (45 km), le Skrapèje (45 km), la Tchémernitza (40 km) et la Grouja (45 km), à droite, la Bélitza (40 km), l'lbar (60 km) et la Racina (45 km). La grande Morava reçoit : à gauche, le Lougomir (45 km), la Bélitza (32 km), la Lépenitza (45 km) et la Yassénitza (72 km); à droite, la Tzrnitza (32 km) et la Réssava (63 km). La Mlava, le Pek et le Timok se jettent dans le Danube. Le Timok est formé de deux branches maîtresses : Beli et Tzrni Timok. Beli Timok venant du Sud, appelé encore le grand Timok, est formé à son tour de deux branches : Svrlichki et Trgovichki Timok. La Drina se jette dans la Save; elle reçoit à son tour à droite la Loubovia et le Yadar. La Save reçoit encore la Koloubara (80 km). Climat.
Les changements de température sont fréquents en hiver, L'hiver, quelquefois très doux et sec, est quelquefois rigoureux, et la neige tombe en abondance. Le froid est plus intense dans l'Est que dans l'Ouest. La belle saison commence au mois d'avril et finit au mois d'octobre; l'automne est particulièrement agréable en Serbie. La hauteur annuelle de la pluie est de 600 à 800 mm, y compris environ 100 mm de neige. C'est au printemps que la pluie est la plus abondante; elle est est apportée surtout par les vents d'Ouest. Biogéographie de la SerbieLa Serbie est à l'intersection des influences méditerranéennes, continentales et alpines.Le nord du pays, notamment la plaine de Voïvodine, fait partie de la vaste région pannonienne, caractérisée par des terres alluviales riches, des steppes et des forêts riveraines. Cette zone abrite des espèces caractéristiques des prairies continentales, dont le Grand Tétras, l'Outarde canepetière et de nombreux rongeurs des plaines d'Europe centrale. Les écosystèmes humides, tels que ceux des marais et des bras morts du Danube et de la Tisza, abritent une avifaune aquatique dense, comme le pélican frisé, les hérons pourprés et les cigognes noires. La région centrale, dominée par des collines et des plateaux, présente une végétation de transition, où les forêts mixtes de hêtres, de charmes et de chênes couvrent une grande partie des reliefs. Ces forêts accueillent des espèces telles que le chat sauvage, le lynx boréal et l'ours brun dans les zones plus reculées. L'altitude croissante vers le sud et l'ouest, notamment dans les montagnes des Alpes dinariques, favorise la présence de forêts montagnardes de conifères, de hêtraies-sapinières et de formations supra-méditerranéennes. Ces forêts alpines et subalpines sont d'une grande importance pour la conservation de la biodiversité balkanique. Les zones karstiques, notamment dans le sud-ouest, offrent des habitats particuliers avec une flore endémique adaptée aux sols calcaires et à l'aridité relative. On y trouve de nombreuses espèces relictuelles datant des glaciations, qui témoignent du rôle de la Serbie comme refuge climatique durant ces périodes. C'est notamment le cas du parc national de Tara, où les forêts de pin de Pancicie, endémique de cette région, illustrent cette fonction de sanctuaire naturel. Le réseau hydrographique dense, dominé par le Danube, la Save, la Morava et la Drina, constitue un corridor écologique majeur. Ces cours d'eau jouent un rôle vital pour les migrations d'oiseaux et la survie d'espèces aquatiques, telles que les esturgeons, aujourd'hui en fort déclin, ou le vison d'Europe. La richesse floristique est également marquée par une forte proportion d'endémismes balkanique et local, en particulier dans les régions montagneuses du sud et de l'est. Les pelouses alpines, les falaises calcaires, les forêts relictuelles et les tourbières d'altitude hébergent des plantes rares comme Ramonda serbica, une espèce emblématique des Balkans, capable de survivre à la dessiccation. Enfin, l'empreinte humaine, bien que forte dans les zones agricoles et urbaines, a permis dans certains cas la préservation de milieux semi-naturels tels que les pâturages extensifs, les prairies humides ou les vergers traditionnels, qui constituent des habitats importants pour la biodiversité. Cependant, les menaces comme la déforestation illégale, l'intensification agricole, la pollution des rivières et la fragmentation des habitats pèsent sur la conservation de cette diversité biologique. Des efforts de protection sont en place, notamment via les parcs nationaux (Tara, Kopaonik, Djerdap, Šar Planina), les sites Natura 2000 en cours de désignation, et les réserves naturelles strictes. Géographie humaine de la SerbiePopulation.Selon les données les plus récentes, la population totale de la Serbie (hors Kosovo) est estimée à environ 6,6 millions d'habitants. Ce chiffre est en constante diminution depuis plusieurs décennies en raison de plusieurs facteurs : une natalité faible, une mortalité élevée et une émigration massive, en particulier des jeunes et des diplômés. Le taux de fécondité reste parmi les plus bas d'Europe. Il avoisine 1,5 enfant par femme, bien en dessous du seuil de remplacement des générations. La proportion des personnes âgées de plus de 65 ans dépasse désormais 20 %, tandis que les jeunes de moins de 15 ans représentent moins de 15 %. Ce déséquilibre démographique pèse lourdement sur le système de retraites, les services de santé et les politiques sociales. L'émigration est un autre facteur déterminant dans l'évolution démographique de la Serbie. Depuis les années 1990, plusieurs vagues migratoires ont touché le pays, en particulier à la suite des conflits dans l'ex-Yougoslavie, de la crise économique prolongée et du manque de débouchés professionnels. Des centaines de milliers de Serbes, notamment qualifiés, ont rejoint l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, le Canada et les États-Unis. Ce phénomène entraîne une véritable « fuite des cerveaux », qui affaiblit le potentiel de développement du pays tout en renforçant la dépendance aux transferts d'argent de la diaspora, lesquels représentent une part significative du PIB. Les inégalités sociales et économiques sont marquées, notamment entre les régions du nord, plus développées et connectées à l'Europe centrale, et le sud du pays, plus rural et économiquement marginalisé. Le taux de pauvreté est plus élevé dans les zones rurales, particulièrement dans le sud-est et le sud-ouest. Les Roms sont la communauté la plus touchée par l'exclusion sociale, avec un accès limité à l'éducation, à l'emploi formel et aux soins de santé. L'illettrisme fonctionnel et l'abandon scolaire précoce sont particulièrement préoccupants dans cette population. L'urbanisation progresse lentement, mais Belgrade concentre à elle seule plus de 20 % de la population nationale. Cette concentration urbaine crée un déséquilibre spatial croissant, qui aggrave le dépeuplement des zones rurales, où l'on observe des villages entiers abandonnés ou peuplés uniquement de personnes âgées. D'autres grandes villes comme Novi Sad, Niš et Kragujevac jouent un rôle régional important, mais restent loin derrière Belgrade en termes de services, d'emplois et de dynamisme culturel. La transition socio-économique post-socialiste a profondément bouleversé les structures sociales. Le recul des protections sociales, la privatisation massive et l'effondrement de certains secteurs industriels ont entraîné une précarisation croissante, particulièrement dans les années 1990 et 2000. Bien que certains indicateurs montrent une amélioration depuis les années 2010, les inégalités se creusent et la mobilité sociale reste faible. L'économie informelle continue de jouer un rôle majeur, notamment dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et des services domestiques. La société serbe reste marquée par des valeurs relativement conservatrices, en particulier dans les domaines de la famille, du rôle des genres et de la religion. La majorité de la population se déclare de religion orthodoxe, bien que la pratique religieuse reste variable. Les Églises jouent un rôle non négligeable dans le discours public, notamment sur les questions sociétales comme les droits des LGBT, les relations de genre et l'éducation sexuelle. Les jeunes générations, davantage exposées aux influences extérieures via les médias et les réseaux sociaux, montrent une ouverture plus grande, mais doivent composer avec un marché du travail restreint et un climat d'instabilité politique chronique. La société civile est dynamique, bien que confrontée à des pressions politiques, notamment dans le domaine des médias et des ONG critiques du pouvoir. Les mouvements féministes, écologistes et les initiatives citoyennes émergent surtout en milieu urbain, mais peinent à se structurer durablement face à la centralisation du pouvoir et à la méfiance persistante envers les institutions. Quelques-unes des principales villes de la Serbie
Groupes ethnolinguistiques.
La pluralité ethnolinguistique de la Serbie est protégée par la Constitution, mais les tensions identitaires, les inégalités sociales et les effets du passé récent continuent d'influencer la coexistence entre communautés. L'éducation bilingue, les médias minoritaires et les conseils nationaux des minorités sont des mécanismes institutionnels qui visent à préserver les droits linguistiques et culturels, bien qu'ils soient parfois limités dans leur mise en oeuvre. Serbes.
Hongrois.
Roms.
Bosniaques.
Albanais.
Slovaques.
Roumains
et Valaques.
Croates.
Bulgares.
De leur côté, les Bulgares vivent dans la région frontalière de Bosilegrad et Dimitrovgrad. Ils parlent le bulgare, et sont également reconnus comme minorité nationale. Autres
groupes.
Culture.
La littérature serbe trouve ses origines dans la période médiévale avec des oeuvres hagiographiques rédigées en slavon d'église, souvent produites dans les monastères orthodoxes, comme ceux de Studenica ou Hilandar. Saint Sava, figure centrale du XIIe siècle, incarne la synthèse spirituelle et culturelle nationale, fondateur de l'Église orthodoxe serbe autocéphale. Les épopées orales, habituellement chantées au gusle, un instrument monocorde traditionnel, ont joué un rôle crucial dans la préservation de l'identité nationale sous la domination ottomane. Ces récits, glorifiant les exploits des héros médiévaux comme le prince Lazar ou le tsar Dušan, ont été collectés au XIXe siècle par des ethnographes et poètes comme Vuk Karadžić, réformateur majeur de la langue serbe et de l'alphabet cyrillique moderne. L'art visuel serbe s'est d'abord développé dans le cadre religieux, à travers les fresques byzantines des monastères. À l'époque moderne, des peintres comme Paja Jovanović et Uroš Predić ont marqué l'art académique avec des représentations historiques et réalistes. Le XXe siècle a vu l'émergence de mouvements d'avant-garde à Belgrade, notamment le surréalisme et le modernisme, avec des artistes comme Ljuba Popović ou Marina Abramović, cette dernière étant devenue une figure mondiale de l'art contemporain et de la performance. La musique traditionnelle serbe reflète la diversité des influences régionales. Elle se distingue par l'usage du kolo, danse collective en cercle accompagnée de musique rythmée, et d'instruments comme le frula (flûte), le tambura et l'accordion. La musique tsigane y tient également une place importante, notamment dans les fanfares balkaniques, avec des artistes comme Goran Bregović ou Emir Kusturica, qui mêlent traditions musicales, satire sociale et esthétiques cinématographiques. La scène musicale contemporaine est dynamique, allant du rock alternatif (Ekatarina Velika, Bajaga) au hip-hop urbain et à la pop-folk (ou turbo-folk), genre souvent critiqué pour sa superficialité mais extrêmement populaire. Le théâtre et le cinéma occupent également une place importante dans la culture serbe. Le théâtre national de Belgrade, fondé en 1868, demeure une institution majeure. Le cinéma serbe, quant à lui, a été largement influencé par les conflits des années 1990, avec des réalisateurs tels que Emir Kusturica, Dušan Makavejev ou plus récemment Srdan Golubović, dont les oeuvres interrogent la violence, l'identité et la mémoire collective. Le cinéma documentaire et les festivals comme le FEST (Festival international du film de Belgrade) ou le festival de Palić contribuent à faire rayonner la production nationale et régionale. Sur le plan religieux, l'Église orthodoxe serbe reste un acteur fondamental dans la vie culturelle et sociale, particulièrement dans les zones rurales. Les fêtes religieuses rythment le calendrier, la plus emblématique étant la Slava, fête patronale familiale unique au monde orthodoxe, qui honore un saint spécifique pour chaque lignée familiale. Cette tradition, inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco, symbolise la continuité entre identité religieuse, structure familiale et mémoire collective. L'architecture serbe présente également une grande variété. Les monastères médiévaux et les églises orthodoxes aux dômes bulbeux côtoient les édifices baroques et classiques hérités de la période austro-hongroise en Voïvodine. Belgrade mêle brutalisme socialiste, constructions ottomanes anciennes et architectures modernes. L'héritage yougoslave a laissé une empreinte durable avec ses monuments commémoratifs appelés spomeniks, emblèmes de la mémoire antifasciste et du modernisme architectural d'après-guerre. La gastronomie serbe reflète la rencontre des traditions balkaniques, slaves et ottomanes. Elle repose sur une cuisine généreuse et épicée, avec des plats emblématiques comme le ćevapi (petits rouleaux de viande grillée), le sarma (choux farcis), le gibanica (feuilleté au fromage), ou encore le kajmak (crème fermentée). Les repas sont généralement conviviaux et abondants, accompagnés de rakija, une eau-de-vie de fruits très populaire. Le café turc reste une institution sociale incontournable. La culture populaire contemporaine, fortement influencée par la télévision, les réseaux sociaux et la diaspora, évolue dans un paysage contrasté entre héritage traditionnel et mondialisation. Des émissions de téléréalité côtoient des productions littéraires engagées, et la jeunesse oscille entre une forte conscience historique et un désir d'ouverture vers l'Europe. Economie.
Le produit intérieur brut repose essentiellement sur le secteur des services, qui représente plus de 60 % de l'économie, suivi par l'industrie (environ 25 %) et l'agriculture (environ 10 %, mais plus importante en termes d'emploi rural). Le secteur tertiaire comprend la finance, les télécommunications, les transports, le commerce de détail et un secteur touristique en développement, surtout dans les domaines du tourisme urbain, de nature et de santé. Belgrade, Novi Sad et Niš concentrent les principales activités économiques et accueillent les sièges d'entreprises nationales et étrangères. L'industrie serbe est relativement diversifiée. On trouve des activités métallurgiques, automobiles, chimiques, agroalimentaires, textiles et électroniques. Kragujevac, ancien centre de production de véhicules Zastava, abrite désormais l'usine Fiat, reflet de l'intégration partielle dans les chaînes de production européennes. Le pays mise également sur le développement de zones industrielles libres et de partenariats public-privé pour attirer les investissements directs étrangers (IDE), qui sont devenus un moteur crucial de croissance, notamment dans les secteurs manufacturiers et des technologies de l'information. Le secteur agricole reste un pilier économique pour de nombreuses régions rurales. La Serbie dispose de terres fertiles, en particulier dans la plaine pannonienne de Voïvodine, qui produisent des céréales (blé, maïs), des fruits (pommes, prunes, framboises) et du vin. Elle est l'un des premiers exportateurs mondiaux de framboises. L'agriculture reste majoritairement familiale, avec un faible niveau de mécanisation dans certaines zones, ce qui limite la compétitivité globale malgré le potentiel. L'économie numérique est en plein essor. Belgrade s'affirme comme un centre régional de l'outsourcing informatique et du développement logiciel, avec une main-d'oeuvre jeune, qualifiée et relativement bon marché. Le secteur des technologies de l'information contribue à plus de 6 % du PIB, et les exportations de services informatiques sont en forte croissance. Des entreprises locales se distinguent sur le marché international, tandis que de nombreuses start-ups se développent dans les domaines de la fintech, de l'intelligence artificielle ou du jeu vidéo. La balance commerciale reste structurellement déficitaire. La Serbie exporte principalement des produits agricoles, des métaux, de l'automobile et des services informatiques, mais importe massivement des machines, de l'énergie, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation. Ses principaux partenaires commerciaux sont l'Union Européenne, en particulier l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie et la Slovénie, mais aussi la Russie, la Chine et les pays des Balkans occidentaux. Elle bénéficie de l'accord de libre-échange CEFTA, facilitant ses échanges régionaux, et de l'accord de stabilisation et d'association avec l'UE, bien que la pleine adhésion reste en suspens. Le dinar serbe (RSD) est la monnaie nationale, sous l'autorité de la Banque nationale de Serbie, qui maintient une politique monétaire prudente et un régime de change relativement stable. L'inflation a été maîtrisée pendant plusieurs années, mais elle a connu une hausse significative à partir de 2022, dans le contexte international de tensions post-covid et de guerre en Ukraine, affectant le pouvoir d'achat des ménages. Les finances publiques ont été marquées par une série de réformes budgétaires et de privatisations, avec des progrès dans la réduction du déficit public et de la dette, qui reste sous les 60 % du PIB. Toutefois, des défis persistent : forte dépendance aux investissements étrangers, corruption, lenteur de la justice économique, poids du secteur informel (estimé à plus de 20 % du PIB), et faiblesse de l'administration fiscale dans certaines zones. L'économie souterraine touche notamment les secteurs de la construction, de l'agriculture et des services personnels. Le marché du travail est caractérisé par un taux de chômage structurellement élevé, bien qu'en baisse ces dernières années (environ 10 %). Le taux d'emploi reste inférieur à la moyenne européenne, et de fortes disparités régionales subsistent. La jeunesse est particulièrement touchée, avec un chômage élevé chez les 18–30 ans, accentué par une émigration continue des travailleurs qualifiés vers l'Union Européenne. Ce phénomène affecte également les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'ingénierie. Les inégalités sociales et territoriales sont notables. Le nord du pays, notamment la Voïvodine, est plus riche et intégré, alors que le sud et l'est restent économiquement fragiles. Le revenu moyen reste relativement bas, avec un salaire mensuel net moyen d'environ 750 euros, mais les écarts entre la capitale et les zones rurales sont importants. La pauvreté touche environ 20 % de la population, avec des pics dans les populations vulnérables comme les Roms ou les travailleurs agricoles. Enfin, la politique économique serbe est orientée vers une convergence avec les standards européens, mais elle reste tiraillée entre les intérêts économiques de l'Ouest (UE, FMI, Banque mondiale) et ceux de partenaires comme la Chine et la Russie. Pékin investit massivement dans les infrastructures (routes, chemins de fer, énergie), tandis que Moscou demeure un fournisseur majeur de gaz naturel. Ces partenariats stratégiques, souvent opaques, suscitent des tensions entre ouverture aux marchés mondiaux et préservation de la souveraineté économique. |
| . |
|
|
|
||||||||
|