| . |
|
||||||
|
|
| . |
|
||||||
| Histoire de la philosophie > la philosophie française / les Lumières |
| Histoire
de la philosophie
La philosophie française au XVIIIe siècle Les philosophes des Lumières (Condillac, Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc.) |
Philosophie spéculativeCe n'est pas dans la philosophie spéculative, mais dans la philosophie morale et politique que se montre l'originalité des penseurs français au XVIIIe siècle. Importée en France par Voltaire, la doctrine de Locke exerce une influence prépondérante.Condillac.
Pour Condillac, toutes nos sensations sont les signes des choses, et nous les représentons elles-mêmes par des sensations plus subtiles qui deviennent les signes de ces signes l'analyse des signes et la reconnaissance de leur identité fondamentale sous leurs différentes transformations, font toute la force de l'algèbre et de la géométrie; les sciences ne sont au fond que des langues bien faites, et la nature est un ensemble de symboles qu'elles traduisent en symboles de plus en plus abstraits. Nous allons expliquer brièvement cette théorie. Condillac enseigne que « toutes nos connaissances et toutes nos facultés viennent des sens ou, pour parler plus clairement, des sensations. »Et pour nous faire comprendre le comment de ce phénomène, il a imaginé l'hypothèse aussi étrange qu'originale de l'homme-statue. Supposons une statue intérieurement organisée comme nous, mais empêchée par son enveloppe de marbre d'avoir des sensations et arrivant à la vie intellectuelle à mesure qu'on la dépouille de son enveloppe et qu'on lui rend successivement l'usage de ses sens. Il commence par se demander quelles seraient les connaissances de cet homme-statue si, faisant disparaître une partie de l'enveloppe de marbre, il avait l'usage d'un seul sens, celui de l'odorat, par exemple. Alors, dit Condillac, « les connaissances de notre statue ne peuvent s'étendre qu'à des odeurs. » On lui présente une rose. Elle est d'abord toute odeur de rose; elle n'a pas encore la notion d'objet, mais cette sensation étant la seule qui la sollicite, est exclusive et devient attention. On lui présente ensuite une violette, un jasmin, de l'assa foetida. Sa première sensation ne pouvait être pour elle ni agréable ni désagréale, mais avec d'autres impressions elle peut comparer, trouver les unes agréables et les autres désagréables. Dès lors naît le désir, la volonté. Et de cette unique sensation de l'odeur, par voie de génération et de transformation, il déduit l'existence de l'âme et de ses facultés. Celles-ci, il les divise en intellectuelles et en affectives. Les facultés intellectuelles, qu'il ramène à une faculté générale appelée entendement, sont l'attention, la mémoire, la comparaison, le jugement, la réflexion, l'imagination, le raisonnement. A leur tour, les facultés affectives ramenées à une seule qui est la volonté, s'appellent le plaisir ou la peine, le désir ou l'aversion, l'amour ou la haine, l'espérance ou la crainte. Qu'on lui rende le goût, l'ouïe, la vue, on enrichira encore sa vie intellectuelle, sans cependant lui donner l'idée d'objet extérieur à elle; mais qu'on y ajoute le toucher, alors on lui révèlera le monde objectif, en lui donnant les idées d'étendue, le forme, de solidité, de corps. La vue seule ne saurait lui fournir ces connaissances, comme l'a prouvé l'opération d'un aveugle-né par Cheselden. Il est des caractères communs aux différentes sensations qui lui restent dans la mémoire. Elle les distingue des sensations auxquelles ils sont liés et elle fait ainsi de l'abstraction et obtient des idées générales. Quant au moi, dont elle prend conscience, ce n'est pas autre chose que la somme de nos sensations présentes et de celles que la mémoire nous rappelle. Et ainsi, se posant toujours la même question : à quoi se bornerait la connaissance de notre homme-statue s'il avait en plus l'usage du sens de l'ouïe, de la vue, du goût. Il conclut que « la sensation enveloppe toutes les facultés de l'âme », ou mieux, que toutes nos connaissances n'ont qu'une seule et même source : la sensation; ou bien, elles ne sont que des sensations transformées. Cette conclusion dépasse celle de Locke qui admettait la réflexion comme une des sources de nos connaissances. Plus fidèle à l'enseignement du philosophe anglais dans son Essai sur l'origine des connaissances humaines, Condillac s'en sépare dans le Traité des sensations. Aussi bien l'homme-statue s'identifie avec la première sensation qu'il éprouve. « Si nous lui présentons une rose, dit-il, elle sera, par rapport à nous, une statue qui sent une rose ; mais, par rapport à elle, elle ne sera que l'odeur de cette fleur. »" [c'est-à-dire, odeur de rose].Il en est de même pour les autres sensations. La conséquence est la négation de la substantialité du moi, qui devient une collection de sensations. Le philosophe s'occupe beaucoup de la question du langage. Il en admet l'origine artificielle et conventionnelle. Pour lui, les idées abstraites ne sont que des dénominations : c'est du nominalisme; l'entendement et la volonté sont simplement des signes, la science n'est qu'une langue bien faite, l'art de raisonner n'est que l'art de parler . Condillac est sensualiste, mais il ne conclut pas toutefois au matérialisme. Il admet avec les cartésiens que le sujet de la sensation né peut être de nature corporelle. Toutefois, il n'adhère pas à l'immatérialisme de Berkeley et admet qu'il y a autre chose que l'humain. Diderot.
Naître et mourir, ce n'est que changer
de forme; une fermentation sans relâche, un échange, incessant
de substance, une circulation perpétuelle de la vie, voilà
l'énigme de l'existence, telle que déjà Héraclite
l'avait conçue. « Élargissez Dieu », disait Diderot,
« montrez-le à l'enfant, non dans le temple, mais partout
et toujours ». Il termine ainsi son traité de l'Interprétation
de la nature « J'ai commencé par la nature, qu'ils ont appelée ton ouvrage, et je finirai par toi, dont le nom sur terre est Dieu. Ô Dieu, je ne sais si tu es; mais je penserai comme si tu voyais dans mon âme, j'agirai comme si j'étais devant toi [...] Je ne te demande rien dans ce monde; car le cours des choses est nécessité par lui-même si tu n'es pas, ou par ton décret si tu es. J'espère en tes récompenses dans l'autre monde s'il y en a un, quoique, tout ce que je fais dans celui-ci, je le fasse pour moi. Si je suis le bien, c'est sans effort : si je laisse le mal, c'est sans penser à toi [...]. Me voilà tel que je suis, portion nécessairement organisée d'une matière éternelle et nécessaire, ou peut-être ta créature. » (Système de la nature).D'Holbach, Voltaire, Rousseau... Le baron d'Holbach expose des idées analogues, mais plus mécanistes, et ramène tout aux lois de la nature. Lamettrie réduit l'humain à une sorte de mécanisme brut, dans l'Homme-machine et dans l'Homme-plante. Les naturalistes Bonnet et Robinet insistent principalement sur les idées leibniziennes de série, de développement continu, de progrès historique. Bonnet admet la possibilité pour tout être d'une naissance nouvelle, manifestée par des organes supérieurs, ou d'une palingénésie. Voltaire professe un demi-spiritualisme, et défend toute sa vie la croyance en un «-Dieu rémunérateur et vengeur », ainsi qu'en la liberté morale de l'humain. Il condamne le système d'Helvétius. Buffon, Montesquieu, Turgot, J.-J. Rousseau, demeurent également attachés à une philosophie semi-spiritualiste; le dernier réfute éloquemment le sensualisme dans sa Profession de foi d'un vicaire savoyard. En résumé, dans l'ordre des recherches métaphysiques et morales, la philosophie française ne s'élève guère alors au-dessus du naturalisme ou d'un demi-rationalisme. En revanche, dans l'ordre des recherches sociales, elle va préparer l'avènement et d'un monde nouveau et d'une philosophie nouvelle. Philosophie socialeLe XVIIIe siècle a étudié l'ordre social sous des points de vue différents dans l'ordre métaphysique. Il nous offre d'abord une conception sensualiste et utilitaire de la société-: celle d'Helvétius et de ses adeptes, qui fondent tous les rapports des hommes entre eux sur la recherche du plaisir. Nous y trouvons ensuite une conception rationaliste et intellectualiste qui ramène les lois sociales aux rapports nécessaires des choses : c'est celle de Montesquieu et de son école. Enfin, nous y voyons naître une philosophie supérieure où la volonté a le principal rôle, et où les lois sociales deviennent des rapports libres entre les volontés : c'est la doctrine de Rousseau, qui cherche à fonder l'ordre civil et politique, non plus sur l'intérêt sensible ni sur les nécessités logiques saisies par l'intelligence, mais sur l'égalité des libertés. La loi, dit Helvétius, est la sensation; la loi est la raison, dit Montesquieu; la loi est la liberté, dira Rousseau.Helvétius.
« Toute l'étude des moralistes consiste à déterminer l'usage qu'on doit faire des récompenses et des punitions, et les secours qu'on en peut tirer pour lier l'intérêt personnel à l'intérét général. Cette union est le chef-d'oeuvre que doit se proposer la morale. Si les citoyens ne pouvaient faire leur bonheur particulier sans faire le bien public, il n'y aurait alors de vicieux que les fous; tous les hommes seraient nécessités à la vertu, et la félicité des nations serait un bienfait de la morale.» (De l'Esprit).Montesquieu. Helvétius avait voulu faire la physique des moeurs et des lois. Montesquieu veut pour ainsi dire en faire la logique. Selon Montesquieu (Esprit des lois « Il y a une raison primitive, et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et les différents êtres, et les rapports de ces différents êtres entre eux [...]. Les êtres particuliers et intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites, mais ils en ont aussi qu'ils n'ont pas faites; avant qu'il y eût des lois, il y avait des rapports de justice possibles; dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé des cercles, tous les rayons n'étaient pas égaux. »On reconnaît la doctrine rationaliste de Platon et des Stoïciens. Le XVIIIe siècle s'élèvera bientôt, avec Rousseau, à une conception de la loi moins intellectuelle et plus voisine de la libre volonté. Il semblerait, d'après les définitions fondamentales de Montesquieu, que la loi possède un caractère absolu, comme la raison dont elle émane. Montesquieu au contraire insiste sur la relativité des lois, et sur leur dépendance par rapport à toutes les conditions extérieures. C'est que l'intelligence est essentiellement la faculté de comprendre, et que comprendre, c'est saisir entre les choses des relations, c'est apercevoir la relativité des choses. Après avoir paru rationaliste comme Platon, Montesquieu devient bientôt empiriste en politique comme Aristote. « Les lois, dit-il, sont relatives à la nature et au principe du gouvernement; elles sont relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir; à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs moeurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports entre elles; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer. J'examinerai tous ces rapports : ils forment tous ensemble ce qu'on appelle l'esprit des lois. »L'esprit des lois ne signifie donc pour Montesquieu que leur nature, ou leur histoire naturelle. Montesquieu, au fond, ne s'élève guère au-dessus des considérations naturalistes, qui ont essentiellement pour objet les choses et leurs rapports nécessaires. De là, chez lui, une tendance à comprendre ce qui est plutôt qu'à chercher ce qui doit être; un penchant à expliquer les choses par la nécessité des causeset des effets, plutôt qu'à montrer dans les personnes la liberté morale et sociale se dégageant peu à peu des nécessités naturelles. Cette tendance historique et parfois fataliste se retrouvera dans l'école allemande du XIXe siècle, qui s'appellera elle-même École historique. Néanmoins il est si difficile de comprendre les lois dans leurs causes sans les juger par rapport à leur fin, que Montesquieu mêle sans cesse des jugements à ses explications, et qu'il se fait ainsi le promoteur d'un grand nombre de réformes. Si Montesquieu eût introduit dans
son histoire des lois humaines la grande idée d'évolution
ou de développement progressif que les savants d'alors commençaient
à transporter dans l'histoire de la nature, les observations de
ce grand penseur y eussent gagné plus de hauteur. C'est en se plaçant
à ce point de vue du progrès historique
qu'on peut le mieux apprécier sa doctrine et qu'on la voit sous
son meilleur jour.
Telles sont, dans leur généralité, les trois genres de sociétés politiques que l'histoire des législations nous révèle. Examinons maintenant dans le détail la valeur propre aux diverses formes de gouvernement, le mécanisme qui les constitue, le ressort qui les meut. Le
despotisme.
« Quand les sauvages de la Louisiane, dit Montesquieu, veulent avoir des fruits, ils coupent l'arbre au pied et cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique. »Le despotisme où le monarque commande sans lois, s'est adouci à la longue pour devenir la monarchie régulière, où le monarque commande selon des lois. Cette seconde forme de gouvernement est un mélange de loi et de force; c'est un despotisme mitigé. Aussi la distinction établie par Montesquieu.htm entre le despotisme et la monarchie proprement dite est-elle plutôt une différence de degrés, fondée sur le développement historique, qu'une différence de nature, fondée sur des considérations philosophiques. Voltaire remarque, en commentant Montesquieu, qu'il n'y a pas de différence essentielle entre le despotisme sans lois et la monarchie pure, ou un seul fait la loi. « Ce sont, dit Voltaire, deux frères qui ont tant de ressemblance qu'on les prend souvent l'un pour l'autre. Avouons que ce furent de tous temps deux gros chats à qui les rats essayèrent de pendre une sonnette au cou. »La loi est cette sonnette qui vous avertit du moins de ce qui vous menace. La
monarchie.
« La nature de l'honneur est de demander des préférences et des distinctions » [ ou ce qu'on appelle] « des honneurs».Il en résulte, dans la monarchie, une inégalité du haut en bas de l'échelle, et une hiérarchie artificielle d'institutions ou de classes, fondée sur des opinions provisoires et destinées à disparaître. Voilà, selon Montesquieu, ce mécanisme monarchique où se mêlent l'arbitraire de la force et la fixité des règles, intermédiaire qui dénote une société partie du despotisme et en marche vers la démocratie. La
démocratie.
Montesquieu ajoute que, dans une république vraiment libre, et conséquemment éclairée sur ses propres affaires : « Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier une partie de son autorité. Il n'a qu'à se déterminer par des choses qu'il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très bien qu'un homme a été souvent à la guerre, qu'il y a eu tels ou tels succès : il est donc très capable d'élire un général » [, et ainsi du reste].Le principe intérieur qui fait durer les républiques, selon Montesquieu, est la vertu sociale proprement dite ou « vertu politique ». Déjà les anciens, comme Platon et Aristote, avaient considéré la vertu comme essentielle à la démocratie, mais ils prenaient ce mot en un sens trop large, l'étendant à toutes les qualités morales. Telle n'est pas la pensée de Montesquieu. « Ce que j'appelle vertu dans la république est l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité. Ce n'est point une vertu morale, ni une vertu chrétienne, c'est la vertu politique; et celle-ci est le ressort qui fait mouvoir le gouvernement républicain, comme l'honneur est le ressort qui fait mouvoir la monarchie. »On pourrait remarquer que la vertu politique, ainsi définie par Montesquieu, reste encore trop vague : « C'est, dit-il, l'amour de la patrie et de l'égalité »; plus loin il dit : « La place naturelle de la vertu est auprès de la liberté» .Il eût dû réunir ces divers éléments dans une définition plus complète. Le vrai principe du gouvernement républicain n'est-il pas le respect pour l'égalité des libertés, qui constitue le droit? En d'autres termes, tandis que les autres gouvernements sont fondés sur des privilèges particuliers, celui-là n'est-il pas fondé sur le droit commun? Tandis que les autres supposent une part plus ou moins grande de servitude, conséquence nécessaire de tout privilège, celui-là ne suppose-t-il pas la liberté dans l'égalité, condition de la justice? Aussi n'y a-t-il en réalité que deux sortes de gouvernements : gouvernements de privilège et gouvernements de droit, États complètement ou partiellement despotiques, et États libres. Montesquieu, dans ses Lettres persanes, cite avec admiration « cette république de Hollande, si respectée en Europe, si formidable en Asie, où ses négociants voient tant de rois prosternés devant eux »; il cite de même la Suisse « qui est l'image de la liberté. » Il fait remarquer que « la Hollande et la Suisse, qui sont les deux pays les plus mauvais de l'Europe, sont cependant les plus peuplés. » Enfin il ajoute : « Le sanctuaire de l'honneur (il s'agit cette fois du véritable), de la réputation et de la vertu, semble être établi dans les républiques, dans les pays où l'on peut prononcer le mot de patrie. » (Lettre 89).Néanmoins, Montesquieu, conserve toujours sur le gouvernement républicain et sur sa possibilité une partie des préjugés de son époque, parce qu'il songe trop aux républiques de l'Antiquité. Il étend trop loin, comme les Anciens, la « vertu » nécessaire au gouvernement d'une nation par elle-même : il ne voit pas que cette vertu est simplement le respect de la justice, et que, la justice étant l'intérêt commun par cela même qu'elle est la liberté commune, chaque citoyen d'un gouvernement libre est d'abord intéressé à respecter la justice par amour de soi, puis obligé moralement à la respecter par amour du devoir et du droit, enfin contraint matériellement à la respecter par la force de tous. Le plus grand intérêt et la plus grande force sont donc ici du côté de la plus grande justice; seulement, il faut pour cela que la démocratie soit véritablement fidèle à son essence, sans mélange d'éléments corrupteurs, et qu'elle soit fondéee réellement sur l'égalité des libertés. Ce qui a perdu les républiques anciennes, ce n'est pas ce qu'elles avaient de réellement démocratique, mais ce qu'elles avaient conservé dans leur sein d'aristocratie, de despotisme et d'injustice; car, on peut le dire, ce n'est jamais par la justice et c'est toujours par l'injustice qu'une nation se perd. Si Montesquieu n'a pas complètement aperçu tous les ressorts et toutes les ressources des sociétés démocratiques, c'est qu'il n'avait encore, en définitive, qu'une idée insuffisante de la vraie liberté. « Dans un État , dit-il, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté consiste à pouvoir faire ce qu'on doit vouloir, et à n'être pas contraint de faire ce qu'on ne doit pas vouloir. »Doit est un mot trop vague : l'État n'a pas à s'occuper de tous les devoirs, mais seulement des devoirs de justice, dont sa tâche est d'assurer l'accomplissement; la vraie liberté civique est donc le pouvoir de faire ce qui n'est pas contraire à la justice, c'est-à-dire à l'égalité des libertés. Montesquieu ajoute que « la liberté est le droit de faire tout ce que permettent les lois-», mais il ne définit là que la liberté légale, qui peut ne pas correspondre à la liberté légitime : car la loi peut être tyrannique et injuste. Un gouvernement où l'on n'obéirait qu'à la loi ne serait pas pour cela un gouvernement libre : car il resterait à savoir par qui la loi est faite et comment elle est faite; une loi bien faite, mais imposée par celui qui n'a pas le droit de la faire, est déjà injuste; une loi faite par ceux qui en ont le droit, mais violant l'égalité des libertés, est encore injuste. Les définitions fondamentales de Montesquieu sont donc incomplètes. La
séparation des pouvoirs.
« Mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. »En conséquence, « pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » De là le principe, propre à Montesquieu, de la séparation des pouvoirs et de leur mutuel équilibre. « Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat (la même assemblée) ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. »Par exemple, si la partie du gouvernement qui a la puissance exécutive veut s'emparer des biens ou d'une portion des biens des citoyens, elle déclarera par la loi que ces biens sont à elle, et, par la force dont elle dispose pour l'exécution, elle s'en emparera. La nation ne doit donc pas confier aux mêmes hommes le soin d'exercer à sa place tout ensemble le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ce serait se remettre à ces hommes pieds et poings liés. « Il n'y a pas encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. »C'est pour cela qu'on a établi l'inamovibilité des magistrats judiciaires, qui les empêche de descendre, sans les empêcher, il est vrai, de monter et de rentrer par là sous l'action du pouvoir exécutif. « Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps [...], exerçaient ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques; et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. » (Esprit des lois, XI, 3, 4, 6).Ce principe de la séparation entre les pouvoirs, auquel Montesquieu attache tant d'importance, revient à dire que les mandats confiés par la nation aux gouvernants doivent être limités à des choses précises, pondérés et contrôlés les uns par les autres, toujours sous la main de la nation, propres à la servir, impuissants à l'asservir. Mais Montesquieu ne s'élève pas encore à cette conception des pouvoirs publics comme mandats librement confiés et librement acceptés par un contrat réciproque; il s'en tient à la théorie du gouvernement « représentatif », où les gouvernants sont moins les mandataires que les représentants de la nation. « Comme, dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative; mais comme cela est impossible dans les grands États, et est sujet à beaucoup d'inconvénients dans les petits, il faut que le peuple fasse par représentants ce qu'il ne peut faire par luimême [...] Tous les citoyens [...] doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant, excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse qu'ils sont réputés n'avoir point de volonté propre. »Rousseau objectera que le représentant est trop souvent considéré comme un homme substitué à la nation, prenant la place de tous en vertu d'un acte de confiance absolue et d'une sorte de blanc-seing; que le vrai rapport des gouvernés et des gouvernants est un contrat, et que le vrai nom des hommes élus pour faire les lois serait celui de mandataires. Montesquieu, n'ayant pas déterminé le principe du droit naturel et par cela même du droit civil et politique, c'est-à-dire la liberté de l'individu, n'a pas compris que les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont inhérents à l'individu même, dont ils expriment les droits les plus essentiels : droit de penser librement et de trouver ainsi en soi-même sa loi; droit de vouloir et d'agir librement et d'exécuter ainsi sa propre loi, enfin droit de se défendre contre les injustices d'autrui. Montesquieu demeure ici bien au-dessous de Locke. De là les erreurs et les confusions que présente sa théorie du gouvernement mixte, dont il a emprunté le type à l'Angleterre. Au point de vue historique, l'analyse faite par Montesquieu est admirable; au point de vue philosophique, elle est très insuffisante. L'erreur principale de Montesquieu est d'avoir ici confondu les différents pouvoirs de l'État, législatif, exécutif et judiciaire, avec les différentes formes de gouvernement, monarchique, aristocratique, démocratique, et d'avoir cru que, pour pondérer les différents pouvoirs, il fallait unir dans un gouvernement mixte les différentes espèces de gouvernement. Montesquieu place tout d'abord le pouvoir législatif dans la nation même, et par là il s'approche de la vérité; mais ensuite, sous prétexte que le pouvoir exécutif doit être séparé du pouvoir législatif, et qu'en outre l'exécution réclame l'unité du commandement, il retire la puissance exécutive à la nation pour la confier à un monarque irresponsable et héréditaire; enfin, pour unir et tempérer ces, deux extrêmes, il intercale entre le monarque et la nation une aristocratie. Telle est, dit-il, la constitution anglaise, qu'il propose « comme un miroir de la liberté ». Sans doute, pourrait-on répondre, l'Angleterre, tendant à la liberté et n'ayant pu passer tout d'un coup du gouvernement de privilège au gouvernement de droit, a trouvé un intermédiaire dans le gouvernement mixte : les éléments historiques qui existaient dans ce pays, - peuple, noblesse et monarque - se sont partagé les divers pouvoirs qui, selon le droit strict, auraient dû appartenir à la nation seule; chacun a pris la part de gouvernement qui convenait le mieux à ses intérêts et à ses capacités d'action, et il en est résulté un progrès dans la liberté, sinon une liberté complète. Mais Montesquieu semble ériger ce fait particulier en règle générale, et croire que tout peuple doit, pour être libre, mélanger la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. N'est-ce pas là ériger une transaction provisoire et un mécanisme transitoire en règle définitive et absolue? Cette théorie de Montesquieu repose sur une confusion de mots et de choses. D'abord, de ce que les mandataires chargés par la nation de faire les lois doivent être séparés des mandataires chargés de l'exécution, il n'en résulte pas que le pouvoir exécutif doive être enlevé à la nation même, et qu'il ne lui soit pas tout aussi inhérent que le pouvoir législatif. Tout au contraire, c'est pour mieux garantir à la nation ses différents pouvoirs et pour en empêcher l'aliénation entre les mains des mandataires publics, qu'on a soin de donner à ces derniers des fonctions restreintes et limitées. On ne divise donc les pouvoirs chez les mandataires que pour mieux en assurer l'unité dans la nation même; car, si la nation confiait à la fois tous ses pouvoirs aux mêmes hommes, elle se trouverait ensuite désarmée devant ces hommes; si, au contraire, elle confie à chaque espèce de mandataires un seul pouvoir, aussi nettement déterminé qu'il est possible, elle conservera mieux elle-même l'intégrité de sa puissance. Montesquieu n'a pas assez compris que l'unité du pouvoir national est l'objet de la division même des pouvoirs politiques. Dès lors, ayant enlevé le pouvoir exécutif à la nation et au droit commun, il a dû en faire un privilège, et donner ce privilège au monarque; or, un gouvernement vraiment libre ne saurait admettre aucun privilège, aucune aliénation des droits de tous. En second lieu, Montesquieu confond l'unité nécessaire à tout pouvoir exécutif avec l'unité propre à la monarchie : quand il s'agit des moyens d'exécuter la loi, il peut être meilleur de confier à un seul homme le soin de décider en dernier ressort, mais il n'en résulte nullement que cet homme doive être un monarque. Dans la constitution américaine, par exemple, le pouvoir exécutif aboutit à un seul homme, le président; ce président n'est pas pour cela un monarque, car il n'a aucun privilège : il est responsable, mais il n'est pas héréditaire; nommé par la nation, il est le simple mandataire de la nation. Donc, en supposant que l'unité soit absolument nécessaire au commandement dans le pouvoir exécutif, cette unité peut exister ailleurs que dans la monarchie, et émaner de la nation même par le choix d'un mandataire unique, responsable, temporaire, qui n'a de commun avec le monarque que le nombre un. De même, quand Montesquieu appelle aristocratie toute considération de mérite, de capacité, d'expérience, quand il dit que « l'élection par le sort est de l'essence de la démocratie, tandis que l'élection par choix est de l'essence de l'aristocratie », il oublie la distinction fondamentale du privilège et du droit commun. Le privilège de naissance, de famille, de fortune, etc., est ce qui constitue proprement l'aristocratie; quand, au contraire, une supériorité quelconque ne s'impose point à autrui par voie de privilège, quand elle se contente de proposer librement ses services et que ces services sont librement acceptés, ce contrat libre de part et d'autre est essentiellement démocratique. Le sénat des États-Unis, librement élu, ne constitue nullement une aristocratie de privilège. Cette erreur de Montesquieu vient de ce qu'il n'a pas assez défini la vraie égalité propre à la démocratie, qui ne consiste pas à niveler tout ni à ne tenir aucun compte des capacités, mais bien à respecter également toutes les libertés et tous les droits, à ne rien imposer par force ou par privilège, à ouvrir l'accès de toutes les fonctions à ceux qui, reconnus dignes de les remplir, sont librement choisis pour les remplir. En résumé, c'est parce que Montesquieu a confondu le mélange des espèces opposées de gouvernement avec la séparation des pouvoirs essentiels à tout gouvernement, qu'il a été amené à prendre pour idéal le mécanisme de la constitution anglaise; mécanisme utile en son temps parce qu'il est sorti naturellement des circonstances, mais qui, artificiellement reproduit dans d'autres contrées, ne serait plus qu'une machine sans vie et sans force durable. Nous voyons du reste, dans l'Angleterre même, les privilèges n'on cessé de diminuer peu à peu au profit du droit commun le privilège aristocratique ne tardera pas sans doute à disparaître tout à fait; le privilège monarchique n'y est plus qu'une sorte de fiction, et un jour viendra peut-être où le droit national sera complètement reconnu. C'est un résultat que Montesquieu lui-même aurait pu déduire à l'avance de ses propres principes : ne nous a-t-il pas montré que le ressort des gouvernements monarchiques est une vertu de convention et de fiction, une vertu toute provisoire l'honneur attaché aux prérogatives ou aux privilèges ; et ne pouvait-il en conclure que l'avenir appartient à ce qu'il nomme la seule vertu politique véritable : la justice, ou respect des droits égaux pour tous? L'esclavage.
« II n'est pas permis de tuer dans la guerre, sauf le cas d'absolue nécessité; mais dès qu'un homme en a fait un autre esclave, un ne peut pas dire qu'il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu'il ne l'a pas fait. »C'est aux philosophes du XVIIIe siècle, et aux peuples libres qui ont suivi leurs principes, que le monde doit l'abolition de l'esclavage. La
torture. Les lois pénales.
« Dans les États modérés, l'amour de la patrie, la honte et la crainte du blâme, sont des motifs réprimants qui peuvent arrêter bien des crimes. La plus grande peine d'une mauvaise action sera d'en être convaincu. Les lois civiles y corrigeront donc plus facilement, et n'auront pas besoin de tant de force. Dans ces États, un bon législateur s'attachera moins à punir les crimes qu'à les prévenir; il s'appliquera plus à donner des moeurs qu'à infliger des supplices [...] Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes, et non pas de la modération des peines [...]. Il reste un vice dans l'État, que cette dureté a produit : les esprits sont corrompus; ils se sont accoutumés au despotisme. Il y a deux genres de corruption, l'un, lorsque le peuple n'observe pas les lois; l'autre, lorsqu'il est corrompu par les lois; mal incurable, puisqu'il est dans le remède même. » (Esprit des lois, XXV, 13).C'est à Montesquieu et à son école (à Beccaria, notamment) que nous devons la sécurité dont nous jouissons aujourd'hui sous nos institutions pénales, et ces lois qui respectent de plus en plus, jusque dans l'individu coupable, le caractère auguste de l'humanité. La
laïcité.
« Tolérer une religion, remarque-t-il, ce n'est pas l'approuver. »Les diverses religions doivent se supporter mutuellement et rester en paix : « car il ne suffit pas qu'un citoyen n'agite pas l'État, il faut encore qu'il ne trouble pas un autre citoyen. »L'économie. Dans les questions économiques, Montesquieu ne manque pas d'originalité. Selon lui, la liberté est liée à l'égalité, et l'égalité est impossible si on ne maintient pas entre de certaines limites la différence de fortunes : des hommes trop pauvres en présence d'hommes trop riches ne seront pas libres et égaux. De là il croit pouvoir conclure la légitimité des lois qui ont pour but d'empêcher soit l'accumulation extrême des capitaux, soit l'extension des industries du luxe aux dépens des industries du nécessaire. Par là il explique et justifie certaines lois somptuaires et certains impôts des républiques anciennes. Dans sa théorie des impôts, Montesquieu définit la contribution politique comme « une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté de l'autre. » « Pour bien fixer les revenus, ajoute-t-il, il faut avoir égard aux nécessités de l'État et aux nécessités des citoyens. Il ne faut pas prendre au peuple sur ses besoins réels pour des besoins de l'État imaginaires. »Quant à l'assiette des impôts, Montesquieu dit qu'il faut distinguer dans les biens de chacun, par des calculs de moyennes, trois portions très distinctes : le nécessaire, l'utile et le superflu. Le nécessaire, ajoute-t-il, ne doit pas être taxé; l'utile doit l'être, et le superflu beaucoup plus que l'utile. La loi de l'impôt, en effet, doit être l'égalité proportionnelle; or, comme Montesquieu l'a compris, la quantité prélevée sur le nécessaire est une charge proportionnellement plus grande pour le pauvre que la quantité prélevée sur le superflu du riche : la proportion purement numérique et brutale n'exprime donc pas une réelle proportionnalité des charges. C'est ainsi que Montesquieu est amené à considérer certaines inégalités de taxe fondées sur la distinction du nécessaire, de l'utile et du superflu, comme des conditions de l'égalité même ou de la proportionnalité dans les charges. Enfin Montesquieu a des vues hardies sur le devoir d'assistance de l'État envers les misérables. Il remarque d'abord que ce qui fait la vraie richesse, c'est le travail, et la vraie pauvreté, l'absence de travail. « Un homme n'est pas pauvre, dit-il, parce qu'il n'a rien, mais parce qu'il ne travaille pas. » (Esprit des lois, livre XXIV, ch. 29).Il y a des vieillards, des malades et infirmes, des orphelins; le remède à ces maux n'est pas une aumône stérile : « Quelques aumônes que l'on fait à un homme nu dans les rues ne remplissent point l'obligation de l'État. »Montesquieu va jusqu'à dire : « L'État doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, et un genre de vie qui ne soit pas contraire à la santé. Un État bien policé tire cette subsistance du fond des arts mêmes : il donne aux uns les travaux dont ils sont capables, il enseigne aux autres à travailler, ce qui fait déjà un travail. »Montesquieu dépasse ici dans l'expression sa propre pensée, qui est que l'État doit un secours lorsque des infortunes naturelles ou passagères, - l'âge, les infirmités, les chômages imprévus, - privent tout d'un coup les travailleurs de la ressource du travail. En somme, Montesquieu a montré une grande pénétration d'esprit dans une foule de questions relatives à la science de la société. Cependant, l'absence de principes philosophiques assez sûrs laisse dans ses oeuvres du décousu, des contradictions et des erreurs. Le défaut de Montesquieu, c'est d'avoir été encore plus jurisconsulte et historien que philosophe. « Quand j'ai eu découvert mes principes, dit-il, tout ce que je cherchais est venu à moi. »Par malheur il n'a pas su découvrir le premier et le plus important des principes : celui qui fonde le droit sur l'absolue inviolabilité de la volonté libre, et qui ramène tous les rapports sociaux à de libres contrats entre les volontés. Voltaire.
« Il faut distinguer, dit-il, dans une hérésie entre l'opinion et la faction [...]. La religion est de Dieu à l'homme. La loi civile est de vous à vos peuples. »En politique, il corrige Montesquieu sur plusieurs points : il montre qu'il n'y a pas de limite exacte entre la monarchie pure et le despotisme, « deux frères qui ont tant de ressemblance qu'on les prend souvent l'un pour l'autre. » - 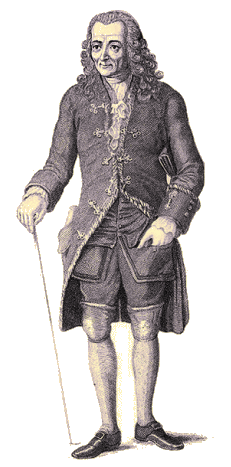
Voltaire. Montesquieu approuvait la vénalité des charges dans la monarchie : « La monarchie, lui répond Voltaire, n'est donc fondée que sur des vices! Il eût mieux valu mille fois, dit un sage jurisconsulte, vendre les trésors de tous les couvents et l'argenture de toutes les églises, que de vendre la justice! »Dans ses Idées républicaines (1765), Voltaire définit le gouvernement comme « la volonté de tous exécutée par un seul ou par plusieurs en vertu des lois que tous ont portées. » « Une société, ajoute-t-il, étant composée de plusieurs maisons et de plusieurs terrains, il est contradictoire qu'un seul homme soit le maître de ces maisons et de ces terrains; il est dans la nature que chaque maître ait sa voix pour le bien de la société [...]. On sait assez que c'est aux citoyens à régler ce qu'ils croient devoir fournir pour les dépenses de l'État. »Rousseau. L'école sensualiste, représentée surtout par Helvétius, avait considéré la justice comme conventionnelle et non naturelle; l'école rationaliste, à laquelle Montesquieu se rattache, avait considéré la justice comme fondée sur la nature même des choses telle que la raison la conçoit; avec Jean-Jacques Rousseau, un mouvement nouveau se manifeste dans la philosophie sociale. Rousseau va chercher le fondement de la justice dans un principe où se réconcilieront le naturel et le conventionnel : la volonté libre, qui est la nature même de l'humain et en même temps l'origine de toutes les conventions ou contrats. Rousseau n'arrive cependant pas du premier coup à cette importante conception. Il commence par se préoccuper, comme ses contemporains, des oppositions qui existent entre l'état de nature et l'état social. Le XVIIIe siècle s'est souvent plu à opposer ces deux états l'un à l'autre; dans son vif sentiment des servitudes et des inégalités qui accablent les humains, il a souvent accusé la société et la civilisation des maux qui pesaient sur l'individu. L'état
de nature.
« Quand on lit votre ouvrage, lui disait spirituellement voltaire, il prend envie de marcher à quatre pattes; cependant, comme il y a soixante ans que j'en ai perdu l'habitude, je sens malheureusement qu'il m'est impossible de la reprendre, et je laisse cette allure naturelle à ceux qui en sont plus dignes que vous et moi. »C'est d'ailleurs une illusion commune à l'humanité entière, et encore fréquente de nos jours, que de remonter ainsi vers le passé pour chercher un état meilleur, et de confondre son idéal à venir avec son antique origine. Un des effets du progrès même, c'est de nous faire mieux voir les maux qui existent et de produire ainsi dans notre esprit l'illusion de la décadence. Pourtant, plus on examine avec attention l'histoire du passé et la nature éternelle de l'humain, plus on voit combien se trompent ceux qui s'imaginent avec Rousseau que le développement de l'état social a enfanté de nouvelles misères. « La vérité, a dit avec raison lord Macaulay, est que ces misères sont anciennes; ce qui est nouveau, c'est l'intelligence qui les découvre et l'humanité qui les soulage. »Le contrat social. Rousseau lui-même n'en est pas resté à ses premières erreurs sur les inconvénients de l'état social. Tout en comprenant que cet état peut être parfois une cause de servitude, il a vu qu'il peut être aussi et doit être un moyen de liberté. De là sa théorie du contrat social, qui mêle à de vieilles erreurs des théories nouvelles et fait entrevoir le principe sur lequel pourrait reposer la société à venir. Déjà, vers 1577, Hubert Languet, sous le pseudonyme de Junius Brutus, dans ses Vindiciae contra tyrannos, soutenait-il que la société repose sur un contrat primitif entre Dieu, le peuple et les souverains, qui violent à chaque instant le pacte commun. Cette idée du contrat, alors très nouvelle, s'est retrouvée dans Hobbes, puis dans Locke : elle va devenir avec Rousseau l'idée fondamentale de l'ordre civil et politique. Pour bien comprendre cette théorie,
il faut distinguer comment la société a été
constituée en fait et comment elle doit être constituée
en droit. En fait, on peut dire que les humains ont été unis
et rapprochés par deux causes principales, la nécessité
et la liberté C'est la nécessité qui domine à
l'origine, sous la forme du besoin et de l'instinct : on l'a mille fois
dit depuis Aristote, l'humain est sociable par
les nécessités mêmes de sa nature. On ne peu donc se
figurer les humains d'abord isolés, puis rassemblés par une
convention formelle. Aussi n'est-ce pas là ce que Rousseau a voulu
soutenir dans son Contrat social Cependant, même au point de vue historique,
tout en reconnaissant la part des fatalités, des contraintes et
violences de toutes sortes dans la formation ou le développement
des sociétés, on ne saurait méconnaître que
la liberté a eu aussi sa part à côté et au-dessus
de la nécessité même. Rousseau considère que
la plus ancienne de toutes les sociétés, et la seule qui
soit fondée uniquement sur la nature, c'est la famille; mais il
ajoute avec raison que l'union même de l'homme et de la femme se
maintient par un commun accord. Les enfants aussi, après un certain
âge, ne restent liés aux parents que par leur volonté.
Si donc les membres de la famille, conclut Rousseau, continuent de rester
unis, ce n'est plus naturellement, c'est volontairement,
C'est aussi par une convention plus ou moins explicite que plusieurs familles se sont réunies en tribus, et les tribus en nations. La violence même et la conquête ne produisent une union durable entre deux peuples qu'en obtenant à la fin un consentement plus ou moins complet et plus ou moins passif. Tout être humain arrivé à l'âge de la majorité accepte de fait et plus ou moins librement le contrat social, en vivant au sein d'une société particulière et selon les lois communes. Enfin, toute constitution politique est un renouvellement du contrat social, surtout dans les pays de suffrage universel. Mais la vraie question qui occupe Rousseau est une question de droit, non de fait. Quand un philosophe examine le droit de propriété, il ne se demande pas comment la propriété a été acquise, si c'est par travail ou par conquête et violence, mais comment elle doit être acquise; de même Rousseau cherche si la société humaine doit être une libre association, et non si elle l'a toujours été. Rien de plus remarquable que la précision avec laquelle Rousseau pose le problème essentiel de la science sociale : « Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. » (Livre I, chap. VI)Et en effet, pourrait-on dire, dans tout ce qui suppose une action commune, l'égalité des libertés ne peut se maintenir qu'en prenant la forme du contrat réciproque; il faut donc que, dans la société, tout se fasse, autant qu'il est possible, par voie de libre contrat; par conséquent il faut que la société elle-même soit un vaste contrat, le plus général de tous, dans lequel tous les autres trouveront leur place, de même qu'à l'intérieur d'un grand cercle, des cercles plus petits peuvent se ranger et se combiner de mille manières. Le contrat social étant défini, selon Rousseau, celui qui constitue les individus en société et dont le contrat politique ne doit être que l'application ou la garantie, il reste à chercher le but et les caractères essentiels d'une telle union entre les volontés. Le but du contrat social ne saurait être la réduction des individus au rôle d'esclaves. Si cette réduction, dit Rousseau, était involontaire et forcée, ce ne serait plus un contrat, mais une conquête violente; si elle était volontaire, ce serait un contrat illégitime et contradictoire, qui se détruirait lui-même en voulant s'établir. Le contrat social ne s'accommode pas plus de la servitude volontaire que de la servitude involontaire. Il ne faut donc pas se le représenter à la manière de Hobbes et de Grotius, comme un acte par lequel les individus aliéneraient leurs droits et leur liberté entre les mains d'un seul ou de plusieurs, pour se faire les rouages d'un mécanisme dirigé par un maître. « Renoncer à sa liberté, dit Rousseau, c'est renoncer à sa qualité d'homme. »Le devoir n'est pas une chose arbitraire dont on puisse se débarrasser comme d'un fardeau, en le mettant sur les bras d'un autre : le devoir est inaliénable. Le droit n'est pas une chose arbitraire et comme une armure extérieure dont on puisse se dépouiller, car nous ne pouvons nous dépouiller de notre personnalité même ni renoncer à être respectés : le droit est inaliénable. La liberté enfin, principe du devoir et du droit, n'est pas une chose arbitraire, mais la condition ou plutôt l'essence même de la moralité : la liberté est inaliénable. « Renoncer à sa liberté, dit Rousseau, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. » (Contrat social, livre I, chap. IV).Outre que le contrat d'aliénation proposé par Hobbes et Grotius est immoral, il est contradictoire par essence. « C'est une convention vaine et contradictoire, dit Rousseau, de stipuler d'une part une autorité absolue, et de l'autre une obéissance sans bornes. N'est-il pas clair qu'on n'est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger? Et cette seule condition, sans équivalent, sans échange, n'entraîne-t-elle pas la nullité de l'acte?»Le contrat, en effet, n'a de valeur que comme échange; si l'un est tout et l'autre rien, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de contrat. Celui qui se priverait de ses droits par contrat se priverait par cela même du droit de contracter, et le contrat, aussitôt fait, serait défait : il se nierait en s'affirmant. Il n'y aurait donc vraiment plus de contrat, et l'obligation d'en respecter les clauses disparaîtrait. Rousseau montre ensuite que le contrat d'aliénation est injuste envers les autres humains, dont on prétend confisquer le droit même de contracter. L'association humaine reçoit perpétuellement dans son sein de nouveaux associés : ce sont tous les enfants qui naissent; on n'a pas le droit de leur imposer d'avance une servitude, par aucun contrat formel ou tacite, et dans quelque mesure que ce soit. « Quand chacun pourrait s'aliéner lui-même, dit Rousseau, il ne peut aliéner ses enfants; ils naissent hommes et libres; leur liberté leur appartient; nul n'a le droit d'en disposer qu'eux. Avant qu'ils soient en âge de raison, le père peut, en leur nom, stipuler des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être, mais non les donner irrévocablement et sans condition, car un tel don est contraire aux fins de la nature et passe les droits de la paternité. » (Contrat social, ibid.)Telles sont les raisons d'où Rousseau conclut que le contrat d'association ne saurait être l'aliénation de la liberté de tous au profit d'un seul ou de plusieurs : on ne peut user de ses droits pour s'enlever ses droits et pour confisquer les droits d'autrui; on ne peut tourner son droit contre le droit d'autrui en même temps que contre son droit propre; on ne peut invoquer sa liberté pour se mettre en servitude ou pour y mettre d'avance les générations à venir. La question qui se pose maintenant est de savoir si le contrat social ne serait pas l'aliénation de la liberté de chacun au profit de tous. Au lieu de mettre en présence divers individus, mettons en présence les individus et la société; pourrons-nous considérer le contrat social comme une aliénation des individus à la société entière? On reconnaît là le système appelé communisme au sens propre du mot, c'est-à-dire l'absorption de l'individu dans la communauté. C'est le système auquel Rousseau semble tout d'abord aboutir; mais à vrai dire, dans son Contrat social, il ne va faire que le traverser pour aller plus loin, par une méthode d'argumentation qui est d'ailleurs très défectueuse. La clause suprême du contrat social, dit Rousseau, est la suivante : « Aliénation totale de chaque associé, avec tous ses droits, à toute la communauté. »Rousseau est dupe ici, comme le fut Platon dans l'Antiquité, d'une sorte de panthéisme social qui consiste à voir dans la société un grand tout vivant dont les individus sont les organes. On peut accorder que, sous plusieurs rapports, la société est un vaste organisme où chaque individu sert à tous les autres, et que les diverses fonctions sont réparties entre les différents membres de la société comme entre les divers membres du corps humain; c'est la conception dont s'inspiraient les démocraties antiques, surtout Sparte et Rome. Rousseau et le XVIIIe siècle tout entier hésitent trop souvent entre cette idée antique du corps social et l'idée moderne du contrat social. Rousseau va jusqu'à déterminer les organes particuliers du corps politique : « Le pouvoir souverain, dit-il, représente la tête; les lois et les coutumes sont le cerveau; les juges et les magistrats sont les organes de la volonté et des sens; le commerce, l'industrie et l'agriculture sont la bouche et l'estomac, qui préparent la substance commune; les finances publiques sont le sang, qu'une sage économie, en faisant les fonctions du coeur, distribue par tout l'organisme; les citoyens sont le corps et les membres, qui font mouvoir, vivre et travailler la machine. On ne saurait blesser aucune partie sans qu'aussitôt une sensation douloureuse ne s'en porte an cerveau, si l'animal est dans un état de santé. » (Encyclopédie, article Economie politique).Cet organisme écrit par Rousseau représente bien la société au point de vue des intérêts économiques, et pour ainsi dire au point de vue de l'animalité; mais ce n'est pas là encore la vraie société humaine, dont le Contrat social nous avait promis de montrer la constitution; Rousseau ne nous a pas fait sortir du domaine de la fatalité physique, et l'individu n'a pas plus de liberté dans ce grand corps où il l'absorbe que la goutte de sang emportée dans les veines par le mouvement de la circulation. Pour concilier, au moins en apparence, cette aliénation de l'individu au profit de la communauté avec le principe de la liberté inaliénable, Rousseau invente un expédient qui ressemble fort à un sophisme : « Chacun, dit-il, se donnant à tous, ne se donne à personne; et comme il n'y a pas un associé sur lequel on n'acquière le même droit que sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce que l'on perd et plus de force pour conserver ce que l'on a. » (Contrat social, II, VI).Ce raisonnement emprunte à l'abstraction des termes son apparence trompeuse : l'individu, en s'absorbant tout entier dans le corps social, ne trouverait pasn réel équivalent de ce qu'il aurait perdu, et l'égale aliénation de toutes les libertés ne lui rendrait pas la sienne. Rousseau d'ailleurs ne tarde pas à se corriger lui-même en disant plus loin : « Ce que chacun aliène [ par le pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté ], c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté. »L'aliénation n'est donc plus ici présentée par Rousseau comme totale, mais seulement comme partielle. Enfin Rousseau va plus loin encore et finit par nier toute aliénation, partielle ou totale : « Il est si faux, dit-il, que, dans le contrat social, il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l'effet de ce contrat, se trouve réellement préférable à ce qu'elle était auparavant. » (Ibid.).La vérité est donc, selon la dernière pensée de Rousseau lui-même, que le pacte social n'a en aucune façon pour but l'aliénation de la liberté, mais au contraire l'augmentation de la liberté. La vieille erreur des sociétés antiques obsédait l'esprit de Rousseau au moment même où il décrivait la société future : il finit pourtant par s'en dégager. Le contrat social, ajoute Rousseau, n'est pas moins favorable au fond à l'égalité qu'à la liberté. « Au lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes; et, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. »La volonté générale. Une fois l'association des individus constituée par le contrat social, sous le nom d'État, où résidera la souveraineté? Avant le contrat, la souveraineté était inhérente à l'individu et se confondait avec sa liberté même; après le contrat, la souveraineté réside dans la volonté de tous, dans la volonté universelle ou, comme dit Rousseau, générale, au sens le plus absolu de ce mot. En d'autres termes, une nation ou association libre d'individus n'appartient qu'à elle-même; elle est souveraine sur elle-même et doit se régler par des lois qui soient son oeuvre. Cette volonté absolument générale n'est pas seulement celle du plus grand nombre; car « la loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de convention et suppose au moins une fois l'unanimité. »La volonté générale est celle de tous, et, à vrai dire, elle embrasse même les générations à venir; car, si la volonté de ceux qui vivent aujourd'hui prétendait enchaîner d'avance la volonté de ceux qui naîtront demain, ce ne serait plus qu'une volonté particulière et passagère s'efforçant de se substituer par usurpation à la volonté universelle et durable. La volonté universelle ainsi entendue doit toujours demeurer libre ou souveraine d'elle; c'est ce que Rousseau exprime en disant que la souveraineté de la nation est inaliénable. Un peuple peut bien dire : « Je veux actuellement ce que veut un tel homme, ou du moins ce qu'il dit vouloir; mais il ne peut pas dire : - Ce que cet homme voudra demain, je le voudrai encore, puisqu'il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir [...] Si donc le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple à l'instant qu'il y a un maître, il n'y a plus de souverain, et dès lors le corps politique est détruit. » (Contrat social, livre II, ch. I).Rousseau ajoute que « la souveraineté est indivisible en même et dans son principe »; c'est-à-dire qu'elle demeure toujours tout entière dans toute la nation, alors même qu'elle se manieste et s'exécute par des pouvoirs séparés l'un de l'autre, comme le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le gouvernement peut se partager entre plusieurs personnes ou plusieurs corps qui sont les mandataires de la souveraineté générale; mais celle-ci n'est pas pour cela divisée : la nation demeure toujours dépositaire de la souveraineté législative, exécutive et judiciaire, alors même qu'elle partage ces fonctions entre plusieurs; bien plus, cette division, excellente dans la pratique, a précisément pour but d'empêcher que tous les pouvoirs soient dans les mains des mêmes hommes; conséquemment la division des pouvoirs a pour fin l'unité indivisible de la souveraineté dans le corps entier de la nation. La volonté générale ou universelle, avec l'étendue illimitée que Rousseau lui donne, peut être considérée comme la volonté du bien de tous par tous, présents et à venir. Élevée à une telle gé néralité, la volonté universelle semble se confondre avec la raison universelle, et Rousseau va jusqu'à dire : « La volonté générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique. »Il ne s'agit d'ailleurs ici que des intentions et des tendances de la volonté universelle; aussi Rousseau ajoute-t-il immédiatement : « Il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude; on veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours [...] Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale : celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé et n'est qu'une somme de volontés particulières. » (Contrat social, II, III).Par malheur, ces distinctions exprimées en langage ambigu sont difficiles à saisir; Rousseau finit par s'y perdre lui-même et semble enseigner une sorte d'infaillibilité de la nation. Tout ce qu'on peut raisonnablement lui accorder sur ce point, c'est ce que Kant lui accordera en effet : la volonté des individus ou des peuples est droite quand elle est absolument universelle et qu'elle porte sur un objet universel; car alors elle se confond avec le devoir et avec le droit, qui offrent seuls ce caractère d'absolue universalité. Si au contraire Rousseau voulait dire qu'un peuple ne peut jamais être injuste envers lui-même on envers tels et tels de ses membres, il soutiendrait un principe faux. La volonté vraiment générale et universelle, mise en regard des volontés particulières, devient loi. Dans la pratique, on appelle loi l'expression de la volonté présumée générale, et, pour obtenir la présomption la plus forte, on consulte tous les citoyens. « La loi réunissant l'universalité de la volonté et celle de l'objet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse être, ordonne de son chef n'est point une loi; ce qu'ordonne même le souverain [c'est-à-dire la nation] sur un objet particulier n'est pas non plus une loi, mais un décret; ni un acte de souveraineté, mais de magistrature [...]. Les lois ne sont proprement que les conditions de l'association civile. Le peuple soumis aux lois en doit être l'auteur : il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société [...]. Pour qu'une volonté soit générale, il n'est pas toujours nécessaire qu'elle soit unanime [sur tel ou tel objet déterminé]; mais il est nécessaire que toutes les voix soient comptées; toute exclusion formelle rompt la généralité [...]. Il importe, pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, que chaque citoyen n'opine que d'après lui. » (Contrat social, II, VI).Il ne faut du reste pas confondre la volonté générale avec son énoncé; l'une est l'idéal de la loi, qui se confond avec le bien même de tous; l'autre est la loi réelle, qui n'est pas toujours bonne. « Ce qui est bien et conforme à l'ordre, dit Rousseau, est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais, si nous savions la recevoir de si haut, nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni de lois. Sans doute, il est une justice universelle émanée de la raison seule; mais cette justice, pour être admise entre nous, doit être réciproque [...]. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice à son objet [...]. Quand on aura dit [comme Montesquieu] ce que c'est qu'une loi de la nature, on n'en saura pas mieux ce que c'est qu'une loi de l'État. » (Ibid, II, IV).Il est donc entendu que la loi de l'État est la volonté générale s'efforçant d'exprimer, par le consentement de tous, ce qui est conforme à la raison. La loi de l'État peut être une interprétation erronée de la justice; voilà pourquoi toute loi peut être changée, et le peuple doit se réserver le pouvoir de modifier ou d'abroger toutes ses lois. « Il est contre la nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre [...]. Il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple. Un peuple est toujours le maître de changea ses lois. » (Ibid.). L'objet que toute loi se propose ou doit se proposer est le plus grand bien de tous, qui consiste dans la liberté et dans l'égalité. « Si l'on cherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à ces deux objets principaux, la liberté et l'égalité. La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l'État; l'égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. Il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes; mais que, quant à la puissance, elle doit toujours être au-dessus de toute violence et ne s'exercer jamais qu'en vertu du rang et des lois, et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre [...].Voulez-vous donc donner à l'État de la consistance? Rapprochez les degrés extrêmes autant qu'il est possible; ne souffrez ni des gens opulents ni des gueux. Ces deux états, naturellement inséparables, sont également funestes au bien commun : de l'un sortent les fauteurs de la tyrannie et de l'autre les tyrans; c'est toujours entre eux que se fait le trafic de la liberté publique; l'un l'achète, l'autre la vend [...]. C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. » (Contrat social, II, XI).Le gouvernement. Avant Rousseau, on confondait la souveraineté de l'État et le gouvernement; Rousseau fait voir que l'État est seul souverain et que le gouvernement est simplement un ensemble d'hommes auxquels tous confient le soin de faire exécuter la volonté générale. « Qu'est-ce donc que le gouvernement? Un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain (c'est-à-dire la nation), pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civile que politique. Les gouvernants ou magistrats ne sont que les commissaires de la nation. »Le gouvernement ne devant être que l'ensemble d'humain et de moyens les plus capables de faire respecter la volonté générale, la première règle du gouvernement est d'exclure tout ce qui serait une abdication, une aliénation totale ou partielle. Une forme de gouvernement qui n'assure pas à toutes les volontés, présentes ou futures, la souveraineté sur elles-mêmes, est illégitime par essence et repose sur une violation du droit commun à tous. De là Rousseau conclut que « tout gouvernement légitime est républicain. » Les formes diverses que peut prendre le gouvernement ne doivent donc pas consister, selon Rousseau, dans diverses manières d'attribuer le pouvoir législatif; car il n'y a qu'une seule attribution légitime du pouvoir législatif, l'attribution à tous. Si on donnait le pouvoir législatif à un seul ou à plusieurs, ce serait la destruction du contrat social. Les formes diverses de gouvernement doivent regarder seulement l'organisation de la puissance, exécutive. Faut-il faire « exécuter » la volonté de tous par tous, ou par quelques-uns, ou par un seul? Voilà l'unique question; mais un seul, plusieurs ou tous devront toujours être de simples magistrats de la nation, révocables et responsables. Pour exprimer le nombre des gouvernants dans le pouvoir exécutif, Rousseau se sert à tort des mots ambigus de démocratie, d'aristocratie, de monarchie, qu'il détourne de leur vrai sens; d'après cette terminologie inexacte, la république américaine, confiant le pouvoir exécutif à un seul homme, serait une monarchie. Mais laissons les termes pour considérer les choses, et demandons-nous de nouveau si, d'après Rousseau, il convient de confier à tous ou à plusieurs ou à un seul l'exécution des volontés de tous. Confier à tous l'exercice direct du pouvoir exécutif, et faire du peuple entier assemblé l'exécuteur des décisions générales, c'est chose qui n'est possible, dit Rousseau, que dans de petites cités, et qui offre d'ailleurs une foule d'inconvénients. Il est plus dangereux encore, ajoute-t-il, de concentrer la force exécutive entre les mains de quelques-uns ou d'un seul. Mieux vaut diviser les fonctions et aboutir à un système mixte. Rousseau rencontre ici le mécanisme établi par les Anglais sous le nom de gouvernement représentatif. Il reconnaît avec Montesquieu qu'il faut partager les pouvoirs gouvernementaux (non pas la souveraineté nationale elle-même); mais il rejette le principe de la représentation proprement dite, comme contraire à la véritable liberté. Un représentant, à proprement parler, serait un homme ou un ensemble d'hommes que la nation se substituerait à elle-même pour la représenter, et auxquels elle donnerait tous ses pouvoirs. Mais, objecte Rousseau, avec un pareil système la nation n'est libre que le jour de l'élection, puis elle se trouve à la merci de ses représentants; c'est donc une aliénation au moins temporaire de la liberté nationale, c'est un reste de servitude. La nation, ajoute-t-il, peut bien avoir des commissaires, des mandataires, des fonctionnaires, ayant un mandat défini et révocable avec une responsabilité effective; elle ne peut pas avoir des représentants qui substitueraient leur conscience à la sienne, qui feraient tout à sa place, sous leur seule responsabilité. « La souveraineté ne peut être représentée [au sens exact du mot] par la même raison qu'elle ne peut être aliénée; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point; elle est la même ou elle est autre, il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires [...]. La loi n'étant que la déclaration de la volonté générale, il est clair que, dans la puissance législative, le peuple ne peut être représenté; mais il peut et doit l'être dans la puissance exécutive, qui n'est que la force appliquée à la loi [...]. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort; il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. » (Contrat social, II, XV).
L'idéal de Rousseau est donc que la loi soit faite par tous aussi directement qu'il est possible, et que l'exécution de la loi soit seule confiée à des représentants ou, pour mieux dire, à des commissaires. Alors se présente une grave objection. Comment les citoyens, dans un grand État, pourront-ils exercer le pouvoir législatif directement, ou du moins par des mandataires placés sous leur immédiate action? C'est là, répond Rousseau, chose impossible. Aussi la vraie liberté réclame-t-elle, selon lui, de petits États, de petites associations où tout se fasse directement par les intéressés ; là seulement régnera la liberté intérieure. - Mais ces petits États seront livrés sans défense à l'ambition des grands. - Non, répond Rousseau, les petits États, en s'associant, formeront des confédérations capables de résister aux agressions extérieures. La solution de la difficulté réside, selon lui, dans l'idée de confédération, idée qu'il n'a d'ailleurs pas eu le temps de développer. Sa conclusion, - qu'on n'a pas toujours bien comprise, - est que la vraie république est la république confédérative, dont il trouvait en Suisse un exemple. Ajoutons qu'une confédération peut dépasser beaucoup la Suisse en étendue, et que, si la Suisse est une confédération relativement faible, rien n'empêche l'existence de vastes et fortes confédérations. Rapports
de l'Eglise et de l'Etat.
« Chacun peut avoir telles opinions qu'il lui plaît, sans qu'il appartienne au souverain d'en connaître; car, comme il n'a point de compétence dans l'autre monde, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce n'est pas son affaire, pourvu qu'ils soient bons citoyens en celle-ci. » (Ibid. III, VIII).Rousseau croit cependant, par une regrettable inconséquence, devoir maintenir dans l'État une sorte de religion naturelle et civique : « Il y a, dit-il, une profession de foi purement civile, dont il appartient au souverain (c'est-à-dire à la nation) de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen ou sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l'État quiconque ne les croit pas; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable [...]. Que si quelqu'un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort; il a commis le plus grand des crimes : il a menti devant les lois. »Ce sont là de fâcheux écarts de pensée et de langage; il est juste pourtant de remarquer qu'on prête d'ordinaire à Rousseau plus qu'il ne dit : il ne veut punir de mort que ceux qui commettent des crimes contraires à une prétendue morale naturelle et à une religion naturelle dont ils auraient préalablement accepté les principes. Il ne punit pas ceux qui ne croient pas, mais ceux qui se conduisent contrairement à la morale et à la religion civique qu'ils avaient promis d'exercer. Ce qui manque encore à Rousseau, dans cette question comme dans beaucoup d'autres, c'est une claire distinction de ce qui est vraiment un droit et de ce qui n'est qu'un intérêt. Il place parmi les dogmes de la religion civile « l'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants »; mais ce sont là des croyances qu'on peut ne pas avoir sans être pour cela coupable d'injustice envers ses semblables : l'État n'a donc vraiment rien à voir dans ces problèmes. Rousseau
et la Révolution française.
« Qu'on nous dise qu'il est bon qu'un seul périsse pour tous, j'admirerai cette sentence dans la bouche d'un digne et vertueux patriote qui se consacre volontairement à la mort pour le salut de son pays; mais, si l'on entend qu'il soit permis au gouvernement de sacrifier un innocent au salut de la multitude, je tiens cette maxime pour une des plus exécrables que la tyrannie ait inventées [...]. Loin qu'un seul doive périr pour tous, tous ont engagé leur vie et leurs biens à la défense de chacun d'eux, afin que la faiblesse particulière fût toujours protégée par la force publique, et chaque membre par tout l'Etat. Après avoir, par supposition, retranché du peuple un individu après l'autre, pressez les partisans de cette maxime à mieux expliquer ce qu'ils entendent par le corps de l'Etat, et vous verrez qu'ils le réduiront à la fin à un petit nombre d'hommes, qui ne sont pas le peuple, mais les officiers du peuple. » (Article Economie politique dans l'Encyclopédie).En résumé, dans sa philosophie sociale, Rousseau a posé des principes excellents, dont il n'a pas toujours su tirer les vraies conséquences : il aurait dû aboutir à la liberté individuelle, et il aboutit trop souvent à l'exagération des droits de l'Etat. Il n'en a pas moins démontré, avec une rigueur philosophique, que, la société tout entière repose, non sur les intérêts matériels ou sur la raison abstraite, comme l'avaient soutenu Helvétius et Montesquieu, mais sur la volonté réelle, qui seule fait de l'homme un être moral. « Rousseau, dit Hegel dans son histoire de la philosophie, a proclamé la liberté l'essence de l'homme; ce principe est la transition à la philosophie de Kant, dont il fera le fondement. »
« Ce n'est qu'après des siècles et par des réactions sanglantes que le despotisme a enfin appris à se modérer lui-même, et la liberté à se régler; et c'est ainsi que, par des alternatives d'agitation et de calme, de biens et de maux, la masse totale du genre humain a marché sans cesse vers la perfection. »Condorcet. Condorcet, poursuivi par la tyrannie jacobine, écrit avant de mourir son Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain « Si l'homme peut prédire avec une assurance presque entière les phénomènes dont il connaît les lois; si, lors même qu'elles lui sont inconnues, il peut, d'après l'expérience du passé, prévoir avec une grande probabilité les événements de l'avenir, pourquoi regarderait-on comme une entreprise chimérique de tracer avec quelque vraisemblance le tableau des destinées futures de l'espèce humaine d'après les résultats de son histoire?-»Ces progrès seront, d'après Condorcet, 1° la destruction de l'inégalité entre les nations, et de leurs luttes ; 2° les progrès de l'égalité dans un même peuple sous le rapport des richesses et de l'instruction; égalité que produira la liberté même, par l'abolition des lois factices, des prohibitions, des formalités, des monopoles, par les caisses d'épargne, par les assurances sur la vie, par les institutions de crédit et les associations. Condorcet voudrait qu'on instruisit « la masse entière du peuple de tout ce que chaque homme a besoin de savoir pour l'économie domestique, pour l'administration de ses affaires, pour le libre développement de son industrie et de ses facultés, pour connaître ses droits, les défendre et les exercer; pour être instruit de ses devoirs, pour les bien remplir, pour juger ses actions et celles des autres d'après ses propres lumières, et n'être étranger à aucun des sentiments élevés ou délicats qui honorent la nature humaine. »Ces progrès auront pour résultat, dit Condorcet, le perfectionnement réel de notre espèce : 1° progrès des méthodes, qui permettra d'apprendre en moins de temps un plus grand nombre de connaissances et de les répandre dans un plus grand nombre d'esprits; 2° perfectionnement des sciences de la nature et des inventions; 3° perfectionnement des sciences morales et philosophiques par l'analyse des facultés intellectuelles et morales de l'humain; 4° perfectionnement de la science sociale par l'application du calcul des probabilités à cette science; 5° par suite, perfectionnement des institutions et des lois ; 6° abolition de l'inégalité des sexes et égalité des droits entre l'homme et la femme; 7° diminution, puis abolition des guerres de conquête ; 8° établissement d'une langue scientifique universelle; 9° augmentation progressive de la durée moyenne de la vie, par le progrès de la médecine et de l'hygiène, de telle sorte que la mort, quoique inévitable et jusqu'à un certain point désirable pour l'individu, résulte seulement, soit d'accidents extraordinaires, soit de la lente extinction des forces vitales. (A. Fouillée). |
| . |
|
|
|
||||||||
|