| . |
|
||||||
|
|
| . |
|
||||||
| Les Crustacés |
|
|
|
|
| Les Crustacés
forment un sous-embranchement de l'embranchement des arthropodes,
comprenant notamment les Ă©crevisses, les langoustes, les crabes, les anatifes,
les cloportes et toutes les autres formes Ă respiration
branchiale, à téguments solides composant une
carapace
chitineuse. Ce sont tous des animaux au genre de vie extrĂŞmement variable,
organisés pour vivre dans l'eau, et l'immense majorité de ces êtres
habitent la mer; un très petit nombre de formes seulement se sont adaptées
à la vie terrestre. La plupart des Crustacés sont libres pendant toute
leur existence, mais on observe aussi, parmi eux, des exemples de parasitisme
à tous ses degrés; même, certains Crustacés parasites peuvent en arriver
à un tel degré de régression, qu'ils sont absolument méconnaissables
et qu'il ne faut rien moins que l'étude de leur embryogénie pour pouvoir
les classer Ă l'Ă©tat adulte.
-- 
Un crabe Sally Pied-Léger (Grapsus Grapsus) des îles Galapagos. Les Crustacés ont des paires de membres plus ou moins nombreuses, mais rarement réduites à un minimum de cinq, sans compter celles qui sont modifiées pour composer l'appareil masticateur. Ils ont plusieurs paires d'antennes et leurs appendices se modifient souvent en nageoires, ainsi que le dernier segment de l'abdomen. Essentiellement ovipares, ces arthropodes ont des sexes séparés et, au sortir de l'oeuf, ils passent par des états larvaires et subissent des métamorphoses nombreuses. Leur existence est à peu près généralement aquatique, et les formes terrestres, comme les cloportes et les gécarcins, possèdent toujours des branchies. Ils atteignent souvent des dimensions considérables : certains homards mesurent jusqu'à 1 mètre de long; et de nombreuses formes presque microscopiques vivent par quantités énormes dans les eaux douces et dans la mer, où elles contribuent à former cette sorte de gelée, dite plancton, dont se nourrissent une foule d'espèces, et même de grands cétacés. Les crustacés représentent une sérieuse ressource alimentaire; la plupart des espèces sont comestibles, la chair des décapodes est particulièrement appréciée. On peut dire que, dans aucun groupe on ne voit éclater de telles différences entre les types les plus parfaits, comme les décapodes, et les types dégradés comme les lernées et les sacculines, à ce point que ces dernières, véritables sacs amorphes, ont été prises pour la progéniture des Crabes. Et, tandis que la plupart des Crustacés nagent librement ou courent sur les rivages les anatifes sont fixés à demeure sur les corps étrangers ou sur divers animaux marins. Le régime carnivore est partout la règle; les espèces puissamment armées, comme les homards et les tourteaux, capturent les poissons et les mollusques, notamment les formes nues; mais elles ont pour ennemis terribles les grands mollusques céphalopodes, qui en détruisent des quantités énormes. Les innombrables formes de ce groupe sont
réparties dans toutes les régions du globe; et au contraire de
ce qu'on observe généralement, les plus grandes habitent les régions
froides ou tempérées. A périodes géologiques les plus anciennes, ces
animaux étaient déjà représentés. On a trouvé dans le terrain dévonien
des Crustacés d'organisation très élevée, des Décapodes, ce qui permet
d'admettre qu'à cet âge ils existaient depuis déjà fort longtemps.
Nombre de types fossiles sont aujourd'hui Ă©teints.
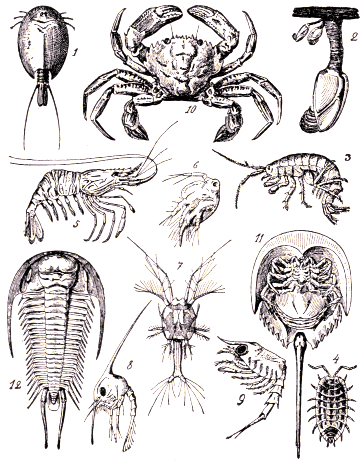
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Classification
des Crustacés
La classification des Crustacés présente
d'assez grandes difficultés, à cause de beaucoup de types aberrants,
vivants ou fossiles, qui ne rentrent facilement dans aucun groupe. On reconnaît
deux grandes divisions fondamentales, ou classes : Entomostracés et Malacostracés
:
Caractères gĂ©nĂ©raux On peut dĂ©finir les CrustacĂ©s comme des Arthropodes Ă respiration branchiale, munis de deux paires d'antennes, chez lesquels chaque anneau porte, au cĂ´tĂ© ventral, une paire d'appendices articulĂ©s; les tĂ©guments, formĂ©s de chitine, sont imprĂ©gnĂ©s de matière calcaire, qui leur donne une grande duretĂ©, et c'est cette dernière particularitĂ© qui leur a valu leur nom. Comme chaque fois qu'il s'agit de dĂ©finir un groupe nombreux d'animaux, il faut noter ici que chacun de ces caractères, en particulier, peut se trouver infirmĂ©. - 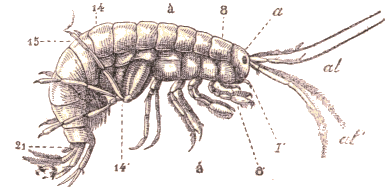
En général, on peut compter chez les
Crustacés vingt anneaux, portant chacun des appendices; mais, d'une part,
on peut assez souvent constater une réduction plus ou moins prononcée
de ce nombre d'anneaux et, d'autre part, on les voit parfois se multiplier
et atteindre un chiffre double : nous citerons des exemples de ces modifications
à propos des Cladocères,
Ostracodes (réduction),
Branchiopodes (augmentation du nombre). Tous les anneaux restent parfois
distincts, malgré leur nombre et, d'autres fois, ils se soudent ou se
fusionnent, de façon à n'être plus marqués que par leurs appendices
(fig. 1 et 2). Il y a, au reste, tous les passages entre ces types variés.
Chez la plupart des Crustacés, les anneaux qui forment la tête se soudent
entre eux avec le thorax, pour donner naissance
à ce que l'on appelle le céphalothorax,
mais il est des espèces, même parmi celles qui sont très élevées en
organisation, chez lesquelles les anneaux céphaliques restent presque
tous distincts; on peut compter sept anneaux céphaliques, dont l'un porte
les yeux, les deux suivants les antennes et les autres les pièces buccales.
Les yeux sont d'ordinaire composés : ils peuvent
avoir la cornée lisse ou présenter des facettes; parfois, on voit des
cristallins très distincts les uns des autres, à la périphérie de l'organe;
les deux yeux peuvent se fusionner et donner l'apparence d'un organe impair,
comme chez beaucoup d'Entomostracés; on rencontre parfois aussi des yeux
simples, comme chez les Cyames, Apus, etc., qui possèdent d'ailleurs,
en même temps, des yeux composés. Fait remarquable, chez certaines espèces
des grandes profondeurs, les yeux peuvent être remplacés par des épines
plus ou moins développées. Enfin, un certain nombre d'espèces, parmi
les Crustacés qui vivent dans les lieux obscurs, sont dépourvues de tout
appareil oculaire.
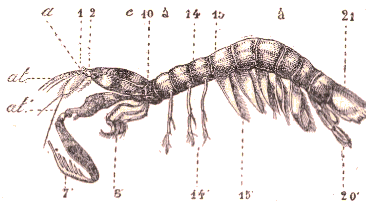
Les antennes
des Crustacés, au nombre de deux paires, sont extraordinairement variables
par tous leurs caractères; ce sont d'ordinaire des sortes de fouets grêles
et articulés, sièges du toucher; leurs fonctions, au reste, peuvent varier
comme leur forme, et ces organes peuvent s'adapter Ă la nage,
devenir des instruments de préhension, ou se transformer en appareils
de fixation. L'appareil buccal est en règle générale formé de nombreuses
pièces, mais il n'y a absolument rien de fixe à cet égard et les éléments
qui le forment peuvent être plus ou moins réduits. Chez les formes élevées
(fig. 3), on peut trouver, en outre de la lèvre supérieure, une paire
de mandibules, pourvues d'un palpe
articulé et deux paires de mâchoires de structure compliquée. Ces trois
paires d'organes appartiennent aux quatrième, cinquième et sixième segments
céphaliques et correspondent aux mandibules, mâchoires
et lèvre inférieure des Insectes. Il s'ajoute fréquemment à cet appareil,
chez les formes les plus différenciées, deux, trois et même cinq paires
de pattes, appartenant aux anneaux suivants et qui se transforment en appendices
buccaux, mais dont la nature primitive est pleinement démontrée.
Le thorax est
typiquement formé de sept anneaux, plus ou moins nettement visibles, plus
ou moins soudés entre eux et avec la région céphalique; les sept paires
d'appendices qu'il porte présentent, suivant les genres, les modifications
les plus variées : ils peuvent constituer des organes de marche, de natation,
de préhension, de respiration, de tact,
de fixation, etc., tous différents les uns des autres; leurs changements
de forme sont si Ă©tendus qu'il ne peut ĂŞtre question de les Ă©tudier
ici et que nous n'en parlerons qu'à propos des différents types chez
lesquels il est plus intéressant de les examiner. L'abdomen
est formé de six anneaux ; beaucoup d'auteurs admettent cependant l'existence
d'un septième anneau terminal, rudimentaire, important en taxonomie pour
les caractères qu'il présente et qui reçoit le nom de telson;
l'abdomen est aussi très variable par ses caractères, même si on ne
le considère que chez les formes élevées tout le monde sait, par exemple,
que la partie du corps repliée et que l'on appelle vulgairement la queue
chez les Crabes, n'est autre chose que l'abdomen, si développé au contraire
chez des formes voisines, comme les Homards et Langoustes. Aussi n'y a-t-il
pas lieu de s'Ă©tonner si, chez certaines formes (Aselles, par exemple)
il est réduit à une seule pièce, encore très large à la vérité,
et si, chez d'autres (Caprelles, Cyames), il est réduit à un ou deux
petits tubercules : c'est le thorax qui prend la prédominance dans ces
derniers cas. Les anneaux abdominaux portent aussi chacun une paire d'appendices,
mais on peut appliquer Ă ces organes ce que nous avons dit des pattes
thoraciques : ils peuvent présenter les variations les plus étendues.
Il faut ajouter, Ă la suite de cette longue
revue des modifications que peuvent présenter les anneaux du corps des
Crustacés, qu'il existe des formes (ex. les Lernées), chez lesquelles
toute trace de division du corps disparaît : l'animal est alors vermiforme.
Le système nerveux des Crustacés a la disposition générale qu'il présente
chez les autres
Arthropodes normaux; il est
situé, pour sa plus grande masse, au côté ventral du corps; une paire
de ganglions existe pour chaque anneau et des filets
nerveux les réunissent, formant deux chaînes parallèles, plus ou
moins nettement soudées entre elles et qui courent dans toute la longueur
du corps, se rendant vers l'oesophage; en ce
point les deux chaînes nerveuses se relèvent et, embrassant l'oesophage,
viennent se perdre à la partie supérieure dans les ganglions
céphaliques (fig. 4). D'une manière générale, on peut dire que le système
nerveux que nous venons de décrire, suit toutes les modifications
que peuvent présenter les anneaux et que ses différentes parties peuvent
entrer en plus ou moins complète coalescence.
C'est chez les Crabes que le maximum de coalescence est nécessairement
réalisé (fig. 5).
Des ganglions céphaliques, soudés en une seule masse, se détachent tous les nerfs des organes des sens. Il existe aussi, chez les Crustacés élevés en organisation du moins, un système nerveux dit de la vie végétative. Nous avons dit plus haut quelques mots des organes du tact et de la vision; nous aurons peu de chose à dire ici sur les autres organes des sens. L'appareil de l'ouïe est localisé, chez les espèces supérieures, dans le premier article des antennes antérieures; il varie de structure, mais est toujours excessivement simple : il peut avoir, chez d'autres formes, un siège tout différent et être situé, par exemple, dans les lamelles caudales; il est inconnu chez un très grand nombre de types. La faculté de percevoir les odeurs existe aussi chez les Crustacés, parfois même elle est très développée; les organes de ce sens semblent être situés sur les antennes antérieures et revêtir l'aspect d'appendices de forme plus ou moins conoïdes, plus ou moins semblables à des poils, mais toujours en saillie. L'appareil
digestif des Crustacés libres est complet; il peut être très réduit
chez les formes parasites. Chez les types supérieurs
(fig. 6), il commence par un oesophage court
et large, muni de valvules et d'un appareil musculaire
puissant. L'estomac, de forme arrondie, présente
à son intérieur un système de plaques très dures, de nature chitineuse,
d'agencement compliqué, qui jouent un rôle important dans la trituration
des aliments et sont très variables suivant les cas; des glandes
variées déversent leur produit dans le tube digestif : leurs homologies
ne sont pas toujours faciles Ă Ă©tablir; la plus volumineuse, sinon la
plus connue, est celle que l'on trouve si développée chez les Crabes,
par exemple; elle est de couleur jaune et on l'appelle vulgairement le
foie;
un autre système de glandes digestives bien développé, du moins chez
les types élevés, est formé par les longs tubes grêles appelés appendices
pyloriques, qui débouchent à la partie antérieure de l'intestin
moyen.
L'appareil circulatoire des Crustacés nous arrêtera aussi un instant. Il est facile, en enlevant avec quelque précaution la carapace d'un Crabe vivant, par exemple, de voir le coeur, organe de forme polygonale, bien reconnaissable à ses contractions rythmiques; le coeur est enveloppé d'un péricarde dans lequel arrive, par un système de vaisseaux, le sang qui provient des branchies; des ouvertures en nombre variable permettent au sang contenu dans le péricarde d'arriver dans le coeur qui va le chasser dans les artères; le retour du sang dans le péricarde, pendant la contraction du coeur, est empêché par les bords des ouvertures de communication de ce dernier, qui jouent le rôle de valvules en s'appliquant l'un contre l'autre. Le mécanisme cardiaque est toujours le même, quelle que soit la forme du coeur, et cette forme est très variable. Les artères, plus ou moins nombreuses, qui partent du coeur ne se terminent pas, après s'être ramifiées, dans un système capillaire qui se rattacherait aux veines : le sang tombe dans les lacunes, entre les organes et c'est dans les lacunes que les veines puisent le sang qu'elles doivent conduire aux branchies (fig. 7). L'appareil circulatoire des Crustacés, comme on peut s'y attendre, va se dégradant de plus en plus, au fur et à mesure que l'on descend vers les formes inférieures. Le sang, dont la couleur est très variable, contient le plus souvent de nombreux éléments amiboïdes; il est coagulable chez les espèces élevées. La respiration des Crustacés se fait très généralement à l'aide des branchies et même, dans les cas où ces animaux sont adaptés à la vie terrestre, comme certains Crabes, des modifications spéciales de la cavité branchiale viennent maintenir l'humidité des lamelles respiratoires; en d'autres cas, chez certains Cloportes, par exemple, l'existence se passe dans un milieu suffisamment humide pour permettre ce mode de respiration. Ontogénèse, reproduction Nous traiterons, à propos des différentes
formes de Crustacés, des modifications de forme que subissent la plupart
de ces animaux au cours de leur développement; disons seulement que ces
modifications sont souvent tellement considérables, que bien des formes
larvaires
avaient été d'abord décrites comme des espèces distinctes et qu'on
peut comparer les métamorphoses des Crustacés à celles des Insectes.
D'une façon générale, et conformément. à un principe qui ne souffre
pas d'exceptions réelles, les différents types de Crustacés traversent,
au cours de leur développement, des phases pendant lesquelles leur forme
rappelle complètement celle des types moins élevés qu'eux en organisation,
de telle sorte qu'on peut comparer les différents membres d'une série
donnée, aux stades que revêt successivement la forme qui est le terme
de la série ( La reproduction des Crustacés se fait par des oeufs; chez certaines formes, fréquentes dans les eaux douces, les mâles sont très rares, ou sont inconnus à certaines époques de l'année, aussi fait-on rentrer dans la parthénogénèse leur reproduction à ces moments-là , ou même leur mode de reproduction habituelle. Les sexes sont séparés en règle générale (exception, Cirrhipèdes, Cymothoïdes); il arrive souvent que le dimorphisme sexuel soit considérable, au point que, pour certains types, les mâles et les femelles ont été décrits comme formant des genres différents (Ancée, par ex.). C'est surtout chez les parasites que s'exagèrent ces différences (Cirrhipèdes, Bopyre, etc.). (R. Moniez). |
|||||||||||||||||||||||||||
| Distribution
géographique
Les Crustacés marins et les Crustacés d'eau douce doivent être étudiés séparément au point de vue de leur dispersion sur le globe. Crustacés marins.
1° zone froide;Ces zones se répètent des deux côtés de l'équateur, ce qui donne cinq zones, en allant d'un pôle à l'autre (zone froide Nord, zone temperée Nord, zone torride (tropicale), zone tempérée Sud, zone froide Sud). Le même auteur divise ensuite les Crustacés marins en cinq grandes régions qui sont : 1° la région occidentale ou américaine qui comprend toutes les côtes des deux AmériquesCes cinq grandes régions sont subdivisées en sous-régions d'après les zones ci-dessus indiquées et en provinces locales assez nombreuses. La région orientale est la plus importante de toutes, car elle possédait (en 1853, époque du travail de Dana) cent quinze genres propres de Crustacés et dix-neuf seulement en commun avec la région africano-européenne. Celle-ci a seulement dix-neuf genres propres et huit en commun avec l'Amérique. Enfin, quarante-sept genres sont exclusivement des côtes d'Amérique (région occidentale), dont quinze sont communs aux deux océans qui la baignent; vingt-six sont de la côte Ouest et six de la côte Est. On voit que les deux rives de l'Atlantique sont plus distincts (huit genres communs seulement) que les deux versants de l'Amérique (quinze genres communs). De plus, quarante genres sont représentés dans toutes les régions. Le nombre des espèces en général ne
paraît pas plus considérable dans la zone tropicale que dans les zones
tempérées et froides. Les Brachyures, cependant, qui sont les plus élevés
des Crustacés, paraissent faire exception par leur abondance sous les
tropiques, mais les types de grande taille, notamment parmi les MaĂŻadae
et les Macroures, sont de la zone tempérée (Macrocheira, Homarus). -
Huit espèces, appartenant aux genres Grapsus, Acanthopus, Plagusia, Bernhardus,
Crangon, Gonodactylus, peuvent être considérées comme cosmopolites.
La vaste dispersion de certains types est remarquable : parmi les Lysianassinae
une espèce du détroit de Magellan
paraît identique à une espèce du Spitzberg;
les Caprellidae ont également des espèces communes aux deux hémisphères.
Certaines espèces se trouvent dans des localités fort éloignées et
manquent dans les localités intermédiaires (Afrique du Sud et îles Hawaii,
Afrique du Sud et Japon). Plagusia tomentosa habite l'Afrique australe,
la Nouvelle-ZĂ©lande et les cĂ´tes du Chili; Cancer Edwardsii, ces deux
dernières localités. Les genres Latreillia, Ephyra, Syciona se trouvent
dans la Méditerranée Distribution
bathymétrique
Crustacés d'eau
douce.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Paléontologie
des Crustacés
Les Crustacés sont représentés dans les couches paléozoïques les plus anciennes (cambrien) par les Ostracodes (Leperdita) et les Phyllocarida (Hymenocaris), groupes encore vivants. Les Cirrhipèdes datent du silurien, ainsi que les Amphipodes. Les Isopodes ne remontent pas au delà du dévonien et sont représentés, à l'époque carbonifère, par des types de grande taille : Acanthotelson, Arthropleura, constituant une famille distincte complètement éteinte. Le genre jurassique Archaeoniscus appartient aux Aegi. dae. Les Cloportes (Oniscidae) terrestres se montrent dans le tertiaire. Les Décapodes ne sont pas connus avec certitude avant le dévonien (Palaeopalaemon) et le carbonifère (Anthrapalaemon); les Macroures ont précédé les Brachyures. Les Eryonidae jurassiques constituent une famille que l'on a longtemps crue complètement éteinte, mais dont quelques représentants vivent encore, comme nous l'avons dit plus haut, dans le fond des Océans. Les Astacomorpha (Astacus, Homarus) apparaissent dans le jurassique (Eryma), et les véritables Ecrevisses dans le crétacé et plus sûrement dans le tertiaire. Les Brachyures (Crabes), les plus modifiés des Décapodes, ne se montrent que dans le crétacé, car les genres Palaeinachus, Prosopon et autres de l'époque jurassique sont très douteux. Le genre Cancer date de l'époque éocène. Comme nous l'avons dit au mot Arthropodes, l'origine des différents types de Crustacés peut être considérée comme polyphylétique ou comme se confondant primitivement avec celle des autres Arthropodes. Cependant, on peut admettre que tous les Malacostraca (Isopodes, Amphipodes, Décapodes, etc.), dérivent d'un type ancestral commun, et les Brachyures sont évidemment des types très modifiés des Macroures. (E. Trouessart). |
|||||||||||||||||||||||||||
| . |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|