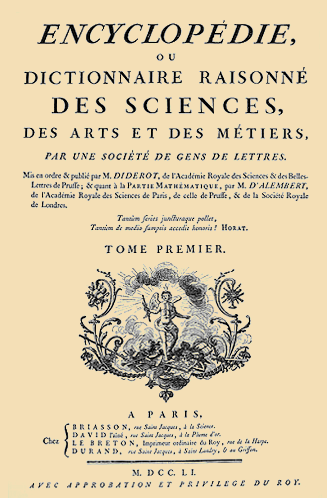| La formation de Diderot.
Entré à neuf ans au collège des jésuites de Langres, à douze il fut tonsuré par provision; un oncle du côté maternel, le chanoine Vigneron, se proposait de lui laisser son bénéfice et on voulait lui conférer les ordres mineurs à la fin de ses études. Celles-ci furent brillantes, mais plusieurs fois compromises par la fougue de son caractère. Les jésuites, qui espéraient en faire une des lumières de leur ordre, lui conseillèrent de se rendre à Paris pour achever ses humanités au collège d'Harcourt (aujourd'hui lycée Saint-Louis). Ce projet, tenu d'abord secret, fut dénoncé au père de Diderot, qui surprit celui-ci au moment même où il cherchait à s'évader de la maison. II le réprimanda doucement et, pour ne pas nuire à ce que chacun (et son fils tout le premier) considérait comme une vocation sérieuse, il le conduisit lui-même à Paris. Il ne repartit qu'au bout de quinze jours, pensant toujours que Denis reviendrait sur sa résolution. Il y persista.
- 
Denis Diderot, par Van Loo (1767). Toutefois, ses études finies, il ne parla plus d'endosser la soutane et entra chez M. Clément de Ris, procureur à Paris. II y passa deux ans, négligeant la procédure pour le grec et le latin, qu'il croyait ne pas savoir assez, les mathématiques , l'italien et l'anglais, qui allaient bientôt devenir ses principaux ou plutôt ses seuls moyens d'existence, car le coutelier, irrité de son insubordination, lui coupa les vivres. Diderot quitta M. Clément de Ris, prit une chambre garnie et continua ses études favorites. Sa mère lui envoyait secrètement quelques louis par une servante, qui fit trois fois à pied le voyage de Langres à Paris, s'en retournant de même, et ajoutant encore ses modestes épargnes à celles de sa maîtresse. Mme de Vandeul (fille de Diderot), qui avait pu voir cette courageuse fille, « dont soixante ans de service n'avaient altéré ni la tête, ni la sensibilité », ne nous a malheureusement pas dit son nom. , l'italien et l'anglais, qui allaient bientôt devenir ses principaux ou plutôt ses seuls moyens d'existence, car le coutelier, irrité de son insubordination, lui coupa les vivres. Diderot quitta M. Clément de Ris, prit une chambre garnie et continua ses études favorites. Sa mère lui envoyait secrètement quelques louis par une servante, qui fit trois fois à pied le voyage de Langres à Paris, s'en retournant de même, et ajoutant encore ses modestes épargnes à celles de sa maîtresse. Mme de Vandeul (fille de Diderot), qui avait pu voir cette courageuse fille, « dont soixante ans de service n'avaient altéré ni la tête, ni la sensibilité », ne nous a malheureusement pas dit son nom. L'existence de travail obscur et de privations vaillamment endurées que s'était imposée Diderot dura environ dix ans. On n'a que fort peu de renseignements sur cette période à laquelle il n'a fait que de rares et vagues allusions. Il enseignait les mathématiques : « L'écolier était-il vif, d'un esprit profond et d'une conception prompte, il lui donnait leçon toute la journée; trouvait-il un sot, il n'y retournait plus. On le payait en livres, en meubles, en linge, en argent ou point : c'était la même chose. » Au besoin, il composait des sermons. Un missionnaire, qui partait pour les colonies portugaises, lui en demanda six, qu'il paya cinquante écus pièce. « Mon père estimait cette affaire une des bonnes qu'il eût faites. » Un jour, las de cette vie besogneuse, il accepta la place de précepteur des enfants de M. Randon de Boisset, riche financier; mais au bout de quelques mois il résigna ses fonctions, ne pouvant s'astreindre, à l'espèce de réclusion qu'il était contraint de
subir. Il retomba dans son ancienne misère, au point de rester toute une journée - c'était un mardi gras - sans prendre aucune nourriture. Il fut secouru, le soir, par son hôtelière, qui s'aperçut de sa détresse. « Ce jour-là, disait-il plus-tard à Mme de Vandeul, je jurai, si jamais je possédais quelque chose, de ne refuser de ma vie à un indigent, de ne jamais condamner mon semblable à une journée aussi pénible. » Jamais, ajoute-t-elle, serment ne fut plus souvent et plus religieusement observé. En 1740, il demeurait rue de l'Observance, et un passage des Mémoires du graveur J. G. Wille, qui vint habiter la même maison, nous le montre se liant avec lui dès la première rencontre et mettant à la disposition du jeune Allemand les livres de sa «-jolie-» bibliothèque. Peu après il s'éprit d'une jeune voisine, Mlle Anne-Antoinette Champion, plus âgée que lui de trois ans, issue par sa mère d'une famille noble du Maine , mais fille d'un inventeur mort à l'hôpital. Les deux femmes vivaient d'un petit commerce de lingerie et de dentelles. La passion d'abord contenue de Diderot ne tarda pas à se faire jour et fut promptement partagée; de part et d'autre, eu égard à la modicité de leurs ressources, les parents refusèrent un consentement que Diderot ne put arracher à son père, mais que Mme Champion finit par lui accorder quand elle vit son désespoir et le dénuement où il vivait. L'humble union fut célébrée en présence des seuls témoins de rigueur, le 6 novembre 1743, en l'église Saint-Pierre-aux-Boeufs. Moins d'un an après, le 13 août 1744, naissait une fille, morte six semaines plus tard; deux fils (nés en 1746 et en 1750) moururent aussi en bas âge. Une seconde fille, Marie-Angélique, née le 2 septembre 1753, survécut seule et devint Mme de Vandeul. , mais fille d'un inventeur mort à l'hôpital. Les deux femmes vivaient d'un petit commerce de lingerie et de dentelles. La passion d'abord contenue de Diderot ne tarda pas à se faire jour et fut promptement partagée; de part et d'autre, eu égard à la modicité de leurs ressources, les parents refusèrent un consentement que Diderot ne put arracher à son père, mais que Mme Champion finit par lui accorder quand elle vit son désespoir et le dénuement où il vivait. L'humble union fut célébrée en présence des seuls témoins de rigueur, le 6 novembre 1743, en l'église Saint-Pierre-aux-Boeufs. Moins d'un an après, le 13 août 1744, naissait une fille, morte six semaines plus tard; deux fils (nés en 1746 et en 1750) moururent aussi en bas âge. Une seconde fille, Marie-Angélique, née le 2 septembre 1753, survécut seule et devint Mme de Vandeul.
L'année même de son mariage, Diderot avait publié la traduction de l'Histoire de la Grèce de Temple Stonyan (3 vol. in-12) que ses modernes éditeurs n'ont pas comprise dans la collection de ses oeuvres, non plus que celle duDictionnaire universel de médecine, de chimie, de botanique, etc., de Robert James (1746-1748, 6 vol. in-fol.), entreprise avec deux littérateurs faméliques, Toussaint et Eidous, auxquels il abandonna une partie de ses propres honoraires, et un médecin breton, Julien Basson, qui révisait l'ensemble de la besogne. Cette compilation hâtive et médiocre serait bien oubliée aujourd'hui si elle n'avait donné, soit à Diderot lui-même, soit à l'abbé Gua de Malves, l'idée première d'un inventaire, mieux ordonné et conçu dans d'autres proportions, de l'état des sciences au milieu du XVIIIe siècle. de Temple Stonyan (3 vol. in-12) que ses modernes éditeurs n'ont pas comprise dans la collection de ses oeuvres, non plus que celle duDictionnaire universel de médecine, de chimie, de botanique, etc., de Robert James (1746-1748, 6 vol. in-fol.), entreprise avec deux littérateurs faméliques, Toussaint et Eidous, auxquels il abandonna une partie de ses propres honoraires, et un médecin breton, Julien Basson, qui révisait l'ensemble de la besogne. Cette compilation hâtive et médiocre serait bien oubliée aujourd'hui si elle n'avait donné, soit à Diderot lui-même, soit à l'abbé Gua de Malves, l'idée première d'un inventaire, mieux ordonné et conçu dans d'autres proportions, de l'état des sciences au milieu du XVIIIe siècle. La publication de l'Encyclopédie
On trouvera au mot Encyclopédie des détails étendus sur les antécédents et l'origine de cette vaste entreprise, les vicissitudes qu'elle traversa, les collaborations qu'elle sut grouper, les concurrences et les contrefaçons qu'elle fit naître; les procès auxquels elle donna lieu; il doit nous suffire ici de résumer la part qu'y prit Diderot. Sollicité par les libraires pour lesquels il travaillait de leur donner son avis sur les chances de succès que présenterait une traduction française de la Cyclopaedia d'Ephraïm Chambers qu'on leur proposait, Diderot réussit à les persuader qu'un livre de cette nature manquait en France et qu'au lieu de le calquer servilement, mieux valait le refaire sur un plus vaste plan et en donnant à la technologie des arts mécaniques une place qui ne lui avait jamais été faite. Non seulement alors la direction de la librairie ne s'opposa pas à l'exécution de cette oeuvre immense, mais ce fut le pieux chancelier Dagnesseau lui-même qui désigna Diderot aux libraires comme l'homme le mieux préparé à la tâche de directeur ou, suivant l'expression du temps, d'« éditeur ». Toutefois, Diderot n'avait aucune fonction officielle et n'appartenait à aucun corps; aussi eut-il l'adresse de décider d'Alembert à partager les responsabilités de l'entreprise et à laisser figurer son nom sur le frontispice du futur ouvrage où lui-même n'était désigné que par des astérisques. Le privilège obtenu en 1745 fut scellé le 21 janvier 1746, et les deux éditeurs, auxquels les libraires associés faisaient une rente de 1200 livres, se mirent à l'oeuvre. et qu'au lieu de le calquer servilement, mieux valait le refaire sur un plus vaste plan et en donnant à la technologie des arts mécaniques une place qui ne lui avait jamais été faite. Non seulement alors la direction de la librairie ne s'opposa pas à l'exécution de cette oeuvre immense, mais ce fut le pieux chancelier Dagnesseau lui-même qui désigna Diderot aux libraires comme l'homme le mieux préparé à la tâche de directeur ou, suivant l'expression du temps, d'« éditeur ». Toutefois, Diderot n'avait aucune fonction officielle et n'appartenait à aucun corps; aussi eut-il l'adresse de décider d'Alembert à partager les responsabilités de l'entreprise et à laisser figurer son nom sur le frontispice du futur ouvrage où lui-même n'était désigné que par des astérisques. Le privilège obtenu en 1745 fut scellé le 21 janvier 1746, et les deux éditeurs, auxquels les libraires associés faisaient une rente de 1200 livres, se mirent à l'oeuvre. Au moment où les négociations préliminaires aboutissaient à un projet nettement défini, Diderot n'avait encore publié qu'une traduction de l'Essai sur le mérite et la vertu, de Shaftesbury (1745, in-12), suivie d'une lettre à son frère, et qui ne trahissait guère que ce qu'on a appelé un déisme de transition; mais il ne tarda pas à s'émanciper de cette prudente réserve et à se signaler aux adversaires qui le guettaient. Afin de hâter la réconciliation entre sa famille et lui, il avait envoyé à Langres sa femme et le fils qui venait de lui naître (1746), et tandis que s'opérait un rapprochement depuis longtemps attendu, resté seul à Paris, il s'éprit d'une dame de Puisieux, femme d'un de ces traducteurs « à la toise » qui pullulaient alors. Elle lui fit, vraisemblablement, revoir quelques-uns de ses propres livres, et multiplia les appels à sa libéralité. C'est ainsi qu'en trois jours, du vendredi saint à la semaine de Pâques 1746, il jeta sur le papier les Pensées philosophiques qui lui furent payées cinquante louis, tout comme les Bijoux indiscrets (1748), improvisés en quinze jours et dont le prix eut la même destination. Les Pensées philosophiques furent condamnées au feu par arrêt du Parlement du 7 juillet et provoquèrent plusieurs réfutations, tandis que les Bijoux indiscrets, résultat d'une gageure dont Diderot sortit vainqueur, circulaient sans encombre, mais sous le manteau. Sur une donnée scabreuse, renouvelée d'ailleurs d'un fabliau du Moyen âge 1746, il jeta sur le papier les Pensées philosophiques qui lui furent payées cinquante louis, tout comme les Bijoux indiscrets (1748), improvisés en quinze jours et dont le prix eut la même destination. Les Pensées philosophiques furent condamnées au feu par arrêt du Parlement du 7 juillet et provoquèrent plusieurs réfutations, tandis que les Bijoux indiscrets, résultat d'une gageure dont Diderot sortit vainqueur, circulaient sans encombre, mais sous le manteau. Sur une donnée scabreuse, renouvelée d'ailleurs d'un fabliau du Moyen âge , l'auteur avait échafaudé une série d'aventures burlesques ou licencieuses dont le moindre défaut est la monotonie. En revanche, on y trouve quelques pages dont, selon la remarque de A. Mézières, Lessing a fait son profit dans sa Dramaturgie. La même année, et comme pour montrer que cette débauche littéraire n'était qu'un passe-temps, Diderot réunit en un volume cinq Mémoires sur différents sujets de mathématiques (1748, in-8). , l'auteur avait échafaudé une série d'aventures burlesques ou licencieuses dont le moindre défaut est la monotonie. En revanche, on y trouve quelques pages dont, selon la remarque de A. Mézières, Lessing a fait son profit dans sa Dramaturgie. La même année, et comme pour montrer que cette débauche littéraire n'était qu'un passe-temps, Diderot réunit en un volume cinq Mémoires sur différents sujets de mathématiques (1748, in-8). L'Encyclopédie , célèbre avant de naître, n'était pas attendue seulement par les nombreux souscripteurs que sa seule annonce avait rassemblés; jansénistes et molinistes s'unissaient dans une commune méfiance contre une oeuvre dont les premiers suspectaient la tendance et dont les seconds, malgré leurs avances, s'étaient vus évincer. Dès le mois de juin 1747, le curé de la paroisse Saint-Médard, sur laquelle demeurait Diderot, le signalait au lieutenant de police Berryer comme « faisant le bel esprit et trophée d'impiété », et comme composant en ce moment même un ouvrage «-fort dangereux-» : c'étaient les Allées ou la Promenade du sceptique, allégorie toute métaphysique et dont une clef, rédigée par l'auteur, révélait le sens; mais l'information en resta là provisoirement, malgré la nouvelle dénonciation de l'exempt chargé de vérifier les dires du curé. La Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient (1749, in-12) n'est pas, comme le titre pourrait le faire croire, un badinage irréligieux dans la manière de Voltaire, mais la relation des expériences faites par Réaumur sur un aveugle-né qu'on opéra de la cataracte. Diderot assista, en compagnie d'autres curieux, à la levée de l'appareil, mais jugea bien vite aux réponses du malade qu'il avait déjà vu la lumière; il lui échappa un mot piquant sur les beaux yeux de Mme Dupré de Saint-Maur, amie de Réaumur, et aussi du comte d'Argenson, ministre de la guerre, ou plus exactement alors premier ministre. Mme Dupré de Saint Maur trouva le propos offensant pour sa réputation de jolie femme et de femme savante. Trois jours après (24 juillet 1749) une perquisition eut lieu chez Diderot. Le prétexte fut la recherche du manuscrit des Allées et d'un conte également manuscrit intitulé l'Oiseau blanc, conte bleu, composé à la même date que les Bijoux indiscrets et renfermant, disait-on, des allusions à Mme de Pompadour. Le motif réel était de mettre l'embargo sur les matériaux accumulés de l'Encyclopédie. , célèbre avant de naître, n'était pas attendue seulement par les nombreux souscripteurs que sa seule annonce avait rassemblés; jansénistes et molinistes s'unissaient dans une commune méfiance contre une oeuvre dont les premiers suspectaient la tendance et dont les seconds, malgré leurs avances, s'étaient vus évincer. Dès le mois de juin 1747, le curé de la paroisse Saint-Médard, sur laquelle demeurait Diderot, le signalait au lieutenant de police Berryer comme « faisant le bel esprit et trophée d'impiété », et comme composant en ce moment même un ouvrage «-fort dangereux-» : c'étaient les Allées ou la Promenade du sceptique, allégorie toute métaphysique et dont une clef, rédigée par l'auteur, révélait le sens; mais l'information en resta là provisoirement, malgré la nouvelle dénonciation de l'exempt chargé de vérifier les dires du curé. La Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient (1749, in-12) n'est pas, comme le titre pourrait le faire croire, un badinage irréligieux dans la manière de Voltaire, mais la relation des expériences faites par Réaumur sur un aveugle-né qu'on opéra de la cataracte. Diderot assista, en compagnie d'autres curieux, à la levée de l'appareil, mais jugea bien vite aux réponses du malade qu'il avait déjà vu la lumière; il lui échappa un mot piquant sur les beaux yeux de Mme Dupré de Saint-Maur, amie de Réaumur, et aussi du comte d'Argenson, ministre de la guerre, ou plus exactement alors premier ministre. Mme Dupré de Saint Maur trouva le propos offensant pour sa réputation de jolie femme et de femme savante. Trois jours après (24 juillet 1749) une perquisition eut lieu chez Diderot. Le prétexte fut la recherche du manuscrit des Allées et d'un conte également manuscrit intitulé l'Oiseau blanc, conte bleu, composé à la même date que les Bijoux indiscrets et renfermant, disait-on, des allusions à Mme de Pompadour. Le motif réel était de mettre l'embargo sur les matériaux accumulés de l'Encyclopédie. Diderot, interrogé par Berryer lui-même, nia intrépidement la paternité des Pensées philosophiques, des Bijoux indiscrets et de la Lettre sur les aveugles, avoua celle des Allées dont le manuscrit avait été saisi, et refusa de livrer celui de l'Oiseau blanc. Conduit au donjon de Vincennes, il y fut maintenu vingt-huit jours au secret le plus absolu, n'ayant pour toute distraction qu'un petit volume des oeuvres de Milton dont il couvrit les marges d'annotations à l'aide d'un cure-dents trempé dans une mixture de vin et d'ardoise pilée. Deux requêtes fortement motivées présentées par les libraires au comte d'Argenson, et les supplications adressées par Mme Diderot au lieutenant de police adoucirent enfin ces rigueurs excessives et, le 21 août suivant, Diderot, désormais considéré comme prisonnier sur parole, partageant même la table du gouverneur du château (Bernard du Châtelet), jouissant de la liberté de se promener dans le parc, put conférer avec les libraires et les dessinateurs de l'Encyclopédie , revoir sa femme, sa maîtresse et ses amis. Le plus illustre d'entre eux, à cette date, Jean-Jacques Rousseau, a raconté dans une page célèbre comment, en se rendant un jour d'été à Vincennes, il jeta par hasard les yeux sur le programme d'un concours ouvert par l'académie de Dijon et dans quel trouble le jeta la fameuse question : Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs? Fut-ce réellement Diderot qui lui conseilla de prendre le contre-pied de l'opinion courante et de démontrer les dangers et les crimes engendrés par la civilisation? Les témoignages contradictoires que l'on pourrait alléguer ont embrouillé le débat plus qu'ils ne l'ont éclairé. Un seul point est indiscutable: Rousseau se prononça résolument et à jamais pour la négative et Diderot n'a repris qu'une seule fois ce paradoxe, et comme en se jouant, dans le Supplément au Voyage de Bougainville. Tous ses autres écrits, et l'Encyclopédie la première, sont là pour attester quelle fut sur ce point sa véritable et constante opinion. , revoir sa femme, sa maîtresse et ses amis. Le plus illustre d'entre eux, à cette date, Jean-Jacques Rousseau, a raconté dans une page célèbre comment, en se rendant un jour d'été à Vincennes, il jeta par hasard les yeux sur le programme d'un concours ouvert par l'académie de Dijon et dans quel trouble le jeta la fameuse question : Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs? Fut-ce réellement Diderot qui lui conseilla de prendre le contre-pied de l'opinion courante et de démontrer les dangers et les crimes engendrés par la civilisation? Les témoignages contradictoires que l'on pourrait alléguer ont embrouillé le débat plus qu'ils ne l'ont éclairé. Un seul point est indiscutable: Rousseau se prononça résolument et à jamais pour la négative et Diderot n'a repris qu'une seule fois ce paradoxe, et comme en se jouant, dans le Supplément au Voyage de Bougainville. Tous ses autres écrits, et l'Encyclopédie la première, sont là pour attester quelle fut sur ce point sa véritable et constante opinion. Rendu enfin à la liberté le 3 novembre 1749, il rédigea le prospectus de l'ouvrage et le tableau des connaissances humaines qui l'accompagnait et fit imprimer séparément l'article Art. Aux polémiques qu'il souleva, il répondit d'abord par la lettre sur les sourds et muets qui visait les Beaux Arts réduits à un même principe de l'abbé Battaux, puis par deux Lettres fort piquantes au P. Berthier, rédacteur du Journal de Trévoux. Enfin le tome Ier parut en 1751, précédé du Prospectus et du tableau rédigé par Diderot, d'un magistral Discours préliminaire de d'Alembert, et d'une dédicace au comte d'Argenson que Diderot dut signer d'assez mauvaise grâce, mais dont il ne pouvait méconnaître la nécessité. de d'Alembert, et d'une dédicace au comte d'Argenson que Diderot dut signer d'assez mauvaise grâce, mais dont il ne pouvait méconnaître la nécessité.
Le succès dépassa l'attente des libraires, des auteurs et de leurs ennemis : deux mille exemplaires furent répandus en quelques mois, et de nouvelles souscriptions affluaient de toutes parts, quand un arrêt du conseil du 7 février 1752 suspendit la distribution du tome Il. Levé par le crédit de d'Argenson, cet interdit, dont les véritables instigateurs étaient, selon Barbier (Journal, février 1752), les jésuites et Boyer, évêque de Mirepoix, suivit de très près la censure prononcée le 27 janvier 1752 par la Sorbonne, contre une thèse de l'abbé de Prades sur l'authenticité des miracles sur l'authenticité des miracles . Diderot avait-il réellement collaboré à cette thèse? Rien ne le prouve, mais l'opinion l'en soupçonna unanimement, alors que personne ne s'avisa sur l'heure de reconnaître sa griffe dans l'Apologie publiée par l'abbé, et dont la troisième partie lui appartient cependant tout entière. Clément de Genève comparait la péroraison de cette troisième partie à un morceau de Bossuet, et Buffon la tenait pour une des pages les plus éloquentes de la langue française. . Diderot avait-il réellement collaboré à cette thèse? Rien ne le prouve, mais l'opinion l'en soupçonna unanimement, alors que personne ne s'avisa sur l'heure de reconnaître sa griffe dans l'Apologie publiée par l'abbé, et dont la troisième partie lui appartient cependant tout entière. Clément de Genève comparait la péroraison de cette troisième partie à un morceau de Bossuet, et Buffon la tenait pour une des pages les plus éloquentes de la langue française.
- 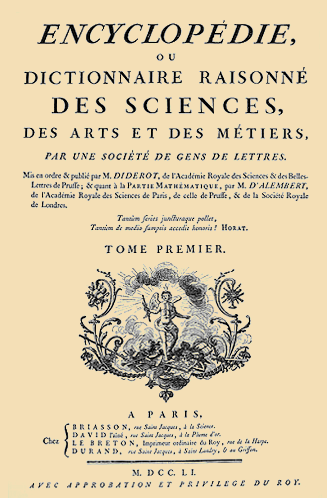
L'Encyclopédie (frontispice du tome 1). Ici commence la phase la plus active et la plus féconde de la vie de Diderot : les travaux, les chagrins, les déboires, les triomphes qui la remplissent rendent la tâche fort difficile à ses biographes. Pendant que se poursuivent sans trop d'encombres l'impression et la distribution des tomes III, IV, V et VI de l'Encyclopédie où il a, comme dans ceux qui précèdent et qui vont suivre, la tâche la plus neuve et la plus difficile : la description des arts et métiers, sans préjudice des synonymes et du résumé de l'histoire des diverses écoles philosophiques, il prend part à la querelle des Bouffons, met au jour le petit traité de l'Interprétation de la nature où il a, comme dans ceux qui précèdent et qui vont suivre, la tâche la plus neuve et la plus difficile : la description des arts et métiers, sans préjudice des synonymes et du résumé de l'histoire des diverses écoles philosophiques, il prend part à la querelle des Bouffons, met au jour le petit traité de l'Interprétation de la nature , ruine les prétendues découvertes du comte de Caylus sur l'encaustique des anciens en révélant l'Histoire et le secret de la peinture en cire (1757), et donne du même coup la théorie et l'application de ses idées sur le drame moderne avec le Fils naturel , ruine les prétendues découvertes du comte de Caylus sur l'encaustique des anciens en révélant l'Histoire et le secret de la peinture en cire (1757), et donne du même coup la théorie et l'application de ses idées sur le drame moderne avec le Fils naturel (1757) et le Père de famille (1757) et le Père de famille (1758). Le premier ne fut représenté qu'en 1771, deux fois seulement, par suite de dissensions entre les acteurs, et le second, dont l'impression même souffrit de réelles difficultés, et qui vit la rampe dès 1761, eut à Paris d'abord, puis en province et à l'étranger, d'assez fréquentes reprises. Les théories exposées par Diderot dans son Discours sur la poésie dramatique émurent la bile de Palissot et les accusations du plagiat dont l'auteur s'était, disait-on, rendu coupable à l'égard de Goldoni s'envenimèrent encore, au lieu de s'apaiser, lorsque Grimm eut agrémenté de dédicaces satiriques les traductions, dues à Forbonnais et à Deleyre, du Véritable Ami et du Père de famille du poète italien. (1758). Le premier ne fut représenté qu'en 1771, deux fois seulement, par suite de dissensions entre les acteurs, et le second, dont l'impression même souffrit de réelles difficultés, et qui vit la rampe dès 1761, eut à Paris d'abord, puis en province et à l'étranger, d'assez fréquentes reprises. Les théories exposées par Diderot dans son Discours sur la poésie dramatique émurent la bile de Palissot et les accusations du plagiat dont l'auteur s'était, disait-on, rendu coupable à l'égard de Goldoni s'envenimèrent encore, au lieu de s'apaiser, lorsque Grimm eut agrémenté de dédicaces satiriques les traductions, dues à Forbonnais et à Deleyre, du Véritable Ami et du Père de famille du poète italien. La publication du septième volume de l'Encyclopédie déchaîne l'orage suspendu depuis le premier jour et que, cette fois, Malesherbes et Mme de Pompadour sont impuissants à conjurer. Quelques lignes d'un article de d'Alembert sur Genève où il donne à entendre que les doctrines sociniennes sont celles du Grand Conseil et où il conseille aux Genevois de tolérer l'établissement d'un théâtre mettent aux prises l'auteur avec les magistrats de la petite république, puis avec Jean-Jacques Rousseau. Celui-ci, tout ému encore de sa rupture avec Diderot, dont les causes n'ont jamais été nettement connues, réfute d'Alembert dans sa fameuse Lettre sur les spectacles et désigne si clairement son ancien ami dans une note empruntée à l'Ecclésiaste déchaîne l'orage suspendu depuis le premier jour et que, cette fois, Malesherbes et Mme de Pompadour sont impuissants à conjurer. Quelques lignes d'un article de d'Alembert sur Genève où il donne à entendre que les doctrines sociniennes sont celles du Grand Conseil et où il conseille aux Genevois de tolérer l'établissement d'un théâtre mettent aux prises l'auteur avec les magistrats de la petite république, puis avec Jean-Jacques Rousseau. Celui-ci, tout ému encore de sa rupture avec Diderot, dont les causes n'ont jamais été nettement connues, réfute d'Alembert dans sa fameuse Lettre sur les spectacles et désigne si clairement son ancien ami dans une note empruntée à l'Ecclésiaste , que, sans qu'il y soit nommé, chacun l'a reconnu. En même temps, Helvétius, dont les liaisons avec les encyclopédistes ne sont un mystère pour personne, voit son livre De l'Esprit (1758, in-4) déféré au parlement, et bientôt, sur le réquisitoire de Joly de Fleury, un même arrêt englobant l'Encyclopédie , que, sans qu'il y soit nommé, chacun l'a reconnu. En même temps, Helvétius, dont les liaisons avec les encyclopédistes ne sont un mystère pour personne, voit son livre De l'Esprit (1758, in-4) déféré au parlement, et bientôt, sur le réquisitoire de Joly de Fleury, un même arrêt englobant l'Encyclopédie , De l'Esprit et six brochures traitant de matières philosophiques, ordonne pour la forme que ces livres seront lacérés et brûlés par l'exécuteur des hautes oeuvres, et nomme une commission de théologiens et de sorbonnistes pour donner leur avis sur les sept volumes de l'Encyclopédie. Un second arrêt révoque le privilège accordé en 1746 aux libraires associés (8 mars 1759) et un troisième, en date du 21 juillet 1759, ordonne le remboursement aux souscripteurs de 72 livres sur les avances qu'ils ont faites pour recevoir la totalité de l'ouvrage officiellement supprimé. , De l'Esprit et six brochures traitant de matières philosophiques, ordonne pour la forme que ces livres seront lacérés et brûlés par l'exécuteur des hautes oeuvres, et nomme une commission de théologiens et de sorbonnistes pour donner leur avis sur les sept volumes de l'Encyclopédie. Un second arrêt révoque le privilège accordé en 1746 aux libraires associés (8 mars 1759) et un troisième, en date du 21 juillet 1759, ordonne le remboursement aux souscripteurs de 72 livres sur les avances qu'ils ont faites pour recevoir la totalité de l'ouvrage officiellement supprimé. D'Alembert perd courage, malgré les supplications de Voltaire et les objurgations de Diderot; il abandonne la partie et laisse son collègue se débattre seul avec la cour, le parlement, la Sorbonne, les collaborateurs, les libraires et les souscripteurs. Tout manque à la fois à Diderot, tout, moins le courage et la foi dans son oeuvre. Ne comptant pour rien la fatigue et le danger, il assume toutes les responsabilités, rassure les libraires atterrés, obtient de la plupart de ses amis qu'ils lui livrent la suite de leurs articles et trouve dans l'un d'eux, le chevalier Louis de Jaucourt, le plus infatigable et le plus désintéressé concours. En six ans, ils préparent, revoient et impriment les dix volumes in-folio et les cinq premiers volumes des planches, qui, par une étrange inconséquence, ne sont pas comprises dans la révocation du privilège. D'ailleurs, tout en donnant satisfaction aux ennemis de l'Encyclopédie , le gouvernement, dit Grimm, , le gouvernement, dit Grimm, « la regardait comme un objet de commerce et sachant qu'il s'agissait d'une circulation de trois millions au moins, ne se souciait pas que l'ouvrage fut achevé hors du royaume, et que les profits en restassent aux étrangers ». La direction de la librairie feignait d'ignorer que cinquante ouvriers travaillaient journellement à la composition et au tirage, et à cela seulement se bornait une tolérance toujours à la merci de n'importe quel dénonciateur. En dépit de l'arrêt de mort qui l'a frappée, de la défection de d'Alembert, bientôt connue de tous, du silence imposé à ceux mêmes qui seraient en droit de la lui reprocher, l'Encyclopédie reste le point de mire de toutes les querelles littéraires du temps. C'est elle que vise Lefranc de Pompignan dans ce fameux discours de réception à l'Académie française que Voltaire lui fit si cruellement expier; c'est son créateur que Palissot met en scène, comme un filou et comme un escroc, dans les Philosophes (1760), sous le nom de Dortidius, que Fréron lui emprunte pour ce compte rendu de la première représentation de l'Ecossaise, la meilleure page peut-être qu'il ait écrite, mais où il prête au philosophe un rôle que celui-ci n'a jamais joué. reste le point de mire de toutes les querelles littéraires du temps. C'est elle que vise Lefranc de Pompignan dans ce fameux discours de réception à l'Académie française que Voltaire lui fit si cruellement expier; c'est son créateur que Palissot met en scène, comme un filou et comme un escroc, dans les Philosophes (1760), sous le nom de Dortidius, que Fréron lui emprunte pour ce compte rendu de la première représentation de l'Ecossaise, la meilleure page peut-être qu'il ait écrite, mais où il prête au philosophe un rôle que celui-ci n'a jamais joué. Fidèle à son serment de ne pas écrire « un mot de représailles » (lettre à Malesherbes, 1er juin 1760), Diderot eut encore à se défendre contre les tentatives que Voltaire faisait à son insu pour lui ouvrir les portes de l'Académie française. Ce fut, durant quelques mois, une idée fixe qui revient dans chacune de ses lettres à d'Alembert, à Mme d'Epinay, à Damilaville, à d'Argental, voire même, semble-t-il, à Choiseul; mais d'Alembert ne se souciait pas d'appuyer une candidature aussi inopportune et qui laissait Diderot lui-même fort indifférent. Louis XV, pressenti (peut-être par Mme de Pompadour), aurait répondu « Il a trop d'ennemis », et l'affaire en resta là. Une autre déception, bien autrement cruelle et dont il ne se consola jamais, était réservée à Diderot. Les volumes de l'Encyclopédie une fois imprimés allaient s'empiler dans les magasins de Briasson et de Le Breton et n'en devaient sortir qu'à l'achèvement du dernier tome. Un seul exemplaire était réservé à Diderot. Or, un jour, il eut besoin de consulter un article de la lettre S et ne retrouva pas ce qu'il se souvenait d'avoir écrit. Stupéfait, il recourut à d'autres articles et constata les mêmes mutilations. C'était Le Breton qui, effrayé de la hardiesse de certains passages et ne tenant pas compte du bon à tirer de l'auteur, faisait pratiquer par son prote ces prétendues corrections! La colère de Diderot fut terrible, et il écrivit à Le Breton une lettre véhémente où il le menaçait de tout révéler aux collaborateurs dont la pensée n'avait pas été mieux respectée que la sienne propre; mais, sur les représentations de Grimm, il s'apaisa, reconnut qu'un tel éclat pouvait de nouveau et à jamais faire échouer l'entreprise, et exigea seulement qu'on tirât pour lui des cartons où le texte authentique était rétabli. Cet exemplaire, selon Mme de Vandeul, passa en Russie une fois imprimés allaient s'empiler dans les magasins de Briasson et de Le Breton et n'en devaient sortir qu'à l'achèvement du dernier tome. Un seul exemplaire était réservé à Diderot. Or, un jour, il eut besoin de consulter un article de la lettre S et ne retrouva pas ce qu'il se souvenait d'avoir écrit. Stupéfait, il recourut à d'autres articles et constata les mêmes mutilations. C'était Le Breton qui, effrayé de la hardiesse de certains passages et ne tenant pas compte du bon à tirer de l'auteur, faisait pratiquer par son prote ces prétendues corrections! La colère de Diderot fut terrible, et il écrivit à Le Breton une lettre véhémente où il le menaçait de tout révéler aux collaborateurs dont la pensée n'avait pas été mieux respectée que la sienne propre; mais, sur les représentations de Grimm, il s'apaisa, reconnut qu'un tel éclat pouvait de nouveau et à jamais faire échouer l'entreprise, et exigea seulement qu'on tirât pour lui des cartons où le texte authentique était rétabli. Cet exemplaire, selon Mme de Vandeul, passa en Russie avec sa bibliothèque. avec sa bibliothèque. Dans le courant de 1765, les dix derniers volumes de texte et les cinq premiers volumes de planches purent être enfin délivrés aux souscripteurs, sur le visa de Sartines, « afin qu'on n'abusât point de cette facilité ». C'est donc en cachette et avec plus de précautions que l'on n'en exigeait alors pour n'importe quel roman, soi-disant imprimé à Bagdad ou à Ispahan ou à Ispahan , que s'acheva cet ouvrage, l'un des titres de gloire du XVIIIe siècle et qui reste une grande date dans l'histoire des conquêtes de l'esprit scientifique et critique. (Maurice Tourneux). , que s'acheva cet ouvrage, l'un des titres de gloire du XVIIIe siècle et qui reste une grande date dans l'histoire des conquêtes de l'esprit scientifique et critique. (Maurice Tourneux). | |