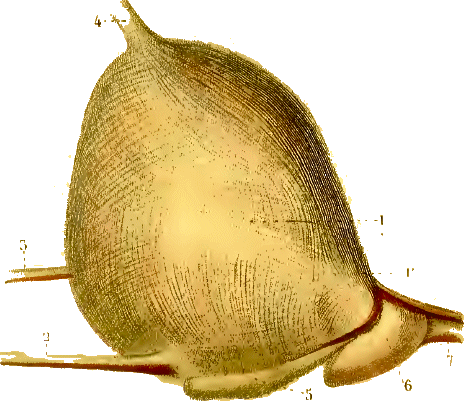|
La vessie,
organe dans lequelle l'urine séjourne pendant
quelques heures, est une sorte de globe contractile et élastique
qui repose sur le périnée.
Sa paroi est formée de fibres musculaires lisses accompagnées
de libres élastiques, et est revêtue intérieurement
d'un épithélium stratifié imperméable. Elle
se distend et s'élève dans la cavité
abdominale, en refoulant les intestins, le
mesure que l'urine y arrive goutte à goutte. Quand elle est pleine,
elle se contracte par voie réflexe et chasse son contenu dans un
canal impair et médian, le canal de l'urètre, qui le déverse
à son tour à l'extérieur. Ce canal est toujours maintenu
fermé, à sa naissance, par un muscle circulaire ou sphincter
qui cède lorsque l'urine est poussée avec une certaine force
par la vessie, aidée des muscles de la paroi abdominale. Lorsqu'elle
vient de se vider, la vessie n'a, pour ainsi dire, pas de cavité,
et se cache derrière le pubis. L'épaisseur
de la paroi vésicale ne dépasse
pas 2 millimètres dans l'état de moyenne distension.
On considère à la vessie
le corps et le col. Le corps est la partie globuleuse que distend l'urine.
Le col est l'ouverture, entourée du sphincter
vésical. Le col, auquel fait suite l'urètre,
est en partie entouré par la prostate.
Quoique cet organe, à l'état de distension, soit globuleux,
on lui décrit généralement six faces : antérieure,
postérieure, supérieure, inférieure et latérales.
La face antérieure est en rapport avec le pubis. Lorsqu'elle est
distendue, elle monte au-dessus du pubis et s'applique contre la paroi
abdominale antérieure, en soulevant le péritoine.
La face postérieure est complètement recouverte par le péritoine.
Chez la femme, elle est en rapport avec
le corps de l'utérus, dont elle est séparée
par un cul-de-sac péritonéal, le cul-de-sac vésico-utérin.
Chez l'homme, elle est en rapport avec le rectum,
dont elle est séparée par le cul-de-sac recto-vésical.
La face supérieure, ou sommet, donne insertion
à un ligament venu de l'ombilic,
l'ouraque. La face inférieure, ou
base, est étendue, chez la femme, du col vésical au cul-de-sac
vésico-utérin. Elle est en rapport, d'arrière en avant,
avec le tiers inférieur du corps de l'utérus,
avec la portion extra-vaginale du col et avec la paroi antérieure
du vagin, qui forme avec elle la cloison,
vésico-vaginale. Chez l'homme, la base de la vessie est en rapport
avec le rectum, dont elle est séparée par l'aponévrose
prostato-péritonéale au milieu, et par les vésicules
séminales de chaque côté. Les faces latérales
sont recouvertes par le péritoine dans leur moitié supérieure
et sont en rapport avec les parois du petit bassin dans leur moitié
inférieure.
-
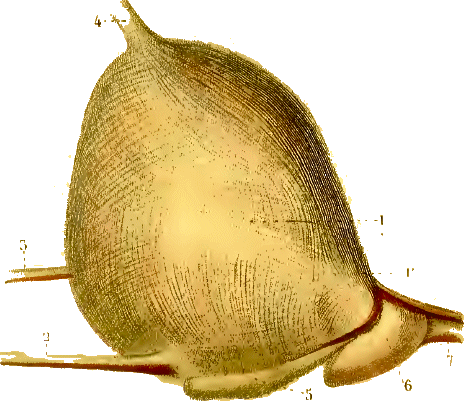
| Vessie
vue de profil du côté droit. - 1. Fibres charnues à
diverses directions. - 1'. Col de la vessie. - 2 et 3. Uretères.
- 4. Ouraque. - 5. Vésicule séminale. - 6. Prostate. - 7.
Portion du canal de l'urètre. |
Les parois vésicales sont formées
par quatre couches : séreuse, musculeuse,
celluleuse, muqueuse. La couche séreuse ne recouvre que les parties
supérieure et postérieure de la vessie, d'où elle
se réfléchit, en formant autour de cet organe une gouttière
circulaire. Puis elle se continue de tous côtés avec le reste
du péritoine. La couche musculeuse est
formée de fibres longitudinales superficielles et de fibres circulaires
profondes. Les fibres longitudinales semblent naître vers le sommet
d'où elles s'irradient à la surface du corps jusqu'au col
vésical; là, quelques-unes se continuent avec les fibres
musculaires de la prostate, avec celles de l'urètre, avec quelques
fibres du releveur de l'anus,
et même des parois rectales. Les fibres circulaires sous-jacentes
aux précédentes forment des anneaux étendus du sommet
à la base de la vessie. Très nombreuses au niveau du col,
les fibres musculaires forment de gros faisceaux dont l'ensemble constitue
le sphincter vésical.
La couche celluleuse est une mince lamelle
de tissu conjonctif qui unit la musculeuse à la muqueuse; on l'appelle
encore couche sous-muqueuse. La couche muqueuse, rosée, présente
un épithélium pavimenteux stratifié
à sa surface libre en contact avec l'urine; le chorion
ou derme de la muqueuse est une sorte de feutrage de faisceaux de tissu
conjonctif mêlés de fibres élastiques. La muqueuse
de la base de la vessie est plus blanche et plus lisse; elle forme, entre
l'orifice de l'urètre et ceux des uretères,
une surface triangulaire, trigone vésical
ou trigone de Lieutaud. Sur les autres points de l'intérieur de
la vessie, on voit des saillies longitudinales formées par les faisceaux
musculaires, limitant des dépressions plus ou moins profondes. Cette
disposition est quelquefois exagérée dans quelques vessies,
auxquelles on donne le nom de vessies à colonnes et de vessies à
cellules.
Les artères
de la vessie sont nombreuses; la principale, vésicale inférieure;
vient de l'iliaque interne. La vessie reçoit
en outre de nombreuses branches des artères du voisinage : hémorroïdales
moyennes, pudendale interne. Les veines,
nées de tous les points de la vessie, se rendent vers le col, se
mêlent aux veines de la prostate, pour former le plexus veineux vésico-prostatique,
qui se continue, en avant, avec le plexus de Santorini. Les nerfs
viennent du plexus-hypogastrique,
contenant des nerfs cérébro-spinaux et des filets du grand
sympathique.
Dans les premières formations embryonnaires,
la vessie et le rectum communiquent et forment
le cloaque. Le développement de la cloison
recto-vésicale est plus tardif. Lorsque la vésicule allantoïde
se développe, sa portion intra-embryonnaire, qui a la forme d'un
tube, se dilate pour former la vessie; mais une portion, intermédiaire
à la vessie et à l'ombilic, se resserre pour former le ligament
de l'ouraque. Chez quelques sujets, le canal de
l'ouraque persiste; cet organe restant imperméable, il s'écoule
de l'urine par l'ombilic fistule urinaire ombilicale congénitale.
La vessie sert de réservoir momentané
à l'urine; elle se vide lorsqu'elle contient environ 250 grammes
de liquide, c.-à-d. quatre à cinq fois par jour, puisqu'une
personne en bonne santé fait en moyenne 1250 g d'urine. Le besoin
d'uriner se fait sentir lorsque la distension des parois de la vessie surexcite
les nerfs sensitifs de cet organe. Le sphincter vésical, qui entoure
le col, a pour rôle d'empêcher l'issue de l'urine au dehors
pendant la réplétion de la vessie. Le mécanisme de
la miction est des plus simples. Les fibres musculaires du corps de, la
vessie se contractent sur le liquide qu'elles compriment. Celui-ci, pressé
de toutes parts par les parois vésicales, exerce une pression sur
le sphincter, de la résistance duquel elles finissent par triompher.
Le cours de l'urine a toujours lieu dans le même sens. Ce liquide,
amené à la vessie, s'y accumule lentement et ne rétrograde
jamais vers sa source, à cause de la disposition spéciale
des uretères au moment où ils traversent les parois vésicales.
L'absorption de la muqueuse vésicale est nulle. Il devait en être
ainsi, puisque l'urine est un liquide toxique. (A19). |
|