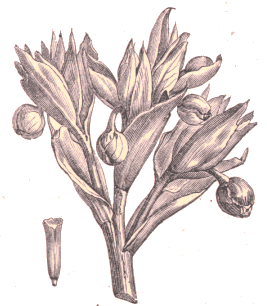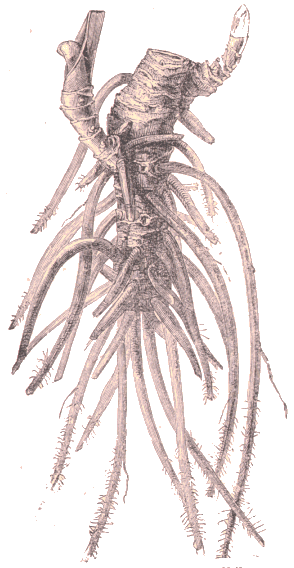|
Les
Hellébores (Helleborus Tourn.) forment un genre de Renonculacées.
Ce sont des herbes vivaces, souvent
pourvues d'un rhizome très développé, à feuilles
alternes, plus ou moins profondément découpées, à
fleurs solitaires ou groupées en cymes
pauciflores à l'extrémité des rameaux supérieurs;
chaque fleur a un périanthe simple à cinq ou six folioles
herbacées ou colorées, des staminodes en nombre variable
et de nombreuses étamines à insertion
spirale. Le gynécée est formé
d'un nombre variable de carpelles libres qui
deviennent, à la maturité, des follicules
renfermant de nombreuses graines albuminées.
Les Hellébores
sont répandus dans les régions tempérées de
l'Europe ,
de l'Asie occidentale et de l'Amérique ,
de l'Asie occidentale et de l'Amérique boréale. Parmi la quinzaine d'espèces connues, il convient
de mentionner surtout l'Helleborus foetidus L., H. viridis L:, l'H. niger
L. et l'H. orientalis L.
boréale. Parmi la quinzaine d'espèces connues, il convient
de mentionner surtout l'Helleborus foetidus L., H. viridis L:, l'H. niger
L. et l'H. orientalis L.
L'Helleborus foetidus
(Hellebore fétide) se rencontre communément en Europe, dans
les lieux pierreux et les endroits découverts des bois. On l'appelle
vulgairement Pied de griffon, Pied de lion, Patte d'ours, Herbe aux
boeufs, etc. C'est une plante à odeur
vireuse, dont le rhizome épais donne
naissance à des tiges robustes, dressées;
couvertes de feuilles coriaces d'un vert foncé, à segments
lancéolés étroits et denticules sur les bords. Les
branches portent des bractées ovales entières,
d'un vert pâle. Les fleurs, penchées,
ont le périanthe verdâtre et plus ou moins bordé de
pourpre.
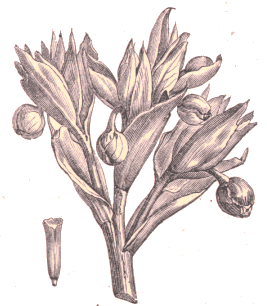
Rameau
d'Hellébore fétide.
L'Helleborus viridis
ou Herbe à sétons se reconnaît à ses
feuilles très longuement pétiolées,
à segments oblongs, lancéolés et à son périanthe
étalé, d'un vert pâle. C'est une espèce des
Alpes, du Dauphiné ,
de l'Auvergne ,
de l'Auvergne ,
de l'Alsace ,
de l'Alsace et de la Normandie
et de la Normandie . .
L'Helleborus niger
L., que l'on rencontre dans la plupart des pays de l'Europe, est une herbe
peu élevée dont les feuilles sont
longuement pétiolées et ordinairement à sept divisions.
Ses fleurs, solitaires ou au nombre de deux ou trois au sommet d'une hampe
nue, ont un grand calice blanc, rosé ou légèrement
teinté de vert. On la cultive très fréquemment dans
les jardins sous le nom de Rose de Noël à cause de l'époque
de sa floraison.

Rameau
d'Hellébore noire.
Quant à l'Helleborus
orientalis L., c'est une espèce assez voisine de la précédente,
mais dont les feuilles se développent en même temps que les
fleurs; celles-ci ont le calice
verdâtre et teinté d'un blanc légèrement pourpré.
On la cultive dans les jardins comme ornementale. (Ed. Lef).
L'Hellébore
dans l'histoire de la médecine.
La plus grande confusion
a longtemps régné sur la matière médicale et
la thérapeutique de cette plante, le même
nom servant à désigner les divers Helleborus (Renonculacées)
et le Veratriun Album (Colchicacées), hellébore blanc ou
faux hellébore, dont les propriétés sont très
différentes : Bouchardat et Fonssagrives ,
au XIXe siècle, sont tombés
dans cette confusion aussi bien que les médecins du temps d'Hippocrate.
Il en résulte, dans les descriptions des auteurs, les conclusions
les plus contradictoires sur lesquelles Pécholier a longuement insisté
lorsqu'il a essayé par des expériences bien précises,
faites avec des produits sûrement déterminés, de débrouiller
le mystère. Pour lui, l'hellébore n'était pas un éméto-cathartique
ni un diurétique aussi puissant qu'on l'avait dit : c'est au Veratrum
que s'appliquent ces qualifications : l'hellébore noir (H. niger)
n'est qu'un excitant de la circulation et de la respiration, mais surtout
un dangereux toxique qui peut tuer d'une façon foudroyante au bout
de quelques minutes, sans symptômes généraux bien accusés.
Aussi le rejetterait-il complètement de l'usage thérapeutique. ,
au XIXe siècle, sont tombés
dans cette confusion aussi bien que les médecins du temps d'Hippocrate.
Il en résulte, dans les descriptions des auteurs, les conclusions
les plus contradictoires sur lesquelles Pécholier a longuement insisté
lorsqu'il a essayé par des expériences bien précises,
faites avec des produits sûrement déterminés, de débrouiller
le mystère. Pour lui, l'hellébore n'était pas un éméto-cathartique
ni un diurétique aussi puissant qu'on l'avait dit : c'est au Veratrum
que s'appliquent ces qualifications : l'hellébore noir (H. niger)
n'est qu'un excitant de la circulation et de la respiration, mais surtout
un dangereux toxique qui peut tuer d'une façon foudroyante au bout
de quelques minutes, sans symptômes généraux bien accusés.
Aussi le rejetterait-il complètement de l'usage thérapeutique.
L'emploi des glucosides
découverts dans le rhizome d'hellébore, par Marmé
et par Huseman, l'helléborine et l'helléboréine,
a permis un examen plus précis des symptômes, surtout avec
l'emploi des injections hypodermiques. L'helléboréine, en
particulier, est un drastique puissant, à action locale irritante
et dangereuse; mais, injectée sous la peau
à faible dose, elle ralentit les mouvements du coeur,
pour les élever à forte dose, en même temps que la
tension artérielle augmente elle se comporte, en somme, comme la
digitaline : à dose toxique il y a de la congestion viscérale
(poumons, reins, utérus),
de la parésie, du tremblement, puis des convulsions. L'helléboréine
de l'H. viridis est, paraît-il, beaucoup plus active que celle qu'on
retire de l'H. niger. L'helléborine possède une action drastique
et irritante aussi énergique, mais elle porte son action moins sur
le coeur que sur les centres nerveux, qu'elle congestionne en provoquant
de la stupeur, de la parésie et même la narcose.
Venturini et Gasparini
ont observé avec l'helléborine et l'helléboréine
la même action anesthésiante locale que pour la cocaïne,
et les ont employées avec succès, paraît-il, à
l'insensibilisation de la conjonctive et à l'anesthésie locale
de la peau au moyen de piqûres hypodermiques superficielles. Cette
dernière application s'est révélée dangereuse.
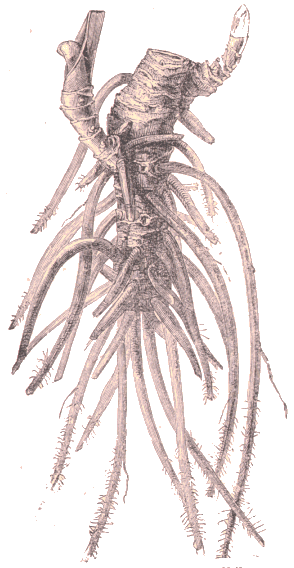
Rhizome
d'Hellébore.
Quant à l'action
jadis célèbre de l'hellébore sur la folie, elle est,
point n'est besoin de le dire, absolument controuvée, bien que Pinel
ait encore cru devoir conserver quelque respect pour la tradition hippocratique
: il suffit d'ailleurs de lire la description de Pécholier sur l'helléborisme
et ses pratiques, pour voir de quel bizarre ensemble de médication
faisait partie l'hellébore, quand on traitait les malades mentaux;
d'ailleurs, ce n'était pas seulement la folie, mais toutes les maladies
incurables que les médecins de l'Antiquité soumettaient à l'hellébore, y compris la fièvre quarte,
la gravelle, l'épilepsie, voire les luxations invétérées
et les fractures menacées de gangrène : le malade était
soumis à une série d'indigestions systématiques, à
des vomitifs, à des lavements, des saignées, des exercices
gymnastiques violents; l'hellébore couronnait l'ensemble et très
souvent tuait le malade, à telles enseignes qu'il était d'usage
de faire préalablement son testament : c'était une sorte
de jugement de Dieu
soumettaient à l'hellébore, y compris la fièvre quarte,
la gravelle, l'épilepsie, voire les luxations invétérées
et les fractures menacées de gangrène : le malade était
soumis à une série d'indigestions systématiques, à
des vomitifs, à des lavements, des saignées, des exercices
gymnastiques violents; l'hellébore couronnait l'ensemble et très
souvent tuait le malade, à telles enseignes qu'il était d'usage
de faire préalablement son testament : c'était une sorte
de jugement de Dieu appliqué à la thérapeutique, et de fait les heureux
qui sortaient vivants de cette épreuve ne devaient leur salut qu'à
l'emploi du faux hellébore, moins toxique que le vrai et confondu
toujours avec lui. Rien ne peut faire comprendre sur quoi les Anciens s'étaient
basés pour supposer que la folie était en quelque façon
justiciable de l'hellébore. Il est vrai qu'il fallait aller le cueillir
à Anticyre
appliqué à la thérapeutique, et de fait les heureux
qui sortaient vivants de cette épreuve ne devaient leur salut qu'à
l'emploi du faux hellébore, moins toxique que le vrai et confondu
toujours avec lui. Rien ne peut faire comprendre sur quoi les Anciens s'étaient
basés pour supposer que la folie était en quelque façon
justiciable de l'hellébore. Il est vrai qu'il fallait aller le cueillir
à Anticyre ,
et que le paysage y est si beau, selon la remarque de Tournefort ,
et que le paysage y est si beau, selon la remarque de Tournefort ,
que "le voyage à lui seul pouvait influencer les mélancoliques".
(Dr R. Blondel). ,
que "le voyage à lui seul pouvait influencer les mélancoliques".
(Dr R. Blondel). |
|