| . |
|
||||||
|
|
| . |
|
||||||
| La
découverte des plantes
La botanique au XIXe siècle |
Aperçu |
Les cryptogames, qui avaient été singulièrement négligés par les anciens botanistes, ont été particulièrement l'objet de recherches persévérantes au XIXe siècle. La théorie de la morphologie proprement dite a été fondée au commencement du siècle par Goethe, et l'organogénie végétale a été créée de toutes pièces par un observateur aussi ingénieux que patient, Schleiden. Le globe, parcouru dans tous les sens, sans cependant avoir été régulièrement exploré, a déjà fourni un tel nombre de nouvelles espèces qu'on ne saurait l'évaluer à la fin du XIXe siècle à moins de 90 000 (on en Comptait 10 000 au plus au temps de Linné). Nonobstant ces acquisitions nouvelles, les familles établies par Jussieu sont restées; il a suffi ou d'élargir le cadre de certaines familles ou de dédoubler les autres. Quant à la coordination des familles entre elles sous des titres plus généraux, nombre d'auteurs ont proposé des modifications à la série établie par Jussieu; Candolle, Lindley, Brongniart, Bentham et Hooker, Caruel et beaucoup d'autres (Agardh, Dumortier, Bartling, Fries, Endlicher, Meissner, etc.) ont ainsi apporté des perfectionnements à la systématique rendus nécessaires par l'accroissement prodigieux du chiffre des espèces végétales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalons |
Les
botanistes taxinomistes
A mesure que les découvertes de
plantes nouvelles sont venues augmenter le nombre des espèces Tableau général de la méthode de A.- P. de Candolle
F.-Th. Bartling dans son Ordines Plantarum
(Goettingen, 1830, in-8) pensa pouvoir
concilier les deux méthodes de Jussieu
et de Candolle en créant des familles
et des ordres nouveaux et en divisant les
Monocotylédones John Lindley
(né en 1799), admit d'abord
la méthode de Candolle, mais plus tard
(The vegetable kingdom, Londres Tableau de la méthode de Lindley
Sous le nom de Rhizogènes, Lindley
rangeait des plantes parasites sans chlorophylle Stephen Endlicher
(1804-1849),
dans un ouvrage d'une importance considérable, le Genera plantarum
secundum ordines naturales disposita (Vienne, 1836-1840),
dans lequel sont décrits 277 familles et 6895 genres,
groupa les familles en 52 classes et ces classes furent, à leur
tour, réunies en régions, sections et cohortes. Dans cette
méthode, les végétaux sont partagés en deux
grands groupes : 1° Thallophytes, 2° Cormophytes, suivant qu'ils
sont dépourvus ou pourvus d'un axe et de feuilles La plus importante des méthodes
naturelles proposées à la fin du XIXe
siècle est certainement celle qu'Adolphe
Brongniart appliqua à la plantation nouvelle de l'École
de Botanique au Muséum d'Histoire naturelle, en 1843,
et qu'il publia dans son Énumération des genres de plantes
cultivées au Muséum d'histoire naturelle de Paris (1850,
in-8). Pour Brongniart, la série des plantes est ordonnée,
elle va (en adoptant un ordre par complexité décroissante)
des I. Phanérogames |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. |
|
||||||
| Angiospermes | gamopétales | périgynes | 68. Campanulinées, 67. Astéroïdées, 66. Lonicérinées, 65. Cofféinées. | ||||
| hypogynes | anisogynes | isostémonées | 64. Asclépiadinées, 63. Convolvulinées, 62, Aspérifoliées, 61. Solaninées. | ||||
| anisostémonées | 60. Personées, 59. Sélaginoïdées, 58. Verbérinées. | ||||||
| isogynes (carpelles symétriques) | 57. Primulinées, 56. Ericoïdées, 55. Diospyroïdées. | ||||||
| Dialypétales | hypogynes;
fleur |
complète;
calice |
persistant | polystémonées | 54. Guttifères, 53. Malvoïdées. | ||
| oligostémonées
(étamines peu nombreuses) |
52. Crotoninées, 51. Polygalinées, 50. géranioïdées, 49. Térébinthinées, 48. Hespéridées, 47. Aesculinées, 46. Celastroïdées, 45. Violinées. | ||||||
| caduc; albumen | nul ou très mince | 44. Cruciférinées. | |||||
| épais, charnu ou corné | 43. Papavérinées, 42, Berbérinées, 41. Magnolinées, 40. Renonculinées. | ||||||
| double | 39. Nymphéinées. | ||||||
| incomplète; corolle 0 | 38. Pipérinées, 37. Urticinées, 36. Polygonoïdées. | ||||||
| périgynes | cyclospermées (embryon courbe) | 35. Caryophyllinées, 34. Cactoïdées. | |||||
| périspermées (embryon droit) | 33. Crassulinées, 32. Saxifraginées, 31. Passiflorinées, 30. Hamamelinées, 29. Ombellinées, 28. Santalinées, 27. Asarinées. | ||||||
| apérispermées (albumen 0) | 26. Cucurbitinées, 25. Oenothérinées, 24. Daphnoïdées, 23. Protéinées, 22. Rhamnoïdées, 21, Mystoïdées, 20. Rosinées, 19. Légumineuses, 18. Amentacées. | ||||||
| Gymnospermes | 17. Conifères, 16. Cycadoïdées. | ||||||
|
|
|||||||
| Apérispermées | 15. Fluviales, 14. Orchidoïdées. | ||||||
| Périspermées | périanthe double; albumen farineux | 13. Scitaminées, 12. Bromélioïdées. | |||||
| périanthe double ou 0; albumen sans amidon | 11. Liroïdées, 10, Phoenicoïdées, 9. pandanoïdées. | ||||||
| périanthe nul ou non pétaloïde; albumen amylacé | 8. Aroïdées, 7. Joncinées, 6. Glumacées. | ||||||
| II. | acrogènes | 5. Filicinées, 4. Muscinées. | |||||
| amphigènes | 3. Lichénées, 2. Champhignons, 1. Algues. | ||||||
| Peu de temps après
la publication de cette classification, Maurice Wilkomm (Anleitung zum
Studium der wissenchaftichen Botanik, etc.; Leipzig, 1854,
in-8), proposa dans chacune des deux grandes divisions du règne
végétal (Sporophytes = Cryptogames et Spermatophytes = Phanérogames),
des subdivisions parallèles Angiospores (Champignons A la fin du XIXe siècle, plusieurs autres méthodes luttaient pour la prépondérance dans la classification des végétaux et qui, malgré de nombreux points communs d'origine ou de conséquence, présentaient néanmoins certains côtés originaux destinés à éclairer les naturalistes sur la valeur des systèmes ou sur les rapports des groupes naturels. On mentionnera tout d'abord, le magistral ouvrage de G. Bentham et J. D. Hooker (Genera Plantarum, etc., 1862-1883), monument érigé avec une patience, une sagacité et une science remarquables. Dans cette méthode offrant des analogies avec celle de Candolle, les familles sont disposées en séries, moins naturelles, semble-t-il, que les groupes correspondants de Lindley, d'Endlicher ou de Brongniart. Enfin, ce n'est pas sans une certaine hésitation que les auteurs anglais ont conservé la division des Gymnospermes de Brongniart. Tableau de la méthode de Bentham et Hooker (phanérogames). |
| Dicotylédones | Polypétales | Thalamiflores (6 cohortes, 34 familles). |
| Disciflores (4 cohortes, 22 familles). | ||
| Caliciflores (5 cohortes, 27 familles). | ||
| Gamopétales | Infères (3 cohortes, 9 familles). | |
| Hétéromères (3 cohortes, 12 familles). | ||
| Bicarpellées (3 cohortes, 24 familles). | ||
| Monochlamydées | Curvembryées (7 familles). | |
| Multiovulées aquatiques (1 famille). | ||
| Multiovulées terrestres (3 familles). | ||
| Micrembryées (4 familles). | ||
| Daphnales (4 familles). | ||
| Achlamydosporées (3 familles). | ||
| Unisexuées (9 familles). | ||
| Ordres anormaux (4 familles). | ||
| Gymnospermes | 3 familles | |
| Monocotylédones | Microspermées (3 familles). | |
| Epigynes (7 familles). | ||
| Coronariées (8 familles). | ||
| Calicinées (3 familles). | ||
| Nudiflores (5 familles). | ||
| Apocarpées (3 familles). | ||
| Glumacées (5 familles). | ||
| T. Caruel, qui s'est acquis
dans la morphologie végétale un nom justement célèbre,
a publié en 1881 (Pensieri
sulla tassinomia botanica, Rome, in-4) un essai de classification dans
lequel les végétaux sont partagés en Divisions, Classes,
Cohortes, Ordres, Familles,
Tribus, Genres, Espèces.
Rejetant le terme de Cryptogame Tableau de la méthode de Caruel |
| I. Phanerogamae | Angiospermae | Monocotylédones | Lirianthae.
Hydranthae. Centranthae. |
| Dicotylédones | Dichlamydanthae.
Monochlamydanthae Dimorphantae. |
||
| Anthospermae | Dendroicae. | ||
| Gymnospermae | Coniferae. | ||
| II. Prothallogamae | Heterosporae.
Ispoporeae. |
||
| III. Schistogamae | Puterae. | ||
| IV. Bryogamae | Muscineae. | ||
| V. Gymnogamae | Thalodeae | Tetrasporophorae.
Zoosporophorae. Conidiophorae. Schizosporophorae. |
|
| Plasmodiaeae | Plasmodiatae | ||
| Ph.
Van Tieghem à l'exemple de T. Caruel divise les Cryptogames Tableau de la méthode de Van Tieghem |
| Thallophytes | Champignons | Myxomycètes.
Oomycètes. Ustilaginées. Urédinées. Basidiomycètes. Ascomycètes |
||
| Algues | Cyanophycées.
Chlorophycées. Phéophycées. Floridées. |
|||
| Muscinées | Hépatiques | Jugermaminées.
Marchantinées. |
||
| Mousses | Sphagninées.
Bryinées. |
|||
| Cryptogames
vasculaires |
Filicinées | Fougères.
Marattiacées. Hydroptéridées. |
||
| Equisétinées | Isosporées.
Hétérosporées. |
|||
| Lycopodinées | Isosporées.
Hétérosporées. |
|||
| Phanérogames | Gymnospermes | 3 familles. | ||
| Monocotylédonnes | Graminidées.
Joncinées. Liliinées. Iridinées. |
|||
| Dicotylédones | Apétales | Superovariées.
Inferovariées. |
||
| Dialypétales | Superovariées | Polystémones.
Méristémones à carpelles clos. Méristémones à carpelles ouverts. Diplostémones. Isostémones. |
||
| Inferovariées. | ||||
| Gamopétales | Inférovariées.
Superovariées. |
|||
| On peut, par les méthodes
de Caruel et de Van Tieghem, se rendre compte
des tendances à la fin du XIXe
siècle dans l'établissement d'une
classification générale. Tandis que les caractères
des groupes supérieurs sont surtout empruntés à l'une
des fonctions importantes du végétal ou à une conséquence
inévitable morphologique ou physiologique de son mode de vie, les
caractères des groupes inférieurs sont d'ordre purement morphologique.
Enfin, la connaissance de plus en plus approfondie de la physiologie et
de la structure interne permettent de faire intervenir dans une classification
des considérations multiples qui rendent les affinités plus
étroites, les divergences plus profondes, mais qui montrent aussi
l'extrême difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité,
d'établir jamais la classification fixe, c.-à-d. véritablement
naturelle, dont, prisonniers de l'optimisme
scientiste L'évolution.
Cet arbre mérite son nom il a un tronc, des branches, des branchilles et des feuilles. Il se lit de bas en haut, même si l'échelle chronologique ne figure pas. L'arbre d'Augier illustre les relations entre les végétaux, les « rapports naturels », mais non la chronologie de leur production. Toutefois, il est permis de penser que cette chronologie est implicite. De bas en haut se succèdent diverses dichotomies et multifurcations sans connexion oblique. Le titre de l'ouvrage l'annonce fort éloquemment : cet arbre est « conforme à l'ordre que la Nature paraît avoir suivi dans le règne végétal ». Dans la droite ligne de A.-L. de Jussieu, Augier conçoit sa méthode comme une méthode naturelle de classification visant à expliquer les « rapports » entre les plantes. (Pascal Tassy, L'Arbre à remonter le temps, 1991-98).Nous ne pouvons citer ici les diverses classifications qui ont suivi et étaient inspirées par ces mêmes idées. Nous nous bornerons à indiquer celle que Haeckel, l'un des plus fervents adeptes de la théorie de l'évolution de Darwin, a proposée et qui est un essai de généalogie des êtres végétaux, depuis les formes qu'il considère comme primordiales, les Protistes, jusqu'aux plantes gamopétales, réputées les plus élevées en organisation. La généalogie des végétaux selon Haeckel. |
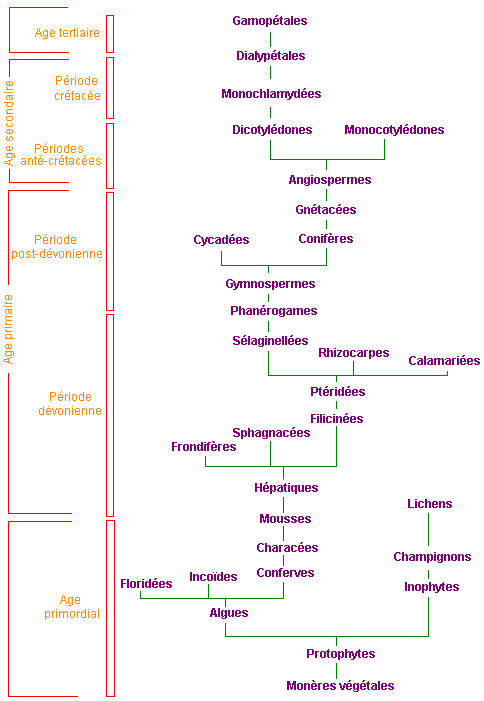
| Les
autres visages de la botanique au XIXe
siècle
Dès les premières années du XIXe siècle, les études de botanique ont pris un tel développement, les progrès de cette science ont été si nombreux et si rapides qu'il faudrait un espace bien autrement considérable que celui dont nous disposons ici pour les exposer même résumés. Nous nous bornerons maintenant à indiquer les points saillants des progrès de la botanique. En botanique descriptive, on ne s'est pas contenté de rechercher la meilleure méthode de classification, ni de décrire le plus grand nombre de plantes possible, on s'est aussi attaché à réunir en un ensemble les faits épars dans les livres et les recueils de jour en jour plus nombreux. Dès 1818, A.- P. de Candolle publia le premier volume d'un vaste recueil où toutes les plantes connues furent décrites et rangées méthodiquement par divers botanistes des plus éminents (Prodromus Regni vegetabilis, Paris et Genève, 1818 , 17 vol. in-8, continué plus tard par C. de Candolle sur le même plan). L'influence de cet ouvrage, remarquable par la simplicité de son ordre, la netteté de ses descriptions, l'agencement typographique, aura été considérable. Malheureusement, après l'apparition du premier volume, bien des plantes nouvelles ont été découvertes et décrites de telle sorte que cet ouvrage a rapidement vieilli. Pour remédier à cet inconvénient on a, par la suite, publié des révisions des espèces; citons simplement les Annales et le Répertoire de Walpers, le Nomenclator de Steudel et celui de Pfeiffer. D'autres ouvrages généraux méritent d'être cités; ce sont le Genera et l'Enchiridion d'Endlicher, collection importante et inépuisable de faits botaniques, le Règne végétal de Spach dans les Suites à Buffon, le Genera de Bentham et Hooker, l'Histoire des Plantes de Henri Baillon, ouvrage d'une haute valeur et d'une grande portée, qui place son auteur au premier rang des botanistes, le Traité élémentaire de Botanique de Le Maout et Decaisne, qui par ses nombreuses figures a rendu d'éminents services; enfin les Familles des Plantes de Engler avec la collaboration de divers botanistes allemands, etc. C'est à dessein, que nous ne parlerons pas ici des progrès accomplis au long du XIXe siècle en physiologie et organographie végétales. Outre que l'espace nous fait défaut, nous ne pourrions rester que dans des généralités parfois bien insuffisantes. Disons simplement que, dans les dernières années du siècle surtout, la botanique ayant profité des découvertes faites dans les autres sciences, zoologie, géologie, physique,. chimie, mécanique, mathématique, géographie, a singulièrement étendu son champ d'études et donné à leur résultat à la fois une précision et une généralité qui ont à jamais consacré l'importance et la fixité de cette science. (P. Maury). |
| . |
|
|
|
||||||||
|