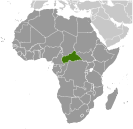7
00 N, 21 00 E
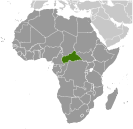 |
La Centrafrique
ou République Centrafricaine est un Etat du centre de l'Afrique ,
enclavé entre le Tchad, les deux Soudan ,
enclavé entre le Tchad, les deux Soudan (Soudan et Soudan du Sud),
les deux Congo
(Soudan et Soudan du Sud),
les deux Congo (Congo-Kinshasa (RDC) et Congo-Brazzaville)
et le Cameroun. D'une superficie de 622.984
km², le pays est peuplé de 5 millions d'habitants (2012). Capitale :
Bangui (542 000 habitants); autres villes
: Bimbo (130 000 hab.), Mbaiki (67.500), Berbérati
(62 000), Kaga Bandoro (57 000).
(Congo-Kinshasa (RDC) et Congo-Brazzaville)
et le Cameroun. D'une superficie de 622.984
km², le pays est peuplé de 5 millions d'habitants (2012). Capitale :
Bangui (542 000 habitants); autres villes
: Bimbo (130 000 hab.), Mbaiki (67.500), Berbérati
(62 000), Kaga Bandoro (57 000).
D'un point de vue administratif, la Centrafrique
est divisée en 14 préfectures, 2 préfectures économiques, et
une commune :
Les divisions
administratives de la Centrafrique
|
Commune
Bangui
Préfectures
Bamingui-Bangoran
Basse-Kotto
Haute-Kotto |
Haut-Mbomou
Kemo
Lobaye
Mambere-Kadei
Mbomou
Nana-Mambere
Ombella-Mpoko
Ouaka
Ouham |
Ouham-Pende
Vakaga
Préfectures
économiques
Nana-Grebizi
Sangha-Mbaere
|
La majeure partie
de la Centrafrique est constituée d'un plateau vallonné flanqué, au
Nord-Ouest, du massif du Bongo, et, à l'Ouest, des monts Karré. Le plateau
forme une grande séparation entre le bassin du lac Tchad, au Nord-Ouest,
et celui de la rivière Oubangi, à la frontière sud du pays.
Le climat varie de
semi-désertique dans le Nord à tropical humide dans le Sud, où l'on
a deux saisons humides annuelles, mai-juin et octobre-novembre. Les
pluies saisonnières sont si fortes qu'elles laissent pratiquement le sud-est
du pays isolé. En été, l'Harmattan, un vent très sec, chargé de poussières,
qui souffle du Sahara, produit un effet étouffant dans les villes.
Toute la zone méridionale
est recouverte d'une épaisse forêt tropicale, l'un des derniers habitats
des gorilles des plaines. La majeure partie du pays est cependant couverte
de savane et de forêt ouverte. La faune comprend : des éléphants, des
buffles, des antilopes et des hyènes, et, dans les cours d'eau, des crocodiles
et des hippopotames. Le braconnage reste malheureusement très important.
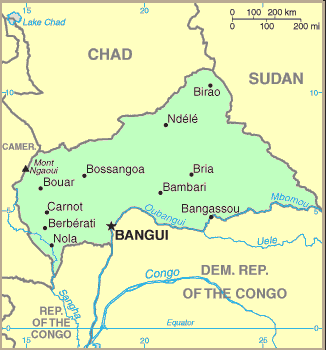
Carte
de la Centrafrique. Source : The World Factbook.
(Cliquer
sur l'image pour afficher une grande carte).
Productions
agricoles et minières.
Une très petite
portion de la superficie de la Centrafrique est cultivée, mais l'agriculture
occupe 70% de la population. Aux cultures vivrières (riz, manioc,
mil) s'ajoute une petite production destinée à l'exportation (café,
coton, arachides et palmiers à huile, principalement). La présence de
la mouche tsé-tsé empêche le développement de l'élevage sur une grande
partie du territoire.
Les ressources du
sous-sol, plus ou moins bien exploitées, sont nombreuses : or pétrole,
uranium. Les diamants constituent une part notable des exportations.
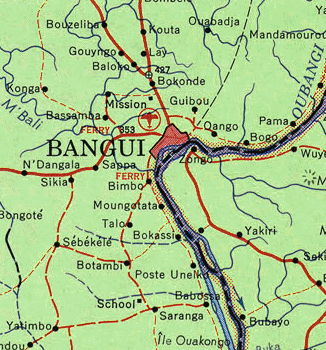
Carte
des environs de Bangui. - La capitale de la
Centrafrique
en est également son principal port. C'est
aussi
le point de convergence des routes
remontant
à l'époque coloniale.
|
|