| . |
|
||||||
|
|
| . |
|
||||||
| Histoire de l'Europe > La France > La France Capétienne > La période féodale |
|
Les communes |
| Aperçu | Origine des communes | Les chartes | Organisation | Propagation | Fin des communes |
On désigne
dans l'historie sous la nom de communes les villes qui, au Moyen
âge, avaient acquis vis-à-vis du seigneur ou du souverain
une situation d'indépendance et d'autonomie assez analogue à
celle dont jouissaient les fiefs. Cette définition un peu vague
et même un peu obscure est la seule cependant qui puisse s'appliquer
à l'ensemble des communes du Moyen
âge à cause des profondes différences d'organisation
et d'indépendance qu'elles présentaient. Ici la commune ayant
acquis une indépendance à peu près complète
et n'étant plus unie au pouvoir central que par le lien symbolique
d'un hommage féodal : c'est le cas par
exemple des communes italiennes, qui devinrent
des républiques, et des communes de
la Provence; là au contraire, la
commune n'ayant guère que les apparences de la liberté, surveillée,
protégée, dirigée par les fonctionnaires et les magistrats
royaux.
L'organisation intérieure des villes ne présente pas de différences moins profondes. Dans les unes la source de toute autorité réside dans l'assemblée générale des habitants, pratiquant en partie le gouvernement direct, acceptant ou repoussant tumultuairement les impôts, nommant ses magistrats municipaux par le suffrage universel plus ou moins organisé; dans d'autres, au contraire, le pouvoir est aux mains d'une aristocratie composée de quelques familles, de quelques lignages dont les membres occupent toutes les magistratures, toutes les charges municipales. Dans certaines villes, la commune se compose de tous les habitants, y compris les clercs et les gentilshommes; dans d'autres, elle n'est qu'une corporation, on pourrait presque dire une coterie fermée, ne comprenant qu'une minorité, mais en possession de gouverner et d'administrer la ville. Le mouvement communalLe mouvement des villes vers la liberté, commencé au XIe siècle, se prolongea jusqu'au XIIIe. Il est resté obscur et mal connu. On en connaît surtout quelques épisodes tragiques, comme la lutte des bourgeois de Laon et de leur évêque, racontée par le moine Guibert de Nogent. Il ne faudrait pas croire cependant que la révolution communale ait été partout une crise de violences; elle s'opère, dans la plupart des cas, graduellement et à l'amiable.- 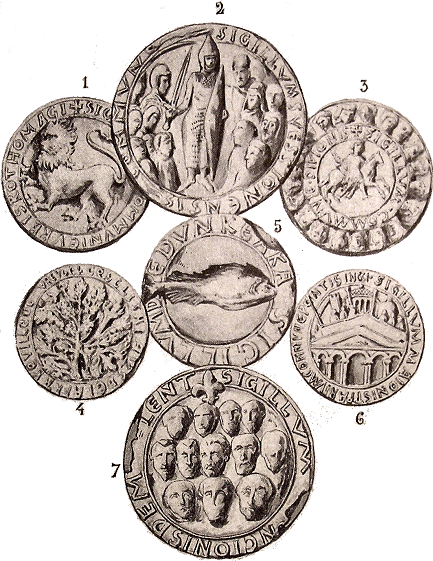
Sceaux de communes. - 1. Rouen; 2. Soissons; 3. Dijon; 4. Maubeuge; 5. Dunkerque; 6. Pontoise; 7. Meulan. Le mouvement commença dans la région méditerranéenne, en Italie et dans le midi de la France. Les villes de cette contrée furent en effet les premières à ressentir les heureux effets de la renaissance commerciale du XIe siècle; l'aristocratie marchande y fut soutenue par la petite noblesse citadine; la féodalité était moins solidement établie dans le Midi et les moeurs moins brutales; la vie vraiment urbaine n'avait jamais tout à fait disparu. Dès le XIe siècle et peut-être même dès le Xe, Arles, Nîmes, Carcassonne, obtinrent une assez large indépendance, qui devint complète peu à peu. On cite quelques épisodes dramatiques, comme l'assassinat du vicomte de Béziers par les bourgeois qu'il avait rassemblés dans une église (1167), mais de tels drames furent rares. Les chartes ou contrats qui furent dressés au XIIIe siècle entre ces villes du Midi et leurs seigneurs paraissent avoir été la consécration tardive d'un état de choses depuis longtemps établi. Montpellier avait en 1210, et Toulouse en 1226, une maison commune ou Hôtel de Ville. Les magistrats, appelés consuls ou capitouls (à Toulouse) ou jurats, et les notables qui formaient le conseil avec eux, étaient choisis dans un petit nombre de familles nobles ou bourgeoises et le peuple n'avait presque aucune part à l'élection. Il était parfois convoqué en assemblée générale, mais son rôle se bornait à approuver ce qu'avaient résolu les riches, chefs de la cité. Certaines villes appelèrent des dictateurs étrangers, nommés podestats. Dans le nord, les
ghildes ou guildes, associations de marchands, furent « le principal
ressort de la révolution communale ». Les villes qui s'émancipèrent
se trouvaient en général le long du courant commercial qui
allait de la Méditerranée Les bourgeois, déjà
habitués a se grouper par la formation des guildes et des corporations,
formaient, quand ils voulaient arracher au seigneur des concessions, une
commune jurée ou conjuration de secours mutuels, dont
tous les membres prêtaient un serment de mutuelle assistance. Ils
négociaient alors avec le seigneur et s'efforçaient d'obtenir
de lui par la persuasion ou à prix d'argent, par la menace ou enfin
par la violence, une charte, c'est-à-dire un contrat constitutionnel
qui le dépouillait d'une partie de ses droits souverains. La charte
ne se bornait pas à fixer les limites de la justice et des impôts
seigneuriaux, elle était aussi d'ordinaire un code civil et un code
criminel.
Mais les évêques, les abbés, et en général le clergé, se montrèrent violemment indignés des efforts populaires. L'archevêque de Reims, Raoul le Vert, protesta dans un sermon prononcé à Laon en 1112 contre les « exécrables communes ». « Serfs, a dit l'apôtre, soyez soumis en tout temps à vos maîtres. Et que les serfs ne donnent pas comme prétexte la violence ou la cupidité de leurs maîtres. Restez soumis, a dit l'apôtre, non seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais même à ceux qui ne le sont pas. »L'évêque Etienne de Tournai (XIIe s.) disait : « Il y a en ce monde trois troupes criardes, et même quatre, auxquelles on n'impose pas silence aisément. C'est une commune de manants qui veulent faire les seigneurs, des femmes qui se disputent, un troupeau de porcs qui grognent et des chanoines qui ne s'entendent pas. »Le pape Innocent II somma Louis VII de mettre à la raison les compagnies des bourgeois de Reims, et au siècle suivant Grégoire IX déclarait que les Rémois, révoltés de nouveau contre leur archevêque, outrepassaient la férocité des vipères. Le synode, de Paris en 1213, traita de diaboliques les associations nommées communes, que des usuriers, disant-il ont fondées dans presque toutes les villes et tous les villages de France. Vers la même époque, la cardinal Jacques de Vitry tonnait contre « ces cités de confusion », « ces communes brutales et empestées qui, non seulement accablent les nobles de leur voisinage, mais usurpent les droits de l'Eglise et détruisent par d''iniques constitutions la liberté ecclésiastique ». Le plus significatif des cris de haine poussés par l'Église contre le mouvement communal est ce passage souvent cité du moine Guibert de Nogent : « Commune! nom nouveau, nom détestable! Par elle, les censitaires sont affranchis de tout servage moyennant une simple redevance annuelle; par elle ils ne sont condamnés pour l'infraction aux lois qu'à une amende légalement déterminée; par elle ils cessent d'être soumis aux autres charges pécuniaires dont les serfs sont accablés ».Il n'aurait pu mieux dire s'il avait voulu faire l'éloge de ces communes abhorrées. La résistance du clergé ne se borna pas à des injures et à des malédictions. La plupart des scènes violentes qui ensanglantèrent le mouvement d'émancipation eurent pour théâtres les villes ecclésiastiques. Un évêque de Cambrai, exaspéré par un bourgeois qui refuse de lui livrer les noms de ceux qui ont participé à la conjuration communale, lui fait crever les yeux, arracher la langue et ordonne ensuite qu'on l'achève à coups d'épée. Mais l'amour du peuple pour l'indépendance fut presque toujours aussi actif et aussi persistant que la haine du clergé pour les institutions communales. Les rois de France et les communesL'attitude des rois de France à l'égard du mouvement communal fut assez incertaine. Louis VI ne mérita nullement le surnom de Père des communes que la légende lui a donné, il fut hostile à la commune de Laon, mais il favorisa celle d'Amiens. Louis VII écrasa les bourgeois de Sens et fit pendre des bourgeois d'Orléans qui criaient "Commune!" sur son passage, mais il soutint les habitants de Reims contre leur archevêque. Amis de l'Église, rois du clergé, les Capétiens auraient en même temps voulu s'appuyer sur les bourgeois contre les nobles. Ils vécurent au jour le jour en sacrifiant, suivant les cas et les besoins, les bourgeois aux clercs et les clercs aux bourgeois. Philippe-Auguste, le premier, eut une politique suivie et favorable à la bourgeoisie des villes : il s'appuyait sur les bourgeois, les prenait pour conseillers et leur confiait de hautes fonctions. Il jugea utile à l'autorité royale et à la sécurité du royaume de soutenir les communes existantes et d'en créer des nouvelles, surtout à la frontière de son domaine, pour en faire des places de guerre défendues par leurs milices, et dans les provinces récemment acquises ou conquises, pour s'attacher leur fidélité. Il y eut sous son règne comme un nouvel élan des ville vers la liberté, dans le Midi aussi bien que dans le Nord. Les villes de la région proprement française, jusque-là étrangères au mouvement, le suivirent. Les villes considéraient le roi comme " le seigneur naturel de toutes les communes". la royauté trouvait à jouer ce rôle un intérêt fiscal; elle demandait une forte redevance aux villes qui sollicitaient sa protection. C'était aussi un moyen de brider leur puissance.Les villes de bourgeoisieParmi les chartes que les villes obtenaient de leurs seigneurs, les unes donnaient aux bourgeois le droit de se gouverner eux-mêmes et faisaient des villes de véritables républiques indépendantes; les autres leur accordaient seulement des garanties contre l'arbitraire et fixaient le maximum des impôts, des jours de corvée, des amendes. On donne aux villes tout à fait indépendantes le nom de communes, aux autres celui de villes de bourgeoisie.Les grands barons et les rois furent naturellement hostiles à l'affranchissement intégral des villes, mais ils accordèrent volontiers, du moins dans leurs propres domaines, des chartes de demi-liberté, qui leur laissaient leurs droits souverains et la haute surveillance de la vie municipale. Ainsi le duc de Bourgogne, en 1183, donna à Dijon la charte de Soissons qui devint le prototype des chartes accordées dans le duché. Les Etablissements de Rouen, charte accordée en 1170 par Henri II à la capitale de la Normandie, servit de modèle pour les statuts communaux de presque toutes les villes situées dans les vastes domaines des Plantagenet. Dans les domaines capétiens, la plupart des chartes furent des filiales de la charte de Lorris, signée par Louis VII en 1155. Il y avait entre ces divers statuts de notables différences : les uns établissaient entre la ville et le seigneur un véritable partage de la souveraineté. Ainsi, à Rouen, le duc conservait le droit de contrôler l'administration municipale; il se réservait la haute justice, c'est-à-dire le droit de condamner à mort; la plupart des impôts levés dans la ville l'étaient à son profit; enfin il partageait avec les habitants la nomination du maire. La charte de Lorris, moins généreuse, laissait au prévôt royal la justice, la levée des impôts et le commandement de la milice; les habitants n'intervenaient pas dans la nomination du maire. Les seigneurs, pour
attirer des immigrants dans des terres mal peuplées, leur accordaient
des franchises. Beaucoup de ces localités devinrent des villes de
bourgeoisie. On les reconnaît à leurs noms de Villefranche,
Villeneuve, Sauveterre, Bourgneuf, Sauveté, Salvetat. quelques-unes
furent construites sur des plans géométriques, comme les
villes qui s'élèveront aux Temps modernes dans les pays colonisés
: Carcassonne, par exemple, fondée
au XIIIe siècle à côté
de la
Les républiques communalesLes villes pleinement affranchies devaient jouer un rôle brillant en Italie et en Allemagne. En France leur importance fut moindre et leur indépendance incomplète. Elles n'y formèrent pas de fédérations capables de lutter contre les grands seigneurs et contre le souverain lui-même, telles que la Ligue lombarde ou la Ligue hanséatique. Enfin leur liberté fut éphémère.Le gouvernement des communes ressemblait à celui des républiques antiques : en général le droit de cité ou de bourgeoisie n'était pas donné à quiconque habitait la ville. A Noyon, à Laon, à Soissons il fallait en outre y posséder une maison la bourgeoisie était refusée aux serfs, aux enfants naturels, aux gens qui avaient des dettes et d'autre part aux nobles et aux clercs habitant la ville. Ce fut par exception qu'Enguerrand de Coucy obtint le droit de cité dans la commune de Laon. En théorie,
l'assemblée générale des citoyens gouvernait la commune.
Au son d'une cloche, placée dans la
tour du beffroi, qui s'élevait au
centre de la ville, les bourgeois se réunissaient dans l'église
qui était la maison commune et procédaient à l'élection
des magistrats ou au vote d'une résolution proposée par eux.
En réalité, c'étaient les magistrats, échevins,
jurés, pairs, présidés par le maire, maïeur ou
mayeur (du latin'
major), bourgmestre, qui dirigeaient
la cité avec l'aide d'un conseil des notables. Ils rendaient la
justice, publiaient des ordonnances ayant force de loi, levaient des impôts,
géraient les finances, commandaient la milice. Ils se réunissaient
dans une salle du beffroi et plus tard dans une Maison commune ou
Hôtel de Ville. Sous leurs ordres se trouvaient des agents
rétribués : argentier, clerc de la commune ou secrétaire,
sergents ou huissiers.
Décadence des communesLes communes de France tombèrent rapidement en décadence. La royauté les prit sous sa protection, sous sa tutelle, et cette tutelle fut lourde, écrasante même. Le roi groupa autour de lui, pour combattre les seigneurs brigands, les milices communales,reçut en son Parlement les appels des sentences échevinales, écrasa les villes de taxes nouvelles et soumit leurs finances à l'examen de ses gens des comptes. Il profita des embarras financiers dus bien souvent à ses propres exigences, parfois aussi à la mauvaise gestion des maires, pour supprimer l'indépendance communale. D'autre part, la vie intérieure des communes fut troublée par de fréquentes querelles, quoiqu'elles fussent appelées institutions de paix : luttes entre la commune et les seigneuries enclavées dans la ville : églises, abbayes, châteaux; entre les familles riches et influentes, qui se disputaient la direction de la cité; et surtout entre les riches et les pauvres comme dans les républiques antiques. L'aristocratie marchande avait accaparé les charges municipales et se montrait souvent aussi fière, aussi brutale à l'égard du «commun peuple » que les nobles eux-mêmes. On l'accusait en outre de malversation et de concussion. Le « menu peuple », irrité, se souleva dans un grand nombre de communes du Nord, surtout sous Philippe le Hardi et sous Philippe le Bel. Des émeutes éclatèrent à Gand, Douai, Bruges, Ypres, Arras, Rouen, où le maire fut massacré, à Sens, à Dijon, où furent élus deux maires à la fois. La poussée démocratique fut si forte que, dans bien des villes, les riches marchands durent faire des concessions et abandonner une part du pouvoir aux élus du commun. Mais, en général, ces querelles intestines et le mauvais état des finances municipales fournirent au roi ou au grand baron l'occasion d'intervenir et de confisquer les libertés municipales. Ainsi à Beauvais, en 1233, Saint Louis imposa aux deux partis un maire désigné par lui et qui n'était pas de la ville; ce maire ayant été insulté et maltraité par la populace, le roi marcha sur Beauvais avec les milices des autres communes et emmena prisonniers 1500 bourgeois. A Gand, en 1275, le menu peuple, mécontent des sentences de échevins, demanda et obtint qu'elle pussent être révisées en appel par le comte de Flandre. A Dijon, en 1283, les marchands et la plèbe n'ayant pu se mettre d'accord pour l'élection d'un maire, le roi prit en charge le gouvernement de la ville et nomma une commission municipale. En général, ce fut « le commun » qui, en demandant la protection de l'autorité contre l'oppression des riches, provoqua l'intervention princière et la ruine de l'indépendance communale. Il était inévitable que les communes périssent victimes des progrès de la royauté. Rendue puissante par les conquêtes de Philippe-Auguste, elle tendait à substituer son autorité et ses institutions centralisées aux innombrables autorités particulières qui se partageaient le royaume autrefois. Même si le roi n'avait pas la ferme volonté de supprimer tous les obstacles, même s'il était, comme Saint Louis, respectueux des droits acquis, les agents de la royauté ne cessaient de mutiler, de rogner, de supprimer les droits souverains des seigneuries féodales. Or les communes étaient des seigneuries. Elles devaient être entraînées dans la ruine du régime féodal où elles avaient pris place. Sous Saint Louis, sous Philippe le Bel, les communes souveraines passèrent peu a peu dans la classe des villes de bourgeoisie. En 1328, à l'avènement de Philippe de Valois, il ne restait plus en France de villes libres. Celles qui s'intitulaient encore communes étaient en fait, comme les autres, devenues « les bonnes villes du roi ». Ainsi la royauté, dans l'excès de son ambition niveleuse et centralisatrice, avait anéanti l'indépendance des villes, au moment même où la bourgeoisie riche se décidait enfin à laisser au peuple ouvrier une part du gouvernement. Le Tiers ÉtatMais il ne faut pas croire que l'étouffement du mouvement communal ait empêché les progrès de la classe moyenne. Dans les villes de bourgeoisie elle garda une part d'autorité administrative. D'ailleurs, ces agents du roi, ces juges du Parlement, ces baillis, ces prévôts, qui détruisirent les communes, étaient des bourgeois. Ce fut la classe moyenne qui se dépouilla elle-même. Elle acquit et exerça au nom du roi l'autorité qu'elle perdait dans les communes. Si éphémère qu'ait été le mouvement communal, il fit surgir à côté des puissances sociales déjà établies : la noblesse et le clergé, un troisième ordre, le Tiers Etat. Quoique les communes aient été des seigneuries collectives, leur création contribua à ruiner le régime seigneurial. Enfin, en luttant contre la puissance temporelle de l'Église, les communes diminuèrent son prestige spirituel, son autorité intellectuelle et morale et affranchirent l'esprit laïque. (A. Giry / J. Bouniol et E. Nouvel). |
| . |
|
|
|
||||||||
|