 |
Baruch Spinoza
est un philosophe, né à Amsterdam
le 24 novembre 1632, mort à la Haye
le 23 février 1677. Appartenant à une famille juive d'origine
méridionale (Portugal ),
il fut élevé par les rabbins dans
l'étude de l'Ancien Testament ),
il fut élevé par les rabbins dans
l'étude de l'Ancien Testament et du Talmud
et du Talmud .
D'assez bonne heure son esprit secoua le joug de la scolastique
juive, et, pour avoir émis des doutes sur
l'authenticité des textes consacrés, il fut solennellement
excommunié de la synagogue. Il avait vingt-quatre ans, il était
initié aux idées de son temps, en particulier à la
philosophie
de Descartes ( .
D'assez bonne heure son esprit secoua le joug de la scolastique
juive, et, pour avoir émis des doutes sur
l'authenticité des textes consacrés, il fut solennellement
excommunié de la synagogue. Il avait vingt-quatre ans, il était
initié aux idées de son temps, en particulier à la
philosophie
de Descartes ( Cartésianisme),
mais
bientôt il pensa par lui-même, et imagina un système
qui lui est propre; il se retira pour méditer, d'abord aux
environs de La Haye (Rhinsburg, de 1656 à 1663 Voorburg, de 1663
à 1669), puis à La Haye, gagnant le peu qui lui suffisait
à vivre en préparant des verres pour les microscopes; il
y mourut de la tuberculose, à peine âgé
de 45 ans. Il avait refusé la chaire de philosophie de Heidelberg
pour conserver toute son indépendance. Cartésianisme),
mais
bientôt il pensa par lui-même, et imagina un système
qui lui est propre; il se retira pour méditer, d'abord aux
environs de La Haye (Rhinsburg, de 1656 à 1663 Voorburg, de 1663
à 1669), puis à La Haye, gagnant le peu qui lui suffisait
à vivre en préparant des verres pour les microscopes; il
y mourut de la tuberculose, à peine âgé
de 45 ans. Il avait refusé la chaire de philosophie de Heidelberg
pour conserver toute son indépendance.
Bouillet
décrit ainsi sa philosophie :
Il
n'admet qu'une substance unique, infinie,
Dieu;
il lui donne deux attributs essentiels, l'étendue
et la pensée; tous les êtres finis
ne sont que des parties ou des manifestations de cette seule substance
les corps n'étant que des modes
de l'étendue infinie, et les esprits des
modes de la pensée divine tout est
l'effet d'une nécessité absolue;
il n'y a de liberté ni dans l'humain, ni même dans Dieu. Spinoza
expose ce système avec tout l'appareil
géométrique, commençant par définir la substance,
la cause, termes abstraits
sur lesquels tout repose, puis avançant ses axiomes,
proposant ses postulats, et donnant enfin ses
démonstrations.
Le système de Spinoza est exposé
dans plusieurs ouvrages. Il a écrit un Court Traité de
Dieu, de l'Homme et de sa Béatitude, première esquisse
de sa « philosophie», qu'il rédigea plus tard sous forme
géométrique et à laquelle il donna le nom définitif
de morale : Ethica; ces deux ouvrages furent
communiqués en manuscrit à de rares initiés qui formèrent
autour de Spinoza un collège de disciples fidèles. Spinoza
ne publia lui-même que deux ouvrages :
1° un écrit de circonstance,
composé en quinze jours pour l'éducation d'un jeune homme
(les deux premières parties des Principes de Descartes démontrées
géométriquement) paru en 1663, par les soins de Louis Meyer,
qui fit à Spinoza une solide réputation dans le monde des
philosophes, et lui valut en 1673 l'offre d'une chaire à l'Université
de Heidelberg, qu'il déclina pour ne pas compromettre la tranquillité
de sa vie et le progrès de sa méditation solitaire;
-
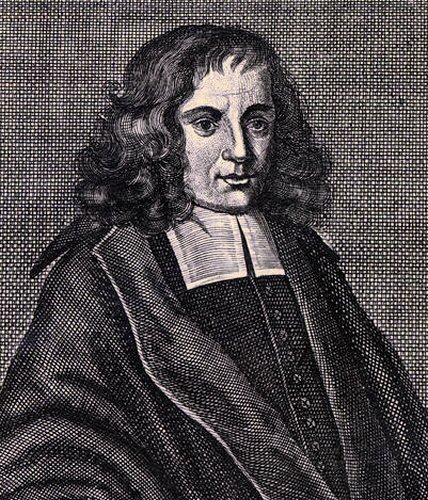
Baruch
Spinoza.
2° en 1670, le Traité de
théologie et de politique, ou il expose les principes d'un christianisme rationnel et du libéralisme politique, qui suscita dans les diverses
Églises chrétiennes des attaques de la dernière violence
et lui fit ajourner la publication de l'Éthique
rationnel et du libéralisme politique, qui suscita dans les diverses
Églises chrétiennes des attaques de la dernière violence
et lui fit ajourner la publication de l'Éthique .
Au moment de sa mort, il travaillait à une traduction hollandaise
de l'Ancien Testament, à une Grammaire de l'hébreu,
à un Traité politique, à un écrit sur
la Réforme de l'Entendement; il songeait à un ouvrage
sur le mouvement qui devait contenir une réfutation de la physique
cartésienne. Sa vie fut celle d'un philosophe : il l'a définie
lui-même dans une lettre de 1665 sur la guerre d'Angleterre : .
Au moment de sa mort, il travaillait à une traduction hollandaise
de l'Ancien Testament, à une Grammaire de l'hébreu,
à un Traité politique, à un écrit sur
la Réforme de l'Entendement; il songeait à un ouvrage
sur le mouvement qui devait contenir une réfutation de la physique
cartésienne. Sa vie fut celle d'un philosophe : il l'a définie
lui-même dans une lettre de 1665 sur la guerre d'Angleterre :
«
Si le célèbre railleur (Démocrite)
vivait de notre temps, il en mourrait de rire. Moi, pourtant, ces troubles
ne me poussent ni à rire ni à pleurer, mais à philosopher
et à mieux observer la nature humaine.
Que ceux qui le veulent meurent pour leur bien, pourvu qu'il me soit permis
de vivre pour la vérité ».
Une seule fois, on le vit se départir
de ce calme; le massacre des Witt le fit pleurer,
et il racontait plus tard à Leibniz
«
qu'il avait été porté de sortir la nuit et d'afficher
quelque part proche du lieu (des massacres) un papier où il y aurait
: ultimi barbarorum! Mais son hôte lui avait, fermé
la porte pour l'empêcher de sortir, car il se serait exposé
à être déchiré ».
Quant à l'impression produite par Spinoza
sur ses contemporains, elle est notée avec exactitude par Saint-Evremond
:
«
Il avait, dit-il à Des Maizeaux, la taille médiocre et la
physionomie agréable. Son savoir, sa modestie et son désintéressement
le faisaient estimer et rechercher de toutes les personnes d'esprit qui
se trouvaient à La Haye. Il ne paraissait point dans ses conversations
qu'il eût les sentiments qu'on a ensuite trouvés dans ses
Oeuvres posthumes. Il admettait un être distinct de la matière
qui, avait opéré les miracles par des voies naturelles, et
qui avait ordonné la Religion pour faire observer la justice et
la charité; et pour exiger l'obéissance ».
On trouvera dans les
pages qui suivent (sommaire en haut de page), un exposé la pensé
de Spinoza dû à Léon Brunschvicg (1894). Ce philosophe
était un trop excellent spécialiste de Spinoza pour que nous
nous soyions risqué à altérer en quoi que ce soit
son texte. On devra simplement remarquer qu'il a été écrit
il y a un peu plus d'un siècle, et qu'il est parfois porteur des
préjugés de son temps. En particulier, comme le remarque
très justement Guy Treister, un visiteur de ce site, ce n'est pas
parce qu'il a été excommunié par la communauté
juive, qu'il a « rejoint la pensée du Christ ». Et de
fait, Spinoza, nourri à la fois de culture juive et chrétienne,
a rejeté aussi bien les dogmes juifs que les dogmes chrétiens.
C'était d'abord un penseur qui pensait par lui-même.
-
|
Le souverain
bien. De la réforme de l'entendement
« L'expérience
m'ayant appris à reconnaître que tous les événements
ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles et que tous
les objets de nos craintes n'ont rien en soi de bon ni de mauvais et ne
prennent ce caractère qu'autant que l'âme en est touchée,
j'ai pris enfin la résolution de rechercher s'il existe un bien
véritable et capable de se communiquer aux hommes, un bien qui puisse
remplir seul l'âme tout entière, après qu'elle a rejeté
tous les autres biens, en un mot, un bien qui donne à l'âme,
quand elle le trouve et le possède, l'éternel et suprême
bonheur.
Notre bonheur et
notre malheur dépendent uniquement de la nature de l'objet que nous
aimons, car les choses qui ne nous inspirent point d'amour n'excitent ni
discordes ni douleur quand elles nous échappent, ni jalousie quand
elles sont au pouvoir d'autrui, ni crainte, ni
haine, en un mot aucune passion; au lieu que tous ces maux sont la suite
inévitable de notre attachement aux choses périssables, comme
sont celles dont nous avons parlé tout à l'heure.
Au contraire, l'amour
qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini nourrit notre
âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse, et
c'est vers ce bien si digne d'envie que doivent tendre tous nos efforts.
Mais ce n'est pas sans raison que je me suis servi de ces paroles : à
considérer les choses sérieuse-ment; car, bien que j'eusse
une idée claire de tout ce que je viens de dire, je ne pouvais cependant
bannir complèternent de mon, coeur l'amour de l'or, des plaisirs
et de la gloire.
Le bien et le mal
ne se disent que d'une façon relative, en sorte qu'un seul et même
objet peut être appelé bon ou mauvais, selon qu'on le considère
sous tel ou tel rapport ; et de même pour la perrection et l'imperfection,
Nulle chose, considérée en elle-même, ne peut être
dite parfaite ou imparfaite, et c'est ce que nous comprendrons surtout
quand nous saurons que tout ce qui ar rive, arrive selon l'ordre éternel
et les lois fixes de la nature. Mais L'humaine faiblesse ne saurait atteindre
par la pensée à cet ordre éternel; l'homme conçoit
une nature humaine de beaucoup supérieure à la sienne, où
rien, à ce qu'il lui semble, ne l'empêche de s'élever;
il recherche tous les moyens qui peuvent le conduire à cette perfection
nouvelle; tout ce qui lui semble un moyen d'y parvenir, il l'appelle le
vrai bien; et ce qui serait le souverain bien, ce serait d'entrer en possession,
avec d'autres êtres, s'il était possible, de cette nature
supérieure.
Or, quelle est cette
nature? nous montrerons, quand il en sera temps, que ce qui la constitue,
c'est la connaissance de l'union de l'âme humaine avec la nature
tout entière.
Voilà donc
la fin à laquelle je dois tendre : acquérir cette nature
humaine supérieure, et faire tous mes efforts pour que beaucoup
d'autres l'acquièrent avec moi; en d'autres termes, il importe à
mon bonheur que beaucoup d'autres s'élèvent aux mêmes
pensées que moi, afin que leur entendement et leurs désirs
soient en accord avec les miens; pour cela, il suffit de deux choses, d'abord
de comprendre la nature universelle autant qu'il est nécessaire
pour acquérir cette nature humaine supérieure; ensuite d'établir
une société telle que le plus grand nombre puisse parvenir
facilement et sûrement à ce degré de perfection. On
devra veiller avec soin aux doctrines morales ainsi qu'à l'éducation
des enfants; et comme la médecine n'est pas un moyen de peu d'importance
pour atteindre la fin que nous nous proposons, il faudra mettre l'ordre
et l'harmonie dans toutes les parties de la médecine. Et comme l'art
rend faciles bien des choses difficiles et nous profite en épargnant
notre temps et notre peine, on se gardera de négliger la mécanique.
Mais, avant tout, il faut chercher le moyen de guérir l'entendement,
de le corriger autant qu'il est possible dès le principe, afin que,
prémuni contre l'erreur, il ait de toute chose une parfaite intelligence.
On peut déjà voir par là que je veux ramener toutes
les sciences à une seule fin, qui est de nous conduire à
cette souveraine perfection de la nature humaine dont nous avons parlé;
en sorte que tout ce qui, dans les sciences, n'est pas capable de nous
faire avancer vers notre fin doit être rejeté comme inutile;
c'est-à-dire, d'un seul mot, que toutes nos actions, toutes nos
pensées doivent être dirigées vers cette fin. »
(Spinoza.
Ethique).
|
 |
En
librairie - Baruch Spinoza, Oeuvres,
Flammarion (GF), 1993, 4 vol. : I - Traité de la réforme
de l'entendement, II - Traité théologico-politique,
III -Ethique, IV -Traité politique, lettres. - Oeuvres
complètes, Gallimard (La Pléiade), 1955. - Traité
de la réforme de l'entendement, Flammarion (GF), 2003. - Traité
politique, Le Livre de Poche, 2002. - Ethique (édition
bilingue), Le Seuil, 1999. - Sur la liberté politique, Hachette,
1996.
 Collectif,
Spinoza
et les sciences sociales, Editions Amsterdam, 2010. Collectif,
Spinoza
et les sciences sociales, Editions Amsterdam, 2010.
2354800738
 Pierre-François
Moreau, Spinoza
et le spinozisme, PUF (QSJ?), 2009. - Spinoza
fut attaqué sur tous les fronts mais ses positions marquèrent
les controverses sur la Bible, le droit
naturel et la liberté de conscience. On
retrouve sa trace dans les Lumières, l'idéalisme
allemand, le marxisme et la psychanalyse,
ce que montre cet ouvrage en faisant découvrir sa vie, son oeuvre
et son rayonnement. (couv.). Pierre-François
Moreau, Spinoza
et le spinozisme, PUF (QSJ?), 2009. - Spinoza
fut attaqué sur tous les fronts mais ses positions marquèrent
les controverses sur la Bible, le droit
naturel et la liberté de conscience. On
retrouve sa trace dans les Lumières, l'idéalisme
allemand, le marxisme et la psychanalyse,
ce que montre cet ouvrage en faisant découvrir sa vie, son oeuvre
et son rayonnement. (couv.).
 Savario
Ansadi, Spinoza
et la Renaissance, PUPS, 2007. Savario
Ansadi, Spinoza
et la Renaissance, PUPS, 2007.
 P.
Kerszberg, Spinoza
et les philosophies de la vie, Presses universitaires du Mirail,
2007. P.
Kerszberg, Spinoza
et les philosophies de la vie, Presses universitaires du Mirail,
2007.
 A.
Damasio, Spinoza
avait raison, Odile jacob, 2005. A.
Damasio, Spinoza
avait raison, Odile jacob, 2005.
 Ferdinand
Alquié, Servitude et liberté selon Spinoza, La Table
Ronde, 2003. - Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, Minuit,
2003. - Leibniz, Réfutation inédite
de Spinoza, Actes Sud, 1999. Ferdinand
Alquié, Servitude et liberté selon Spinoza, La Table
Ronde, 2003. - Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, Minuit,
2003. - Leibniz, Réfutation inédite
de Spinoza, Actes Sud, 1999.
 Chantal
Jaquet, L'unité du corps et de l'esprit chez Spinoza, PUF,
2004. - De la même, Les pensées métaphysiques de
Spinoza, Publications de la Sorbonne, 2004. Michel Henry, Le bonheur
de Spinoza, suivi de Etude sur le spinozisme, PUF, 2004. - Bertrand
Dejardin, Pouvoir et impuissance, philosophie et politique chez Spinoza,
L'Harmattan, 2003. - Antonio Damasio, Spinoza avait raison, joie et
tristesse, le cerveau des émotions, 2003. - Salomon Ofman,
Pensée et rationnel : Spinoza, L'Harmattan, 2003. - Pierre-François
Moreau, Spinoza et le spinozisme, PUF (QSJ), 2003. - François
Zourabichvili, Spinoza, une physique de la pensée, PUF, 2002.
- Du même, Le conservatisme paradoxal de Spinoza, PUF, 2002.
- Roger Scruton, Spinoza, Le Seuil, 2000. - Pierre Macherey, Introduction
à l'Éthique de Spinoza, PUF 1998-2000, 5 vol.. - Henry
Méchoulan, Amsterdam au temps de Spinoza, argent et liberté,
PUF, 2000. - Philippe Cassuto, Spinoza et les commentateurs juifs,
Publications de l'université de Provence, 2000. - Harry Austryn-Wolfson,
La
philosophie de Spinoza, Gallimard Editions, 1999. - Richard Popkin,
Histoire
du scepticisme,
d'Erasme à Spinoza,
PUF, 1995. Chantal
Jaquet, L'unité du corps et de l'esprit chez Spinoza, PUF,
2004. - De la même, Les pensées métaphysiques de
Spinoza, Publications de la Sorbonne, 2004. Michel Henry, Le bonheur
de Spinoza, suivi de Etude sur le spinozisme, PUF, 2004. - Bertrand
Dejardin, Pouvoir et impuissance, philosophie et politique chez Spinoza,
L'Harmattan, 2003. - Antonio Damasio, Spinoza avait raison, joie et
tristesse, le cerveau des émotions, 2003. - Salomon Ofman,
Pensée et rationnel : Spinoza, L'Harmattan, 2003. - Pierre-François
Moreau, Spinoza et le spinozisme, PUF (QSJ), 2003. - François
Zourabichvili, Spinoza, une physique de la pensée, PUF, 2002.
- Du même, Le conservatisme paradoxal de Spinoza, PUF, 2002.
- Roger Scruton, Spinoza, Le Seuil, 2000. - Pierre Macherey, Introduction
à l'Éthique de Spinoza, PUF 1998-2000, 5 vol.. - Henry
Méchoulan, Amsterdam au temps de Spinoza, argent et liberté,
PUF, 2000. - Philippe Cassuto, Spinoza et les commentateurs juifs,
Publications de l'université de Provence, 2000. - Harry Austryn-Wolfson,
La
philosophie de Spinoza, Gallimard Editions, 1999. - Richard Popkin,
Histoire
du scepticisme,
d'Erasme à Spinoza,
PUF, 1995.
Principaux
ouvrages - 1° une Exposition
du système de Descartes démontré géométriquement
(Renati Descartes principia philosophiæ more geométrico
demonstrata, Amst., 1663). - 2° Tractatus theologicus Amst.,
1670 (il y établit la liberté de pensée). - 3°
Opera
posthuma, Amst., 1677. Ils contiennent : Ethica, traité
de morale, où se trouve aussi exposé son système de
panthéisme; Tractatus politicus; De intellectus emendatione;
Epistolæ : ces lettres sont adressées à L. Mayer,
à Leibniz, à Fabricius,
etc.
Editions
anciennes - De nouvelles édit.
de ses oeuvres complètes ont été données par
H. E. G. Paulus (Iéna, 1802-3), et par Gfroener (Stuttgart, 1830).
E.
Saisset a donné une traduction estimée des oeuvres philosophiques,
1843 et 1861; Prat a trad. le traité de politique, 1860. La doctrine
de ce philosophe a été réfutée par un grand
nombre d'écrivains qui n'y on vu qu'un panthéisme, notamment
par Fénelon, le P. Lami,
Boulainvilliers,
Leibniz (dans un écrit inédit retrouvé en 1857 par
M. Foucher de Careil), et par Saisset (dans l'introduction de l'éd.
de 1861 de sa traduction). Un recueil des Réfutations de Spinoza
avait été publié à Bruxelles dès 1731.
Cette doctrine a été ressuscitée pour un moment par
Schelling. Amand Saintes a donné en
1844 l'Hist. de la vie et des ouvrages de Spinoza, 4 vol. in-8. |
|
|