|
|
Les
météorites
et
les météoroïdes
|
 |
|
|

Aperçu |
Des rochers de
petites dimensions, appelés météoroïdes*, circulent
dans l'espace interplanétaire. Ce sont en
général des fragments d'astéroïdes
brisés dans des proportions diverses lors de collisions, ou de comètes
en cours de désintégration. Il peut aussi s'agir, pense-t-on,
dans certains cas de fragments de la surface de la Lune,
voire de Mars, arrachés à la surface
de ces planètes lors d'impacts d'autres
météoroïdes.
Certains de ces corps rencontrent la Terre
sur leur trajet. Ceux dont les dimensions sont comprises entre un dixième
de millimètre et quelques centimètres se consument complètement
dans l'atmosphère terrestre sous
l'effet de la pression qui résulte de leur traversée à
très grande vitesse des couches d'air. D'autres, soit que leurs
dimensions sont inférieures au dixième de millimètre,
soit qu'elles sont supérieures à quelques centimètres
parviennent cependant jusqu'au sol. Ils prennent alors le nom de météorites
pour les plus gros, et de micro-météorites pour les plus
petits.
-

Météorite
provenant de la Lune et récolté dans l'Antarctique en 1981.
(Source
: NASA Johnson Space Center).
 Questions
de vocabulaire - Il convient de distinguer les météorites
(mot qui peut s'utiliser au féminin ou au masculin) des météores,
qui représentent, au sens large, les phénomènes qui
ont lieu dans l'atmosphère terrestre (aussi bien la pluie, que le
brouillard ou l'arc-en-ciel), et dans un
sens plus étroit l'effet lumineux produit par la combustion d'un
corps rocheux ou même d'une simple poussière (ou micro-météoroïde)
en provenance de l'espace. Ces-derniers peuvent prendre par ailleurs plusieurs
noms, tels que étoile filante
ou bolide selon leurs caractéristiques. Questions
de vocabulaire - Il convient de distinguer les météorites
(mot qui peut s'utiliser au féminin ou au masculin) des météores,
qui représentent, au sens large, les phénomènes qui
ont lieu dans l'atmosphère terrestre (aussi bien la pluie, que le
brouillard ou l'arc-en-ciel), et dans un
sens plus étroit l'effet lumineux produit par la combustion d'un
corps rocheux ou même d'une simple poussière (ou micro-météoroïde)
en provenance de l'espace. Ces-derniers peuvent prendre par ailleurs plusieurs
noms, tels que étoile filante
ou bolide selon leurs caractéristiques.
Historiquement,
on a donné divers noms - aérolithe, météorite,
uranolithe, etc.. - aux corps venus de l'espace extraterrestre et tombés
à la surface de notre planète. Souvent leur sens a tardé
à se fixer. Ainsi le mot aérolithe a parfois désigné
toutes les météorites. On l'a aussi utilisé pour désigner
l'ensemble du phénomène météoritique, soit
le météore plus la météorite. Aujourd'hui,
le mot désigne les seules météorites pierreuses. Il
s'oppose alors aux sidérites (météorites métalliques)
et aux sidérolithes (météorites mixtes).
Les micro-météorites
(qui sont de simples grains de poussière) atteignent le sol après
avoir subi un échauffement aux effets mineurs. Les grosses météorites,
dont la masse est couramment de quelques kilogrammes,
mais qui peuvent aussi atteindre plusieurs tonnes, ont subi en revanche
lors de leur traversée de l'atmosphère un échauffement
très intense, qui a pu les délester d'une partie importante
de leur masse initiale (phénomène d'ablation).
Ces corps, par ailleurs se brisent souvent en de très morceaux et
s'éparpillent sur de grandes surfaces. La chute
d'un seul météoroïde peut ainsi donner lieu à
des dizaines, voire des centaines de météorites, qui au final
porteront tous le même nom.
-

NWA
1669 : météorite que l'on pense provenir de Mars.
Il
a été récolté en Afrique du Nord.
(Copyright
: Bruno Fectau et Carine Bidaut).
Le nom des météorites
est traditionnellement celui de la localité où à eu
la chute. Depuis quelques décennies des collectes importantes de
météorites sont effectuées dans l'Antarctique, où
les courants de glace finissent par accumuler les météorites
dans des zones privilégiées. L'une d'elle, les Allan Hills,
est à l'origine des noms de nombreuses météorites
étiquetées avec le préfixe ALH.
-
|
Le Grand
Bombardement
Il
tombe chaque jour à la surface de la Terre plusieurs milliers de
tonnes de matière
en provenance de l'espace. Il s'agit pour l'essentiel de poussières
interplanétaires. D'autres sont plus gros. mais leur proportion
est devenue très faible si on la compare à ce qu'elle était
au début de l'histoire du Système solaire. Peu après
la formation de planètes, alors que leur surface était déjà
solidifiée, une foule considérable de météoroïdes
encombrait l'espace. Ce sont leurs impacts qui sont responsables des de
l'immense majorité des cratères
que l'on observe partout dans le Système
Solaire. Ce grand bombardement a duré plusieurs centaines de
millions d'années. Puis, faute de combattants, il s'est atténué,
puis a pratiquement cessé.
L'évolution
de ce phénomène au cours des derniers milliards d'années
a pu être retracée grâce à la datation des terrains
lunaires permise lors des expéditions Apollo, et la comparaison,
pour les terrains concernés, avec les nombre de cratères
et leur distribution en fonction de leur taille. Aujourd'hui, il est ainsi
possible de dater les terrains de nombreux corps sur cette base : en particulier,
quand une planète ou un satellite possède beaucoup de cratères,
cela signifie que sa surface est très ancienne. Lorsque les cratères
sont plus rares, c'est que le sol s'est renouvelé après la
fin du grand bombardement de météorites. Il est donc plus
jeune.
Devenus
très rares, les gros météoroïdes n'ont pas complètement
disparu. Ils continuent de représenter un certain danger. Il y a
40 000 ans (autant dire hier, à l'échelle des temps géologiques)
un cratère, large de plus d'un kilomètre et profond de 150
mètres, a été creusé en Arizona, par un rocher
de "seulement" 25 mètres de diamètre, et pesant près
de 100 000 tonnes. Pareil objet, tombant sur une ville la détruirait
complètement.
Outre
les cratères, les chutes de météorites peuvent s'accompagner
d'une fusion partielle des roches qu'elles frappent. C'est le mécanisme
qui explique la formation des tectite, ces petits objets vitreux, souvent
noirs, parfois bleutés ou jaunâtres, composés de silicates,
et qui ne peuvent être mis en rapport avec les terrains dans lesquels
on les trouve.
-
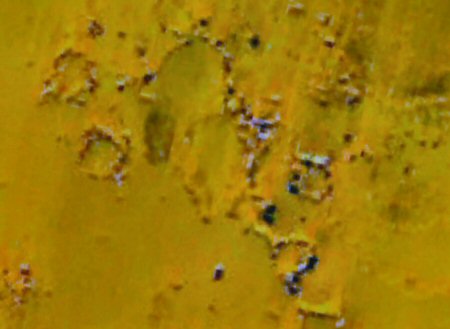
Champ
de cratères météoritiques à Gilf Kébir
au Sud-Ouest de l'Egypte.
(Image
Landsat 7).
|
|
|

Mise
en ordre |
Il existe plusieurs
façons de classer les météorites, selon ceux de leurs
aspects auxquels on s'attache. On peut les ranger par exemple en fonction
de leur composition.
Les minéraux
dans les météorites - On rencontre dans les météorites
des silicates tels que l'olivine, les pyroxènes (orthopyroxène
et clinopyroxène) et la plagioclase, mais aussi des alliages de
fer-nickel, réunis dans des proportions variables (kamacite et taénite),
et des sulfures de fer (troïlite), en petite quantité, et de
la serpentine.
La majorité des météorites
sont composées de silicates principalement, et ressemblent aux roches
terrestres. Elles peuvent alors être rangées ensemble, dans
la catégorie des "aérolithes", nouvelle définition.
Les météorites pierreuses représente 93 % des chutes.
Les autres sont soit métalliques - principalement composées
de Fer et dans une moindre mesure de Nickel - et forment la famille des
holosidérites, soit mixtes (moitié roche et moitié
métal), ou lithosidérites.
-
|
Catégorie
|
Holosidérites
|
Lithosidérites
|
Aérolithes
|
|
Composition
|
Fer et Nickel
|
Moitié Silicates
et moitié Fer/Nickel.
|
Silicates
|
Fréquence
des chutes
|
6%
|
4%
|
90%
|
|
Types
|
Hexaédrites,
Octaédrites,
Ataxites
|
Mésosidérites,
Pallasites.
|
Chondrites
Ordinaires,
Carbonées,
à
Enstatite. |
Achondrites
Eucrites,
Diogénites,
Howardites,
M.
lunaires et martiennes. |
|
Vous trouverez plus
de détails sur la page consacrée aux météorites
du site Objectif
Terre, de V. et J. Ansan,
auquel on a emprunté
le principe de ce tableau.
On rencontre plus fréquemment une
division des météorites en fonction des processus qui leur
ont donné naissance. Cela conduit à distinguer deux grandes
classes de météorites :
1) Les météorites
indifférenciées, ou chondritiques, c'est-à-dire
qui possèdent en général de petites inclusions
appelées des chondres, et qui sont toutes
rocheuses.
Les chondres
ou chondrules sont des inclusions sphéroïdales absentes
des roches terrestres, et principalement composées de silicates
en proportion très variables. Les dimensions sont typiquement de
l'ordre du millimètre (quelque chose entre 0,1 et 2 mm). On suppose
que ces corps réfractaires se sont insérées dans la
matrice qui les contient aujourd'hui lorsque celle-ci a été
portée (par un mécanisme dont la nature reste problématique)
à une température suffisante pour la faire fondre.
2) Les météorites différenciées,
qui ne contiennent pas de chondres. Ces dernières pouvant être
rocheuses (achondrites), métalliques (sidérites) ou mixtes
(sidérolithes). on range aussi dans cette catégories météorites
originaires de Mars et de la Lune. Les météorites chondritiques
représentent une matière non transformée depuis la
formation du Système solaire, les autres proviennent de corps célestes
qui ont subi une évolution géologique. C'est cette approche
que l'on va suivre maintenant. (N. B. : les exemples de météorites
sont donnés en italiques).
| Les
Chondrites* (ou Météorites indifférenciées). |
les Chondrites sont les météorites
les plus communes. Elles sont riches en olivine et constituent l'une des
deux composantes de la famille des aérolithes, définis ci-dessus.
On les fait venir de la région interne de la ceinture principale.
Ce sont des météorites pierreuses qui possèdent des
chondres. Le degré d'altération de ceux-ci est parfois utilisé
pour classer les chondrites. Les chondrites contiennent également
des métaux libres (fer et nickel), dont le degré d'oxydation
et la proportion peuvent également être utilisés comme
critères de classification. C'est à cela que correspondent
les divisions suivantes :
-
|
Chondrites
Ordinaires
|
Entre 70 et 80 % des météorites
qui atteignent la Terre appartiennent à cette catégorie.
Les chondrites ordinaires sont toutes riches en olivine, et secondairement
en bronzite (une forme de pyroxène) et en plagioclase, et contiennent
des métaux libres, moyennement oxydés, et dont les proportions
variables sont la base d'un rangement en trois groupes :
| Type H - La proportion
de fer (surtout), de nickel et de sulfure de fer (FeS ou troïlite)
peut représente entre 12 et 21 % de la masse de ces météorites,
correspondent à presque un tiers des chutes. |
| Type L - Ces météorites,
qui représentent un peu plus du tiers des chutes, contiennent entre
5 et 10% de métaux. Le pyroxène y est surtout présent
sous la forme d'hypersthène. |
| Type LL (ou amphotérites)
- Faible teneur en fer métallique (2% environ). Outre de la bronzite
et de l'olivine, ces météorites contiennent un peu d'oligoclase.
Entre 7 et 8% météorites qui tombent sur la Terre sont de
ce type. |
|
|
Chondrites
Carbonacées
|
Les Chondrites Carbonacées
ou Carbonées sont celles qui contiennent les métaux les plus
oxydés (pratiquement pas de métal libre). Même si leur
constituant le plus marquant reste la plagioclase, ces météorites
doivent leur nom à ce qu'elles renferment du carbone en proportions
notables, éventuellement sous la forme de composés organiques
tels que des acides aminés. On trouve aussi dans ces météorites
des inclusions riches en calcium et aluminium, appelées CAI
(Calcium-Aluminum-rich Inclusions), et dans lesquelles se rencontrent également
d'autres éléments réfractaires rares sur Terre comme
le titane.
On pense que les Chondrites Carbonacées
proviennent de régions externes de la ceinture principale d'astéroïdes,
et sont considérées comme des témoins très
primitifs de la nébuleuse solaire. On les rattache aux astéroïdes
de type C ou D, classes desquelles sont rapprochés également
les deux satellites de Mars, Phobos et Deimos, que l'on a parfois désignés
comme les source de ces météorites, du fait de leur relative
proximité. Les chutes de météorites de ce type ne
dépassent pas les 6%. On range ces météorites en 7
groupes :
| CI (Ivuna, Orgueil). |
| CM (Mighéï,
Murchinson). |
| CO (Ormans). |
| CV (Vigarano, Allende). |
| CK (Karounda). |
| CR (Renazzo). |
| CH (ALH 85 085). |
|
Chondrites
à
Enstatite
|
Ces météorites,
qui sont les chondrites les moins oxydées, représentent seulement
1% à 1,5 % des chutes. Elles contiennent une proportion importante
d'éléments réfractaires, et sont supposées
venir des régions internes du Système solaire, où
elle sont subit l'effet de températures dépassant les 600
°C. Elles se composent principalement de pyroxène et de plagioclase,
ainsi que de quartz et de tridymite. Leur phase silicatée est presque
entièrement représentée par de l'enstatite (MgSiO3).
Deux subdivisions sont couramment reconnues pour ces météorites
:
| EH : Haute teneur
en fer métallique (jusqu'à 1/3 de la masse). |
| EL : Faible teneur
en fer (moins de de 12%). |
|
|
Chondrites
du Groupe R
|
Les deux représentants
de ce groupe sont la météorite de Rumuruti. et celle
de Carlisle Lake. Riches en olivines, pauvres en métal. |
|
Chondrites
du Groupe B
|
Les chondrites
du groupe B correspondent à une division récente. Elle réunit
les météorites de Bencubbin, de Weatherford, ainsi
que HaH 237 et GRO95551. Riches en FeNi. |
Lodranites
ou
Acapulcoïtes
|
Les Lodranites
ou Acapulcoïtes ne correspondent en fait qu'à deux chutes connues
: la météorite d'Acapulco, et celle de Lodran. Leur
composition fait une part égale à l'olivine, au pyroxène
et aux métaux. On pense qu'elles proviennent du même corps
parent. On les classe aussi parfois parmi les sidérolithes. |
On mentionnera aussi : les brachinites (Brachina)
parfois classées avec les météorites martiennes de
type chassignites. |
|
| Les
Météorites différenciées |
Ces météorites
proviennent de corps-parents qui ont subi une certaine évolution
et peuvent être considérés comme des échantillons
provenant de diverses régions de ces corps. Certaines sont métalliques
et sont donc supposées provenir des régions les plus profondes
(noyau) de leur corps parent. D'autres sont pierreuses et doivent être
originaires de régions supérieurs (manteau, croûte).
-
Sidérites
ou
Météorites
Métalliques
|
Les Sidérites représentent
environ 5% des chutes. Elles sont essentiellement composées de fer,
sous la forme d'un alliage cristallin avec du nickel.
Ces météorites sont comprises comme les débris en
provenance de régions les plus profondes de leurs corps-parent.
On y voit parfois des analogues de ce que peut être la périphérie
du noyau terrestre. On distingue trois classes principales (Octaédrites,
Hexaédrites, Ataxites), selon leur structure cristalline, qui est
fonction de la teneur en nickel. Des subdivisions peuvent être établies
secondairement, selon la teneur en éléments tels que le gallium,
le germanium ou l'iridium.
Ajoutons qu'une proportion non négligeable de sidérites échappe
cependant à cette classification.
Les Hexahédrites
doivent leur nom à ce que leur structure héxaèdrique
(cubique) que leur confèrent leurs cristaux de kamacite. Ce sont
les sidérites les plus pauvres en nickel, et ne contiennent pas
de taénite.
Les Octahédrites,
qui renferment aussi bien de la kamacite que de la taénite se distinguent
par leur structure cristalline dominée par les octaèdres
nés de l'arrangement particulier de la kamacite et de la taénite
(structure dite de Widmanstatten, où la kamcite est entourée
de fins feuillets de taénite).
Les Ataxites - Ce
sont les sidérites les plus riches en nickel. Sans structure apparente,
elles sont presque entièrement composées de taénite.
La météorite de Hoba (Namibie), qui avec ses 55 tonnes
est la plus grosse météorite connue, appartient à
ce type.
|
Sidérolithes
ou
Météorites
Mixtes
|
Les
sidérolithes, peu nombreuses, correspondent à des météorites
où se rencontrent en proportions équivalentes des silicates
et des métaux (alliages fer-nickel). Elles donnent une idée
de ce à quoi peu ressembler, dans les tréfonds de la Terre,
la composition de la région frontière entre le noyau et le
manteau. On les divise en deux groupes principaux, auxquels on ajoute
parfois les lodranites, mentionnées sur cette page parmi les chondrites
:
| Les Mésosidérites
: ces météorites s'interprètent comme le débris
issu d'un impact d'un météoroïde métallique sur
la surface d'un astéroïde différencié. Parfois
riches en troïlite, elles sont composées principalement d'hypersthène
et de plagioclase. |
Les Pallasites :
ces belles météorites, dont le nom dérive de celui
du naturaliste Simon Pallas ,
sont principalement constituées de cristaux d'olivine pouvant atteindre
un centimètre, inclus dans une matrice de fer-nickel. On suppose
que ces météorites ont été formées à
la frontière noyau-manteau d'un astéroïde différencié. ,
sont principalement constituées de cristaux d'olivine pouvant atteindre
un centimètre, inclus dans une matrice de fer-nickel. On suppose
que ces météorites ont été formées à
la frontière noyau-manteau d'un astéroïde différencié. |
|
|
Achondrites
|
Pauvres en métal et
riches en silicates, elles forment aussi l'une des composantes de la famille
des aérolithes. Ces météorites rappellent souvent
les roches ignées connues sur Terre, et témoignent de l'existence
des processus géologiques qui ont affecté leur corps parent.
On y voit des échantillons de matériaux qui sont cristallisés
en surface ou à proximité de la surface des corps dont ils
ont pu être arrachés et projetés dans l'espace lors
d'impacts violents dus à d'autre météorites. La classification
qui est faite des Achondrites tend, de façon plus affirmée
qu'ailleurs, à regrouper ensemble les météorites supposées
de même origine.
| Les
Aubrites : parfois aussi qualifiées d'achondrites à enstatite,
ces météorites dont on ne connaît qu'une vingtaine
d'exemples se distinguent par leur pauvreté en calcium. On y voit
généralement des débris d'astéroïdes du
type E. Il a également été proposé que les
Aubrites proviennent de Mercure. |
| Le
Urélites : bien qu'elles ne soient pas classées parmi
les sidérolithes, les Urélites renferment une petite proportion
de métaux libres. Cependant elles sont principalement composées
d'olivine et d'une part non négligeable de carbone. On y décèle
également une présence importante de gaz rares. Tout cela
représente un ensemble de caractéristiques qui rend ces météorites
plutôt singulières, et explique que leur origine possible
est encore à trouver. |
Les
Météorites
de
Vesta
ou
HED
|
Les météorites
HED (initiales des noms des trois groupes Howardites, Eucrites et Diogénites
dans lesquels on les range) sont supposées - notamment à
causes de leurs caractéristiques isotopiques provenir de l'astéroïde
Vesta, lui-même aux caractéristiques inhabituelles.
Les Eucrites
sont des achondrites basaltiques, relativement riches en calcium. Elles
rappellent les laves des volcans terrestres et proviendraient de la croûte
basaltique de Vesta.
|
Les Diogénites
sont également des achondrites basaltiques, mais se distinguent
des eucrites par leur teneur plus faible en calcium et leur richesse en
hypersthène. On suppose qu'elles correspondent à du matériau
venu des profondeurs de Vesta (roches plutoniques).
|
Les Howardites
ont une composition qui en fait une sorte de mélange de la matière
des eucrites et de celle des diogénites. On y voit des échantillons
du régolithe de Vesta.
|
|
Les
Météorites
Lunaires
|
Une douzaine de météorites
supposés d'origine lunaire sont connues actuellement. Il s'agit
de brèches formées lors d'impacts violents de météorites
sur le sol de la Lune. Leur origine lunaire a été
démontrée par la comparaison avec des échantillons
retournés par les missions Apollo .
On distingue deux catégories selon
l'origine présumée :
Basaltes des
Mers : matériau sombre (lave) qui a rempli les plus grands bassins
d'impact.
Brèches des continents
: matériau clair (anorthosite), en provenance des hautes terres
lunaires.
|
Les
Météorites SNC
ou
Martiennes
|
Il y a actuellement, comme pour les météorites
d'origine lunaire présumée, une douzaine
de météorites supposées provenir de Mars.
Comment des roches se seraient-elles échappées de Mars? Comme
le montre la surface fortement cratérisée de Mars, de nombreux
impacts s'y sont produits. Des fragments projetés par de grands
impacts peuvent avoir échappé à l'attractionde la
planète, dont la pesanteur à la surface n'est que de 38 %
de celle de la Terre. Bien plus tard (typiquement quelques millions d'années),
une très petite fraction de ces fragments sont entrés en
collision avec la Terre et ont pu survivre à leur passage dans notre
atmosphère, tout comme les autres météorites.
La plupart des météorites
martiennes sont des basaltes volcaniques; la plupart d'entre eux sont également
relativement jeunes (environ 1,3 milliard d'années). Nous savons
par les détails de leur composition qu'ils ne viennent pas de la
Terre ou de la Lune. De plus, il n'y a pas eu d'activité volcanique
sur la Lune pour les former il y a à peine 1,3 milliard d'années.
Il serait très difficile pour les éjectas des impacts sur
Vénus de s'échapper à travers son épaisse atmosphère.
Par le processus d'élimination, la seule origine raisonnable semble
être Mars, où les volcans Tharsis étaient actifs à
cette époque.
L'origine martienne
de ces météorites a été confirmée par
l'analyse de minuscules bulles de gaz emprisonnées à l'intérieur
de plusieurs d'entre elles. Ces bulles correspondent aux propriétés
atmosphériques de Mars telles que mesurées pour la première
fois directement par Viking. Il semble que du gaz atmosphérique
ait été piégé dans la roche par le choc de
l'impact qui l'a éjecté de Mars et l'a lancé sur son
chemin vers la Terre.
Les météorites martiennes
sont également appelées météorites SNC, d'après
les initiales des trois principaux groupes (Shergottites, Nakhlites, Chassignites)
dans lesquels on les range :
Shergottites
Le nom provient de la météorite
de Shergotty, trouvée en Inde en 1865. Autres exemples : Zagami,
ALH77005 et EET79001. Ce sont des basaltes.
Nakhlites
Le nom provient de celui
de la météorite de Nakhla, trouvée en Égypte
en 1911. Autres exemples : Lafayette, Governador Valadares.
Chassignites
Le nom provient de celui
de la météorite de Chassigny, tombée en France
en 1815. Autre exemple : Brachina.
ALH 84001
La méteorite ALH84001
forme à elle seule une classe à part. Il s'agit d'un objet
qui s'est cristallisé il y a 4 milliards d'années semble-t-il
originaire des hautes terres martiennes. La découverte en son sein
de microstructures à l'aspect singulier a été interprété
par certains chercheurs comme les indices laissés par des micro-organismes
fossiles sur Mars. Cette hypothèse ne semble cependant plus être
retenue, à cause du chauffage trop important (600 °C) qu'aurait
subi la roche lors de sa formation.
|
|
|
|
|
|
 |
En
librairie - Françoise et Michel
Franco, Chercheurs de météorites, Le Cherche Midi,
2001; Jean-Paul Poirier, Ces pierres qui tombent du Ciel, Ed. Le
Pommier, 1999; Daniel Benest, Claude Froeschlé, Astéroïdes,
météorites et poussières interplanétaires,
Eska Editions, 1999; Alain Carion, Les météorites et leurs
impacts, Masson, 1997.
 Matthieu
Gounelle, Les
météorites, PUF (QSJ?), 2009. Matthieu
Gounelle, Les
météorites, PUF (QSJ?), 2009.
2130574289
Les
météorites sont des pierres tombées du ciel qui proviennent
de planètes, de planètes
naines, de satellites, d'astéroïdes
et de comètes. Si leur chute a marqué
toute l'histoire de la Terre, les météorites
ont un intérêt scientifique considérable et, depuis
une cinquantaine dannée, en plein renouvellement. Elles nous aident
à comprendre la formation des systèmes solaires, fournissant
ainsi un cadre astronomique indispensable à l'étude de l'apparition
de la vie. Elles permettent également de se pencher sur l'évolution
géologique des corps célestes les plus massifs. Certaines
d'entre elles les chondrites carbonées sont riches en molécules
organiques complexes que l'on retrouve dans la biosphère
et qui sont parfois qualifiés de briques du vivant. Leur apport
sur terre par les météorites aurait-il pu marquer le début
des réactions chimiques conduisant à la vie? Depuis l'ère
«-suspicieuse-»
jusqu'aux recherches les plus contemporaines, cet ouvrage retrace l'histoire
naturelle et scientifique de ces échantillons extraterrestres et
présente les enjeux de connaissance attachés à leur
étude aujourdhui. (couv.).
 Michel
Maurette, Chasseurs d'étoiles,
Hachette / La Villette, 1993. Michel
Maurette, Chasseurs d'étoiles,
Hachette / La Villette, 1993.
 Claude
Allègre, De
la pierre à l'étoile, LGF, 2007. - Pierres
tombant du ciel nommées météorites, pierres lunaires
rapportées par les astronautes depuis quinze ans déjà,
pierres prélevées dans les abysses océaniques, pierres
du Groenland ou pierres de feu des volcans
islandais, toutes les pierres ont une histoire. Cette histoire débute
avec le Big-Bang il y a 15 milliards d'années,
se cristallise avec la formation de la Terre et
du Soleil il y a 4,5 milliards d'années,
se poursuit avec l'apparition de la vie pour donner naissance à
notre planète telle que nous la connaissons aujourd'hui. Claude
Allègre nous convie ici à une nouvelle vision de l'histoire
du monde, fondée sur une discipline encore neuve, les sciences de
la Terre, dont il est l'un des meilleurs spécialistes au monde.
(couv.) Claude
Allègre, De
la pierre à l'étoile, LGF, 2007. - Pierres
tombant du ciel nommées météorites, pierres lunaires
rapportées par les astronautes depuis quinze ans déjà,
pierres prélevées dans les abysses océaniques, pierres
du Groenland ou pierres de feu des volcans
islandais, toutes les pierres ont une histoire. Cette histoire débute
avec le Big-Bang il y a 15 milliards d'années,
se cristallise avec la formation de la Terre et
du Soleil il y a 4,5 milliards d'années,
se poursuit avec l'apparition de la vie pour donner naissance à
notre planète telle que nous la connaissons aujourd'hui. Claude
Allègre nous convie ici à une nouvelle vision de l'histoire
du monde, fondée sur une discipline encore neuve, les sciences de
la Terre, dont il est l'un des meilleurs spécialistes au monde.
(couv.)
 Pour
les plus jeunes : Antonin Masson, Comètes et météorites,
Milan, 2001. Pour
les plus jeunes : Antonin Masson, Comètes et météorites,
Milan, 2001.
En
bibliothèque - Muséum
d'Histoire Naturelle, Les Météorites, Bordas, 1996.
Pour les plus jeunes : Epuisés - O. Wozniak, Yann, Une météorite
dans le rétroviseur, Dupuis (BD), 2001; Richard Beugné,
Indiana Jones Jr. et la météorite sacrée, Hachette,
(Bibliothèque verte), 1999.
 Articles
: D.W. Sears, Sketches in the history of meteoritics, in Meteoritics,
septembre 1975; Paul. M. Sears, Notes on the beginning of Modern Meteoritics,
in Meteoritics, juin 1965; Brandon Barringer, Daniel Moreau Barringer
(1860, 1929) and his Crater (The beginning of the crater branch of meteoritics),
in Meteoritics, décembre 1964. Articles
: D.W. Sears, Sketches in the history of meteoritics, in Meteoritics,
septembre 1975; Paul. M. Sears, Notes on the beginning of Modern Meteoritics,
in Meteoritics, juin 1965; Brandon Barringer, Daniel Moreau Barringer
(1860, 1929) and his Crater (The beginning of the crater branch of meteoritics),
in Meteoritics, décembre 1964.
|
|
|

