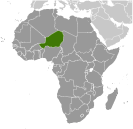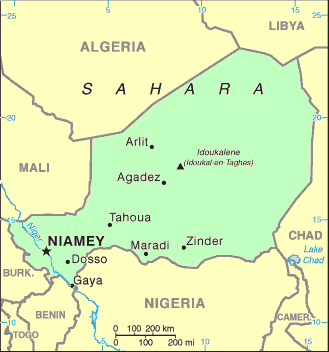16
00 N, 8 00 E
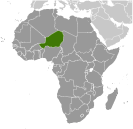 |
Le Niger
est un Etat de l'Afrique au Sud du Sahara
au Sud du Sahara central. Il enclavé entre l'Algérie
central. Il enclavé entre l'Algérie ,
la Libye ,
la Libye ,
le Tchad, le Nigeria,
le Benin, le Burkina
Faso et le Mali. Parcouru au Sud-Ouest par le
fleuve Niger, c'est un vaste plateau essentiellement
désertique
de 1,267 million de km², bordé au Sud par des savanes
et interrompu dans sa partie septentrionale par un massif montagneux, l'Aïr
ou Azbine. Capitale : Niamey (775 000 habitants; plus d'un million pour
la zone urbaine). Autre grandes villes : Zinder (191 000 hab.), Maradi
(164 000 hab.), Alaghsas (89 000). Population totale : 15,9 millions d'habitants.
Administrativement le pays est divisé en 8 régions (Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Tahoua, Tillaberi, Zinder) et un district, la communauté urbaine
de Niamey.
- ,
le Tchad, le Nigeria,
le Benin, le Burkina
Faso et le Mali. Parcouru au Sud-Ouest par le
fleuve Niger, c'est un vaste plateau essentiellement
désertique
de 1,267 million de km², bordé au Sud par des savanes
et interrompu dans sa partie septentrionale par un massif montagneux, l'Aïr
ou Azbine. Capitale : Niamey (775 000 habitants; plus d'un million pour
la zone urbaine). Autre grandes villes : Zinder (191 000 hab.), Maradi
(164 000 hab.), Alaghsas (89 000). Population totale : 15,9 millions d'habitants.
Administrativement le pays est divisé en 8 régions (Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Tahoua, Tillaberi, Zinder) et un district, la communauté urbaine
de Niamey.
-
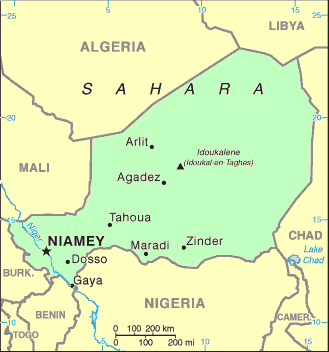
Carte
du Niger. Source : The
World Factbook.
(Cliquer
sur l'image pour afficher une grande carte).
Le Niger est l'un
des pays les plus pauvres dans le monde avec très peu de services publics
et des fonds suffisants pour développer ses ressources. Il est classé
dernier au monde sur l'indice de développement humain du Programme des
Nations Unies pour le développement. La sécheresse, la désertification,
et une forte croissance démographique ont miné son économie axée sur
les cultures de subsistance (mil, sorgho, manioc et maïs) et l'élevage.
L'agriculture contribue à environ 40% du PIB et fournit des moyens de
subsistance pour environ 80% de la population. La sécurité alimentaire
reste un problème dans le Nord du pays, aggravé par le retour des migrants
libyens depuis la chute du régime de Kadhafi.
Le pays dispose aussi
des réserves d'uranium les plus importantes au monde, mais exploitées
par la France. Il y existe également des réserves appréciables de pétrole,
et la production de pétrole, le raffinage, et on a estimé que les exportations
devraient croître de manière significative entre 2011 et 2016.
Le Niger partage
une monnaie commune, le franc CFA, et une banque centrale commune, la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique (BCEAO), avec sept autres membres de l'Union
monétaire ouest-africaine. En décembre 2000, le Niger a pu bénéficier
d'un allégement de sa dette dans le cadre du programme du FMI pour
les Pays pauvres très endettés (PPTE) et a conclu un accord avec le Fonds
pour une réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC). Des fonds
ont ainsi en principe été libérés pour les dépenses sur les soins
de santé de base, la luttre contre le Sida, l'enseignement primaire, les
infrastructures rurales, et d'autres programmes visant à réduire la pauvreté. |
|