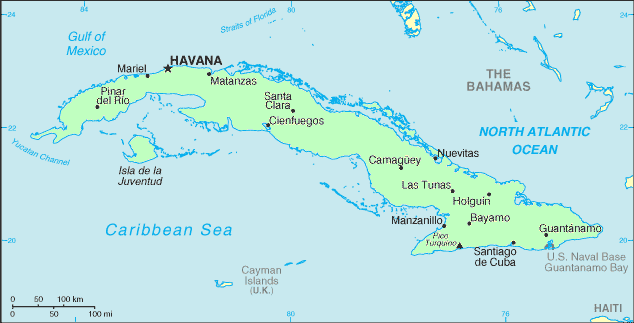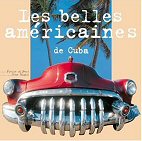21 30 N, 80 00 W | Cuba est la plus grande île des Grandes Antilles. Elle est séparée de la Floride et des Lucayes, au Nord, par le golfe du Mexique et le canal de Bahama; au Sud de la Jamaïque et d'Haïti par la mer des Antilles et le canal du Vent; à l'Ouest du Mexique et du Guatemala par le canal de Yucatan et le golfe d'Honduras. C'est une île de forme longitudinale, de1150 kilomètres de l'Est à l'Ouest et environ 170 km dans sa plus grande largeur; 11, 3 millions d'habitants; capitale : La Havane . . Cuba est formée par une chaîne de montagnes prenant naissance au cap Maysi et se divisant en plusieurs branches. Les principaux points culminants sont: le pic de Matanzas (394 m), celui de Guayabon (780 m), les Lomas de San-Juan (666 m), la Sierra de Tarquino (2800 m). Les côtes sont généralement plates et d'un accès difficile; cependant on y trouve plusieurs bons ports, parmi lesquels on cite, au Nord, celui de la Havane, un des meilleurs du monde, ainsi que ceux, au Sud, de Santiago de Cuba et de Guantanamo, abrités par des baies excellentes. Le principal cours d'eau est le Canqui, dans la partie Sud de l'île; les autres, très nombreux sont de peu d'étendue (Rio-Cauto, Rio-de-Guines, l'Ay ou Rio-dos-Negros, etc.). Le climat de Cuba est très chaud; sol excellent et d'une grande fertilité près des côtes. Canne à sucre , tabac, maïs, millet, vigne , caféier, cotonnier, cocotier, bananier, cassier, cacaotier, indigotier, arbre à pain, oranger, palmier, chêne; sapin. Vastes forêts. Les richesses minérales ont jadis été exploitées par des compagnies américaines et anglaises; mines d'argent et de cuivre, houille, carrières de marbre et de jaspe. Productions de sucre, rhum, café, cire , tabac, etc. L'embargo des Etats-Unis, ajouté à la disparition de l'Union soviétique qui, pendant les première décennies du régime castriste soutenait son économie, ont considérablement apauvri Cuba, qui aujourd'hui tente de s'ouvrir au tourisme et aux investissements étrangers. , caféier, cotonnier, cocotier, bananier, cassier, cacaotier, indigotier, arbre à pain, oranger, palmier, chêne; sapin. Vastes forêts. Les richesses minérales ont jadis été exploitées par des compagnies américaines et anglaises; mines d'argent et de cuivre, houille, carrières de marbre et de jaspe. Productions de sucre, rhum, café, cire , tabac, etc. L'embargo des Etats-Unis, ajouté à la disparition de l'Union soviétique qui, pendant les première décennies du régime castriste soutenait son économie, ont considérablement apauvri Cuba, qui aujourd'hui tente de s'ouvrir au tourisme et aux investissements étrangers.
| |