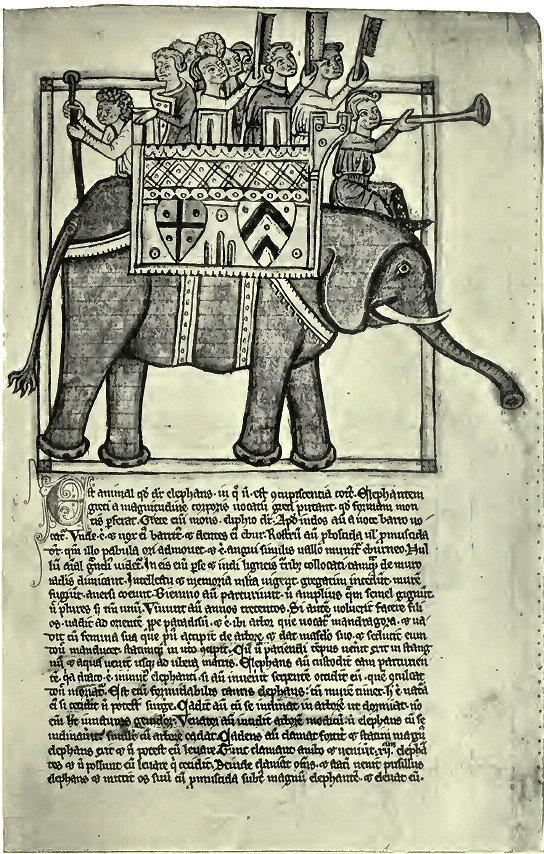|
On donne
le nom de Bestiaires à certains poèmes didactiques
composés au XIIe et au XIIIe
siècle et consacrés à la description des moeurs
des animaux, mais où les auteurs s'attachaient surtout à
développer des allégories
pouvant rappeler aux fidèles quelques supposées vérités
morales ou religieuses.
Le bestiaire n'est à vrai dire qu'une
partie du Physiologus. Sous ce dernier nom, dont le sens précis
n'est pas bien déterminé, on désignait dès
le Ve siècle de notre ère
une sorte de résumé des connaissances en histoire
naturelle les plus utiles à l'instruction religieuse. En 494,
un concile déclara apocryphe un Physiologus qui circulait
sous le nom de saint Ambroise. On a attribué
à saint Epiphane un commentaire du Physiologus qui nous est
parvenu. Au XIe siècle une rédaction
passait, sans aucun fondement, pour être de saint Jean
Chrysostome.
Le Physiologus dans ses différentes
rédactions, qui sont nombreuses, réunit la description des
pierres précieuses à celle des animaux, mais la partie consacrée
aux animaux est de beaucoup la plus considérable : elle a donné
naissance aux bestiaires et plus tard aux volucraires,
tandis que la description des pierres a produit de son côté
des ouvrages spéciaux connus sous le nom de lapidaires.
-
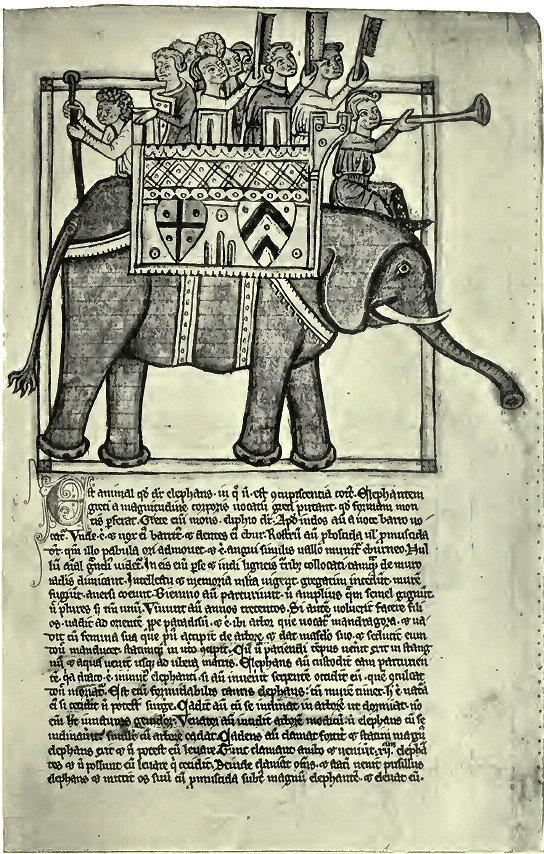
Un
éléphant représenté sur un Bestiaire.
Les bestiaires français les plus
connus sont ceux de Philippe de Thaun (ou de Than), de Guillaume, clerc
de Normandie,
et de Richard de Fournival. Nous allons les passer rapidement en revue.
Philippe
de Thaun.
Philippe de Thaun, chevalier normand établi
en Angleterre, appartenait à
la famille des seigneurs de la terre de Than, près de Caen,
qui s'est éteinte au XVe siècle.
Ses oeuvres ont pour titres : Bestiaire et Livre des Créatures,
et sont traduites du latin.
Il a dédié son ouvrage à
Aélis (Adélaïde) de Louvain, femme de Henri Ier,
roi d'Angleterre, et a dû
par conséquent le composer vers 1130. Il ne le donne lui-même
que comme une traduction de la grammaire, c.-à-d. du latin
:
Phelipes
de Thaun
En franceise raisun
Ad entrait Bestiaire,
Un livre, de grammaire.
En effet, malgré ce nom de bestiaire,
ce n'est qu'une reproduction de l'ancien Physiologus, puisqu'à
la suite des quadrupèdes et des oiseaux il y parle des pierres précieuses.
Quelques détails sur cette oeuvre, la plus ancienne que nous possédions
en français, feront comprendre comment les auteurs médiévaux
traitaient ce sujet et nous dispenseront d'insister sur les oeuvres postérieures.
A côté des animaux réels
figurent quelques animaux imaginaires, bien connus, pour la plupart, des
mythologues, notamment la licorne, la sirène,
etc. Philippe de Thaun parle d'abord de quelques animaux qui peuvent servir
d'emblème à Jésus-Christ
: le lion, le monoceros (licorne), la panthère,
etc. La partie antérieure du corps chez le
lion, qui est large et puissante, représente
la divinité du Christ; la partie postérieure, plus grêle
et plus faible, l'humanité du Christ, etc. Six animaux sont les
emblèmes du Christ, onze de l'homme, six du Diable.
Mêmes divisions en ce qui concerne les oiseaux : la perdrix représente
le diable; l'aigle, la caladre, le phénix, le pélican et
la colombe représentent le Christ, la tourterelle représente
l'Eglise, et enfin l'homme trouve son symbole dans la houppe, l'ibis, la
foulque et le nycticorax (fresaie).
-
|
La Licorne
« Monosceros
est beste,
un corn ad en la
teste,
pur çeo ad
si a nun.
de buc ele ad façun.
par pucele est prise,
or oëz en quel
guise.
quant hom le volt
cacer
et prendre et enginner,
si vent hom al forest
u sis repaires est;
la met une pucele
hors de sein sa
mamele,
e par odurement
monosceros la sent;
dunc vent a la pucele,
si baiset sa mamele,
en sun devant se
dort,
issi vent a sa mort;
li hom survent atant,
ki l'ocit en dormant,
u trestut vif le
prent,
si fait puis sun
talent,
grant chose signefie,
ne larei nel vus
die.
Monosceros griu est,
en franceis un-corn
est :
beste de tel baillie
Jhesu Crist signefie;
un deu est e serat
e fud e parmaindrat;
en la virgine se
mist,
e pur hom charn
i prist,
e pur virginited,
pur mustrer casteed,
a virgine se parut
e virgine le conceut.
virgine est e serat
e tuz jurz parmaindrat.
ores oëz brefment
le signefïement.
Ceste beste en verté
nus signefie dé;
la virgine signefie,
sacez, sancte Marie;
par sa mamele entent
sancte eglise ensement;
e puis par le baiser
çeo deit
signefïer,
que hom quant il
se dort
en semblance est
de mort :
dés cum home
dormi,
ki en cruiz mort
sufri,
ert sa drestructïun
nostre redemptïun,
e sun traveillement
nostre reposement.
si deceut dés
dïable
par semblant cuvenable;
anme e cors sunt
un,
issi fud dés
et hum,
e içeo signefie
beste de tel baillie.-»
-
(Philippe
de Thaun, Bestiaire).
|
Guillaume,
clerc de Normandie.
Le clerc normand Guillaume, qui écrivait
une centaine d'années après Philippe de Thaun son Bestiaire
divin, n'a guère fait que répéter avec plus de
développement ce qu'avait dit son prédécesseur : l'ordre
des animaux est un peu interverti, il y a quelques additions, quelques
suppressions, mais l'esprit est absolument le même.
Richard
de Fournival.
Au contraire, Richard de Fournival a voulu
rajeunir une vieille forme littéraire en y apportant un esprit tout
nouveau. Son Bestiaire d'amour, composé vers 1240, est adressé
à sa dame : il fait défiler sous ses yeux la plupart des
animaux dont les bestiaires avaient l'habitude de parler, mais ce ne sont
plus des allégories divines ou morales qu'il en tire; partout il
voit l'emblème de la femme et des choses de l'amour, et l'ensemble
de son oeuvre est un plaidoyer ingénieux pour décider sa
dame à répondre favorablement à ses voeux. Richard
de Fournival a composé son bestiaire en prose; il en a plus tard
commencé la versification, mais ne semble pas l'avoir terminée.
(A. Thomas / T.).
 |
 Collectif,
Bestiaire
du Moyen âge, Somogy, 2004. Collectif,
Bestiaire
du Moyen âge, Somogy, 2004.
En
bibliothèque - Les PP. Martin
et Cahier ont donné, dans leurs Mélanges archéologiques;
d'après un manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal à
Paris, un Bestiaire en prose picarde du commencement du XIIIe siècle.
- Hippeau, Le Bestiaire divin de Guillaume, clerc
de Normandie, Introduction, Caen, 1852, in-8°. |
|
|