 | Photographie (du grec phôs, phôtos, lumière, ou hélios, soleil, et de graphô, j'écris), art de produire et de fixer les images des objets par l'action de la lumière sur certaines substances. Dans la Daguerréotypie, l'image se forme sur une planche mince de cuivre plaqué d'argent, exposée d'abord à la vapeur d'iode et rendue plus sensible à l'aide d'une solution de brome; après sa sortie de la chambre noire, cette image est rendue apparente par les vapeurs mercurielles, et fixée par un lavage dans une solution d'hyposulfite de soude, ou plutôt de chlorure d'or, comme l'a indiqué Fizeau. L'appareil d'optique à l'aide duquel on fixe les images dans la chambre noire se nomme Daguerréotype. Les anciens alchimistes savaient que toute image produite au moyen d'une lentille sur une couche de chlorure d'argent, qu'ils appelaient argent corné, s'y fixait en noir pour les parties éclairées, en gris pour les demi-teintes, et en blanc pour les parties que ne frappait aucune lumière. C'est un fait constaté par le livre de Fabricius, De repus metallicis, 1566. Selon Jobard (Les Nouvelles inventions aux Expositions universelles, 1857, in-8°), on a trouvé au XIXe siiècle en Russie un livre, traduit de l'allemand 300 ans plus tôt, et qui contient très clairement l'explication de la photographie. Dans un livre publié en 1760 sous le titre de Giphantie, par un certain Tiphaigne de La Roche, on trouve la description de cet art, reproduisant non seulement les images, mais même les couleurs. Vers la fin du XVIIIe siècle, le physicien Charles se servait d'un papier recouvert d'un certain enduit, qu'il ne fit pas connaître pour engendrer des silhouettes à l'aide de l'action de la lumière. En 1802 , Wedgwood employa un papier enduit de chlorure ou denitrate d'argent, pour la reproduction des vitraux des églises, mais n'obtint que des images qui noircissaient presque aussitôt. Depuis 1813, Niepce, propriétaire aux environs de Châlon-sur-Saône, se livra à de nouvelles recherches; un Mémoire qu'il présenta en 1827 à la Société royale de Londres prouve qu'avant tout le monde il obtint sur métal des reproductions de gravures que n'altérait plus la lumière. En 1829, il s'associa, à Paris, avec Daguerre, qui s'occupait aussi de fixer les images de la chambre noire, et, après dix ans de recherches, le procédé qui sert encore aujourd'hui fut trouvé; on put reproduire sur plaque, non seulement les gravures, mais les monuments et les tableaux, et exécuter des portraits. Depuis 1839, tous les perfectionnements ont eu pour but d'opérer avec plus de rapidité, et de donner aux images plus de netteté et de vigueur; résultats que l'on a ohtenus par divers procédés, dus à Claudet de Lyon, Gaudin, Fizeau, Lerebours, Martens, Foucault, etc. Les images daguerriennes ont l'inconvénient de miroiter. On y a obvié, en remplaçant la plaque métallique par une plaque de verre ou par du papier convenablement préparés. C'est l'a proprement la photographie. L'image qu'on obtient est négative; les teintes y sont renversées, les ombres de l'objet étant représentées par des clairs et réciproquement. Un Anglais, Talbot, a eu l'idée de s'en servir comme d'un type pour obtenir des images positives, où les teintes sont ramenées à leur ordre naturel. Les divers procédés de la photographie sur papier ont été successivement trouvés par Bayard, Talbot, et Blanquart-Évrard, de Lille; ceux de la photographie sur verre, par Niepce de Saint-Victor, neveu du premier inventeur. Chaque jour apporte des perfectionnements à la photographie : ainsi, les frères Meyer et Pierson ont découvert le moyen de fixer les traits d'un tableau ou d'un portrait sur une toile préparée pour la peinture à l'huile, de sorte qu'un artiste n'a que le coloris à donner. E. Becquerel a trouvé une substance impressionnable qui reproduit les couleurs aussi bien que les ombres des objets, mais on n'est pas encore parvenu à les fixer. Beaucoup d'épreuves photographiques s'altèrent sous l'action prolongée des rayons lumineux; on est arrivé à en révivifier les tons, mais non encore à empêcher la décoloration dans un temps plus ou moins long. En considérant l'inimitable perfection de détails que présentent les dessins photographiques, on serait tenté de placer ces oeuvres au rang des plus belles productions des arts : mais l'art ne réside pas dans la stricte imitation de la nature; l'impression provoquée en nous par la peinture ne résulte pas de la vérité avec laquelle les objets sont reproduits sur la toile; les oeuvres des maîtres vivent, non par l'exactitude de la reproduction matérielle, mais par la pensée qu'elles expriment, par les sentiments qu'elles éveillent.
L'art n'imite pas, dans toute la rigueur du mot, il transforme; pour trauire la nature, il s'en écarte; pour copier, il invente; pour reproduire, il crée. Quand un artiste, par exemple, exécute un portrait, ce qu'il cherche, avant tout, c'est la physionomie, ce je ne sais quoi composé de mille nuances mobiles, changeantes, fuyantes, que ne donnent pas quelques secondes, qu'il ne saisit et ne devine souvent qu'après plusieurs séances où il aura fait poser son module moralement, pour ainsi dire, autant que physiquement : or, il faut une âme pour sentir et rendre cela. Et puis, au point de vue de l'effet général, il n'a garde de reproduire avec un soin minutieux tous les plis des vêtements, tous les dessins de la draperie, tous les enjolivements du fond; il éteint les détails inutiles, pour concentrer l'intérêt sur les traits du visage. La photographie n'a aucun de ces artifices salutaires qui sont l'indispensable condition de l'art; elle est inexorable et brutale dans sa vérité; elle accorde une importance égale aux grandes masses et aux plus imperceptibles accidents. Son vice principal est donc un défaut absolu de composition : elle ne compose pas, elle donne une copie, un fac-simile de la nature; or, une oeuvre d'art vit tout entière par la composition. De là résulte qu'au fond la photographie ne donne même pas de la nature une représentation aussi exacte qu'on se l'imagine. En effet, lorsque nous recevons l'impression d'un paysage, par exemple, tous les détails de la vue extérieure viennent sans doute s'imprimer au . fond de notre oeil; cependant ces mille sensations particulières ne sont aucunement perçues, et elles sont pour notre âme comme si elles n'existaient pas; nous ressentons, non pas l'impression isolée des divers aspects du paysage, mais seulement l'effet général qui résulte de leur ensemble. Or, la photographie reproduit impitoyablement les plus inutiles détails de la scène extérieure: elle donné donc une traduction inexacte des sensations qu'excite en nous l'aspect de la nature. Une autre imperfection des images photographiques, c'est que les tons de la nature y sont souvent altérés : tel ton vigoureux sur le modèle est peu sensible sur l'épreuve daguertienne; et, au contraire, une nuance lumineuse d'une faible valeur dans la nature se trouve accusée sur la plaque avec un éclat exagéré; aussi la plupart des demi-teintes sont-elles forcées, et l'épreuve est habituellement dure. Les épreuves où les rapports naturels des teintes sont conservés avec harmonie se rencontrent rarement; c'est le fait de quelques circonstances fortuites qu'il est impossible de provoquer et de reproduire à volonté. A quoi tient ce regrettable effet de la photographie? Sans doute à ce que les différentes couleurs des objets extérieurs ont une action propre et variable sur les substances chimiques qui recouvrent la plaque, action qu'il est aussi impossible de prévoir que de diriger. II est reconnu, par exemple, que les couleurs verte, jaune, lilas, etc., présentent de grandes difficultés à la reproduction photographique. Une autre remarque à faire, c'est que, si l'on reproduit par le daguerréotype des tableaux à l'huile, les copies n'ont de valeur et de vérité que lorsque les tons du modèle sont peu nombreux et trisvoisins les uns des autres : une peinture de tons uniformes et sobres donne sur la plaque une image d'une ressemblance parfaite dans les tons; mais si elle est riche de couleurs variées et papillotantes, l'épreuve photographique est d'une fausseté criante. Nous ajouterons qu'avec la photographie la perspective linéaire et la perspective aérienne sont sensiblement faussées. L'altération de la perspective linéaire est la conséquence presque inévitable de l'appareil optique qui forme les images: les objets placés à des distances inégales ont, en effet, des foyers lumineux distincts les uns des autres, et, quelle que soit la perfection de l'objectif, il est impossible qu'il fasse converger en un même point les rayons lumineux émanant d'objets fort éloignés entre eux; par exemple, dans un portrait photographique, si les mains se trouvent placées dans un plan sensiblement antérieur au la conséquence presque forcée du procédé photographique : la substance qui reçoit l'impression de la lumière étant relativement plus sensible due notre oeil même, il en résulte que les aspects lointains, les objets situés à l'extrémité de l'horizon, sont reproduits avec plus de netteté qu'ils n'en présentent à nos yeux, contrairement aux effets habituels de la perspective aérienne. Concluons que, dans son état actuel, la photographie donne des copies admirables, dont la perfection dépasse assurément tout ce que la main de l'homme exécutera jamais; et pourtant l'unique sentiment que ces calques merveilleux puissent exciter en nous est la curiosité : ils parlent aux sens, ils charment l'oeil armé de la loupe; mais l'âme reste froide. Le daguerréotype a été une conquête presque inutile pour l'étude et le perfectionnement des beaux-arts; les artistes n'en ont rien appris, rien recueilli. Du reste, l'invention d'un instrument capable d'accomplir avec perfection toutes les opérations manuelles de la peinture, d'exécuter tout ce que comporte l'imitation absolue de la réalité, aura été une démonstration sans réplique du spiritualisme de l'art: car ce n'est pas à un tel résultat que s'emploie le génie des maîtres, et la foule elle-même ne ,peut confondre leurs sublimes créations avec ces produits mécaniques. Il est, toutefois, certaines études auxquelles la photographie apporte de précieuses ressources; telle est celle de la nature morte et des monuments de l'architecture. La photographie a aussi enfanté plusieurs arts nouveaux, tels que la gravure héliographique et la litho-photographie.
 |
 Louis Mesplé, L'aventure de la photographie contemporaine, de 1945 à nos jours, Le Chêne, 2006. Louis Mesplé, L'aventure de la photographie contemporaine, de 1945 à nos jours, Le Chêne, 2006.
- 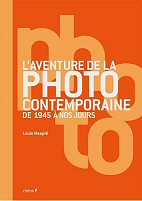 Cet ouvrage propose une rétrospective de la photographie depuis 1945. Image après image, le lecteur découvre l'évolution de ce qui est à la fois un art, un moyen de communication, le témoin d'une époque et un outil d'information. Louis Mesplé explique ainsi de façon claire et instructive les changements de la perception et de la représentation du réel à travers la photographie sur les six dernières décennies. (couv.).  Collectif, 150 ans de photojournalisme, tome 2, Könemann, 2006; déjà paru-:tome1, 2000. Collectif, 150 ans de photojournalisme, tome 2, Könemann, 2006; déjà paru-:tome1, 2000.
-
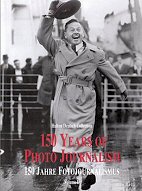 L'histoire de l'Europe, l'évolution des moeurs et des habitudes culturelles, telles que nous les révèlent la photographie de presse depuis 1850. Les deux volumes sont constitués d'un remarquable choix de photographies légendées, regroupées par thèmes: la vie dans la rue, habitat et transports, les arts, la révolution bolchévique, le cinéma, le nazisme, le nouveau rôle des femmes, etc. Le premier volume porte sur la période 1850-1918, le second sur l'époque contemporaine. (couv).  Collectif, Les plus grands photographes de Life, La Martinière Beaux livres, 2004. Collectif, Les plus grands photographes de Life, La Martinière Beaux livres, 2004.
-
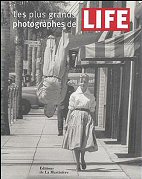 Plus de 600 images de 99 des plus grands photographes de Life. Hebdomadaire illustré américain, Life est lancé en 1936 par Henri Luce, fondateur du célèbre groupe de presse Time Incorporated. L'éditorial du premier numéro précise : « Pour voir la vie ; pour voir le monde ; être témoin des grands événements ; observer les visages des pauvres et les gestes plaisir à voir ; voir pour être étonné, voir pour construire [...] regarder et prendre plaisir à voir ; voir pour être étonné, voir pour s'instruire.» Depuis 1936 les photographes du magazine Life parcourent la planète pour rapporter des images témoignant des grands conflits historiques, photographiant l'événement dans toute sa portée héroïque, sociale et psychologique. Les portefolios des 99 des plus grands photographes que le monde n'ait jamais connu dont Alfred Eisenstaedt, Eugene Smith, Robert Capa, ou encore plus récemment Joe McNally, pour son travail sur les répercussions du 11 septembre dans le monde, sont dans la plus grande tradition du magazine. Courageux et intrépides, les photographes de Life ont participé au débarquement, poussé les portes closes, investi dans les coulisses et les couloirs du pouvoir d'où ils ont ramené les images qui font l'histoire du monde et de Life. Photographies du débarquement par Robert Capa, du Vietnam par Larry Burrow mais aussi des portraits de célébrités comme Sophia Loren, Marilyn Monroe, les Beatles ou encore Michael Jackson, ces images sont à lire comme des témoignages de l'histoire en train de se faire constituant un apport essentiel au photojournalisme. De courtes notices biographiques et les portraits des photographes font de ce livre une référence photographique indispensable. (couv.).  Hubert Henrotte, Le monde dans les yeux, Gamma-Sygma, l'âge d'or du photojournalisme, Hachette, 2005. Hubert Henrotte, Le monde dans les yeux, Gamma-Sygma, l'âge d'or du photojournalisme, Hachette, 2005.
-
 Des chars frappés de l'étoile de David arrivant au canal de Suez; Daniel Cohn-Bendit souriant sous le nez d'un CRS; les survivants de la catastrophe de la cordillère des Andes; Brigitte Bardot sur la banquise : ce sont quelques-unes des photos, célébrissimes, signées Gamma et Sygma. Ces clichés ont une histoire, intimement liée à celle du photojournalisme, dont Paris fut longtemps la capitale. Fondateur de l'agence Gamma en 1966, puis de Sygma sept ans plus tard, Hubert Henrotte a révolutionné la profession en décidant que les reporters photographes seraient enfin des journalistes à part entière. Véritable épopée, ce livre restitue l'ambiance explosive qui règne à l'âge d'or du photojournalisme dans ces deux agences mythiques où il faut toujours être "sur le coup" pour offrir au public ces images du monde prises par les photoreporters, souvent au péril de leur vie. Les plus grands du métier s'y sont côtoyés, de Gilles Caron à Raymond Depardon, en passant par Henri Bureau, Patrick Chauvel ou James Andanson. Courses folles à moto pour être le premier sur un scoop ou à Match, ruses et coups bas entre concurrents, amitiés avec le show-biz et les hommes politiques : tout est bon pour ne jamais laisser passer une "exclu". À travers de nombreuses anecdotes, amusantes ou tragiques mais toujours étonnantes, Hubert Henrotte rend hommage aux femmes et aux hommes qui furent, à ses côtés, les acteurs de cette prodigieuse aventure, jusqu'au rachat de Sygma par Bill Gates, en 1999. (couv.).  André Rouillé, La photographie, Gallimard (Folio essais), 2005. André Rouillé, La photographie, Gallimard (Folio essais), 2005.
La légitimité culturelle et artistique de la photographie est récente. Longtemps tenue pour un simple outil dont on se sert, elle est désormais, dans les galeries et musées, contemplée pour elle-même. Apparue avec l'essor des métropoles et de l'économie monétaire, l'industrialisation et la démocratie, elle fut d'abord l'image de la société marchande, la mieux à même de la documenter et d'actualiser ses valeurs. Mais si elle convenait à la société industrielle moderne, elle répond aujourd'hui difficilement aux besoins d'une société informationnelle, fondée sur les réseaux numériques. La photographie est donc l'objet du livre : dans sa pluralité et ses devenirs, du document à l'art contemporain; dans son historicité, depuis son apparition, au milieu du XIXe siècle, jusqu'à l'alliage présent «Art-photographie» qui conduit André Rouillé à distinguer « l'art des photographes » de « la photographie des artistes ». (couv.). En bibliothèque - Daguerre, Historique des procédés du daguerréotype, 1839; Ch. Chevalier, Nouvelles instructions sur l'usage du daguerréotype, 1841; Gaudin et Lerebours, Derniers perfectionnements apportés au daguerréotype, 1842; les Traités de photographie par Valicourt Legray Couppier, Legros, A. Belloc, Blanquart-Evrard; Aubrée, Traité pratique de photographie sur papier, sur plaque et sur verre, 1851; Barreswill et Davanne, Chimie photographique, 1854, in-8°; Disdéri, L'Art de la Photographie, 1862. | | |