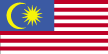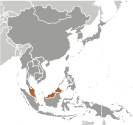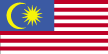
2
30 N, 112 30 E
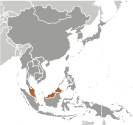 |
La Malaisie
est un Etat de l'Asie du Sud-Est, constitué par la partie méridionale
de la péninsule de Malacca, bornée au Nord par la Thaïlande ,
par Sarawak et Sabah, portion nord-ouest de l'île de Bornéo,
partagée avec l'Indonésie et où le Brunei
forme une enclave, ainsi que par quelques îles côtières dans la Mer
de Chine méridionale ou dans le détroit
de Malacca. ,
par Sarawak et Sabah, portion nord-ouest de l'île de Bornéo,
partagée avec l'Indonésie et où le Brunei
forme une enclave, ainsi que par quelques îles côtières dans la Mer
de Chine méridionale ou dans le détroit
de Malacca.
-

Kuala
Lumpur, la capitale de la Malaisie.
D'une superficie de 329,750
km² et peuplée de 25,7 millions d'habitants, la Malaisie est une monarchie
constitutionnelle indépendante du Royaume-Uni depuis 1957 et divisée administrativement en 13 Etats (negeri-negeri;
singulier : negeri) : Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan,
Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor et Terengganu,
auxquels s'ajoute un territoire fédéral (wilayah persekutuan)
, qui a trois composantes : la Ville de Kuala Lumpur, Labuan et Putrajaya.
depuis 1957 et divisée administrativement en 13 Etats (negeri-negeri;
singulier : negeri) : Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan,
Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor et Terengganu,
auxquels s'ajoute un territoire fédéral (wilayah persekutuan)
, qui a trois composantes : la Ville de Kuala Lumpur, Labuan et Putrajaya.
Kuala Lumpur est la capitale; les autres
grandes villes sont : Ipoh, Kelang, Jahor Baruh (sur le continent), George
Town (sur l'île de Penang), et Kuching (dans le Sarawak).
-

Carte
de la Malaisie. (Cliquer sur l'image
pour afficher une carte plus détaillée).
Source
: The World Factbook.
Le relief du sol.
Trois chaînons
se développent le long de la péninsule de Malacca. Seul le dernier, qui
part de la région de la Pérak, appartient à la malaisie ; cette section
envoie dans tous les sens des chaînons parallèles, jusqu'à la pointe
Romania. C'est dans cette partie de la péninsule que se trouvent les sommets
les plus élevés. Beaucoup d'entre eux dépassent 2000 m; le Mont Tahan
atteint 2190m, et dans la région centrale le Batu Puteh atteint 2130 m.
Parmi les pics isolés, le Gunong Tapis a 1512 m, la montagne d'Aphir 1173
m. Beaucoup de ces montagnes isolées sont criblées de cavernes
naturelles. La cĂ´te est partout plate.
En ce qui concerne
le Sarawak et le Sabah, c'est la chaîne maîtresse de Bornéo,
qui forme la frontière intérieure. On y remarque les monts Malo et Murud,
de plus de 2400 m, les monts Peurissan (1430 m) et Poe (1850 m) et, surtout,
au Nord-Est, dans le Sabah, les plus hauts sommets du pays, avec le Gunung
Kinabalu (4100 m), qui en est le point culminant. Les plus hauts sommets
sont comme des îles, formées de schistes cristallins
ou de granit, entourées de collines de formation carbonifère
ou tertiaire, dont les pentes douces plongent sous les couches pléistocènes
des « terres sèches » qui se continuent vers la côte par les «-terres
humides » des alluvions
actuelles. Il est ça et là des monticules de roches
éruptives récentes (basalte). La côte est presque partout plate
et sablonneuse, couverte de jungles ou de casuarinas.
Climat.
Les moussons sont
rĂ©gulières : ce sont les alizĂ©s d'avril Ă
octobre, apportent la sécheresse, et celles d'octobre à février
les tempĂŞtes et les violentes pluies. Mais il
pleut aussi dans la saison du beau temps, et mĂŞme parfois avec abondance.
La température varie de 22°C à 31°C.
Les cours d'eau.
La péninsule est
drainée par un grand nombre de cours d'eau très sinueux qui sont des
torrents pendant la mousson de Sud-Ouest, et deviennent secs pendant la
mousson
de Nord-Est. Toutes ces rivières se font remarquer
par leur parallélisme avec le littoral et les arêtes de montagnes
qui sont orientées du Nord-Ouest au Sud-Est. Dans la partie élargie de
la presqu'île, la Pérak, qui se jette sur la côte Ouest, forme, avec
ses affluents, un bassin de plus de 14,000 km². Toujours du même côté,
les rivières Bernam, Selangor, Klang, Larout, Moar, sont encore assez
considérables. Sur la côte orientale, on peut nommer le Kelantan, le
Terengganu, le Pahang, qui a un bassin aussi vaste que le PĂ©rak, le Rompin
et le Semberong. La plupart de ces cours d'eau ne sont pas navigables et
ne sont utilisés que pour l'irrigation; quelques-unes ont des estuaires
assez profonds.
Le Sarawak et le
Sabah sont bien arrosés et ses rivières sont fort nombreuses. Elles prennent
leur source dans les montagnes et se déversent à la mer souvent par plusieurs
embouchures en formant un delta avec une anastomose
de canaux naturels; elles sont navigables sur un assez long parcours, mais
sont obstruées partiellement, de barres à l'entrée. Citons : le Sarawak,
qui se jette dans la mer par les deux bras de Santubong et de Moratabas
: son cours est peu Ă©tendu, mais les grands navires peuvent y jeter l'ancre
près de Kuching; le Sadonq, navigable aussi pour les grands navires, malgré
une barre de 2,10 m à marée basse; le Lupar, avec un large estuaire :
sa longueur est de 300 km, son cours navigable de 48 km; le Rejang, le
cours d'eau le plus important de Sarawak, long de 500 km, avec un cours
navigable de 320 km; delta considérable, quatre grandes embouchures; le
Kinabatangan, enfin, principal cours d'au du Sabah, se jette dans
la mer de Sulu.
La faune et la
flore.
La faune
de la Malaisie est très riche et se rapproche beaucoup de celle de l'Indonésie.
Parmi les grands animaux, il faut citer le rhinocéros
unicorne, une espèce d'ours appelé bruang, le
buffle sauvage. Les forĂŞts sont remplies de singes,
parmi lesquels on cite trois espèces de gibbons;
parmi les lémuriens, on y trouve le koukang
(stenops), le nycticèbe et le galéopithèque.
Les oiseaux sont très nombreux : l'aigle,
le vautour, le milan, le faucon, le faisan, la
caille, la perdrix y sont assez répandus; le calao, le mina (Gracucla
religiosa), plusieurs espèces d'oiseaux de paradis sont au nombre des
plus remarquables. Les rivières sont poissonneuses; les insectes
sont extrêmement nombreux et variés.
La végétation
est riche et luxuriante. Le pays est couvert de forĂŞts
qui renferment beaucoup d'essences précieuses : l'aloès, le teck, le
caudal, le cannellier, le cocotier, l'ébène, le camphrier, les arbres
qui produisent la gutta-percha. On cultive le riz,
la canne Ă sucre, le coton, le tabac, la patate,
le poivrier, l'aréquier. On a aussi introduit la culture du café, du
cacao, de la muscade.
-

Les
tours Petronas, Ă Kuala Lumpur. Ces tours de 88 Ă©tages sont
les
plus hautes tours jumelles du monde. Elles ont été achevés
en
1998. Un pont de deux Ă©tages (au niveau des 41e et 42e Ă©tages
des
tours) relie les tours. Images : The World Factbook.
Quelques-unes
des principales villes de la Malaisie
| •
Kuala
Lumpur. - Environ 1,8 million d'habitants. Capitale politique et
économique de la Malaisie. Centre financier et commercial, siège de nombreuses
entreprises multinationales. La ville abrite Ă©galement la Bourse de Malaisie
et des zones d'affaires comme le quartier de KLCC. Fondée dans les années
1850 comme un camp minier d'Ă©tain, elle est devenue la capitale en 1957.
Centres d'intérêt : tours Petronas, grottes de Batu, Bukit Bintang, parc
KLCC.
• George Town.
- Environ 750 000 habitants. Capitale de l'État de Penang. Centre de tourisme
et de culture, George Town est Ă©galement un pĂ´le pour l'industrie de
la haute technologie, notamment dans les domaines de l'Ă©lectronique et
de la fabrication. Fondée par les Britanniques en 1786, la ville est inscrite
au patrimoine mondial de l'Unesco. Street art, maisons de clan, cuisine
de rue, musée de Peranakan.
• Malacca
(Melaka). - Environ 500 000 habitants. Ville historique, ancien port de
commerce. Ville touristique majeure avec un secteur hĂ´telier en plein
essor. Le commerce maritime a également connu un renouveau avec le développement
du port. Fondée au XVe siècle, elle a
été un important centre de commerce. A Famosa, Christ Church, Jonker
Street, musée du patrimoine.
• Johor Bahru.
- Environ 1,6 million d'habitants. Capitale de l'État de Johor. Centre
industriel important, notamment dans les secteurs de la fabrication et
de l'immobilier. Proximité avec Singapour favorise les échanges commerciaux
et le tourisme. Fondée au XIXe siècle,
elle a connu un développement rapide en raison de sa proximité avec Singapour.
Legoland, Sultan Abu Bakar State Mosque, parc Johor Zoo.
• Kota Kinabalu.
- Environ 500 000 habitants.Capitale de l'État de Sabah. Économie axée
sur le tourisme, l'agriculture et la pĂŞche. Kota Kinabalu est Ă©galement
un point de départ pour les activités de plein air, attirant de nombreux
visiteurs. Anciennement |
connue
sous le nom de Jesselton, elle a été rebaptisée après la Seconde Guerre
mondiale. Mont Kinabalu, îles Tunku Abdul Rahman, marché de nuit.
• Kuching.
- Environ 600 000 habitants. Capitale de l'État de Sarawak. Centre économique
de Sarawak, avec une économie diversifiée comprenant l'agriculture, le
commerce, et le tourisme. La ville est Ă©galement une plaque tournante
pour les entreprises de ressources naturelles. Fondée par James Brooke
en 1841, elle a une histoire riche liée à la dynastie des Rajahs blancs.
Parc national de Bako, musée du Sarawak, promenade de Kuching.
• Ipoh.
- Environ 700 000 habitants. Ancien centre de l'industrie de l'Ă©tain,
au XIXe siècle, Ipoh s'est diversifiée
vers l'agriculture et le tourisme, en mettant l'accent sur son patrimoine
culturel et historique. Grottes de Perak, temple Kek Lok Tong, musée d'Ipoh.
• Shah Alam.
- Environ 700 000 habitants. Capitale de l'État de Selangor. Centre industriel
et commercial avec une forte présence d'industries manufacturières et
de services. La ville est Ă©galement un pĂ´le pour l'Ă©ducation et la technologie.
Établie en 1963 pour remplacer Kuala Lumpur comme capitale de Selangor.
Mosquée Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, parc des lacs, centres commerciaux.
• Petaling Jaya.
- Environ 600 000 habitants. Ville satellite de Kuala Lumpur, elle est
un centre d'affaires avec de nombreux bureaux et centres commerciaux, favorisant
le commerce de détail et les services. Développée dans les années 1950
pour soutenir la croissance de Kuala Lumpur. Centre commercial Sunway Pyramid,
parc à thème Sunway Lagoon, centre d'art.
• Sungai Petani.
- Environ 300 000 habitants. Centre commercial pour la région de Kedah,
avec une économie principalement axée sur l'agriculture et le commerce
de détail. La ville joue un rôle clé dans la distribution de produits
alimentaires. A connu une croissance rapide après la Seconde Guerre mondiale
grâce à l'agriculture. Parc des oiseaux de Sungai Petani, musée de Kedah,
marchés locaux. |
---
|
|