 |
Le
relèvement d'Athènes.
Pendant que les
successeurs d'Alexandre se disputaient
en Asie des lambeaux de pourpre, la Grèce
avait essayé de recouvrer sa liberté.(
des lambeaux de pourpre, la Grèce
avait essayé de recouvrer sa liberté.( Le
Protectorat Macédonien Le
Protectorat Macédonien ).
Pendant l'absence d'Alexandre, déjà, Athènes
s'est relevée du désastre de Chéronée ).
Pendant l'absence d'Alexandre, déjà, Athènes
s'est relevée du désastre de Chéronée ,
grâce à l'administration du sage et austère Lycurgue,
adversaire, autant que Démosthène,
du parti macédonien. Il avait déjà tant fait pour
sa ville à l'avènement d'Alexandre que le jeune vainqueur
demanda sa tête après la destruction de Thèbes ,
grâce à l'administration du sage et austère Lycurgue,
adversaire, autant que Démosthène,
du parti macédonien. Il avait déjà tant fait pour
sa ville à l'avènement d'Alexandre que le jeune vainqueur
demanda sa tête après la destruction de Thèbes : c'est un autre orateur, Démade, qui l'avait sauvé. Athènes
respire donc. Le général Léosthène l'excite
aux batailles, exaspérant. Phocion, qui lui dit lui jour :
: c'est un autre orateur, Démade, qui l'avait sauvé. Athènes
respire donc. Le général Léosthène l'excite
aux batailles, exaspérant. Phocion, qui lui dit lui jour :
«
Jeune homme, tes discours ressemblent à des cyprès; ils sont
grands et hauts, mais ils ne portent point de fruits. »
Mais Léosthène l'emporte et
marche contre Antipater; il le bloque à
Lamia ,
en Thessalie ,
en Thessalie : Antipater capitule : « Ouand cesserons-nous
donc de vaincre? » s'écrie le douloureux Phocion, auquel rien
ne peut rendre confiance. En effet, Léosthène est tué.
Antipater reçoit de grands renforts d'Asie; les Grecs sont battus
à Krannon en Thessalie (322).
C'en est fait. La rançon de la défaite est terrible: une
garnison macédonienne à Munychie et l'ordre formel de rétablir
l'aristocratie à Athènes.
: Antipater capitule : « Ouand cesserons-nous
donc de vaincre? » s'écrie le douloureux Phocion, auquel rien
ne peut rendre confiance. En effet, Léosthène est tué.
Antipater reçoit de grands renforts d'Asie; les Grecs sont battus
à Krannon en Thessalie (322).
C'en est fait. La rançon de la défaite est terrible: une
garnison macédonienne à Munychie et l'ordre formel de rétablir
l'aristocratie à Athènes.
L'orateur Hypéride,
dont Antipater demande la tête, lui répond en prononçant
l'éloge funèbre des Athéniens morts dans la guerre
lamiaque. Arraché du temple d'Egine où il a fui, il est tué et jeté aux chiens. Démosthène,
bien plus encore qu'Hypéride, est désigné aux vengeances
d'Antipater; il Se réfugie à Calauria, petite île d'Argolide
où il a fui, il est tué et jeté aux chiens. Démosthène,
bien plus encore qu'Hypéride, est désigné aux vengeances
d'Antipater; il Se réfugie à Calauria, petite île d'Argolide où se dresse le temple de Poseidon
où se dresse le temple de Poseidon .
Les soudards macédoniens l'y poursuivent ; il s'empoisonne dans
le temple et tombe mort au pied de l'autel. Athènes lui dresse peu
de temps après une inscription qui la condamne, autant qu'elle atteste
la grandeur de Démosthène : .
Les soudards macédoniens l'y poursuivent ; il s'empoisonne dans
le temple et tombe mort au pied de l'autel. Athènes lui dresse peu
de temps après une inscription qui la condamne, autant qu'elle atteste
la grandeur de Démosthène :
«
Si tu avais eu autant de force que de bon sens, Ô Démosthène,
jamais I'Arès de Macédoine n'aurait triomphé de la
Grèce ! »
Phocion, inaltérable ami de la paix,
vit en bonne intelligence avec Antipater :
Athènes n'en est d'ailleurs que mieux traitée : mais, coup
de théâtre! à Antipater mort succède Polysperchon,
un vieillard, zélé démocrate.
Les aristocrates, vainqueurs la veille, courbent la tête; les exilés
rentrent (que de fois les choses se sont passées ainsi), Phocion
doit boire la ciguë (318). Victime
expiatoire des haines rétrospectives que, sans lustre, mais avec
ténacité, il avait concentrées sur sa tête,
il montra devant la mort une admirable sérénité.
Les chances reviennent aux aristocrates
et au parti macédonien. Cassandre, fils
d'Antipater, se fait contre Polysperchon l'exécuteur
des volontés de son père, triomphe et met au gouvernement
d'Athènes Démétrios
de Phalère qui tient pendant onze ans Athènes. soumise
à l'ascendant de sa parole et de sa sagesse (317-309).
-
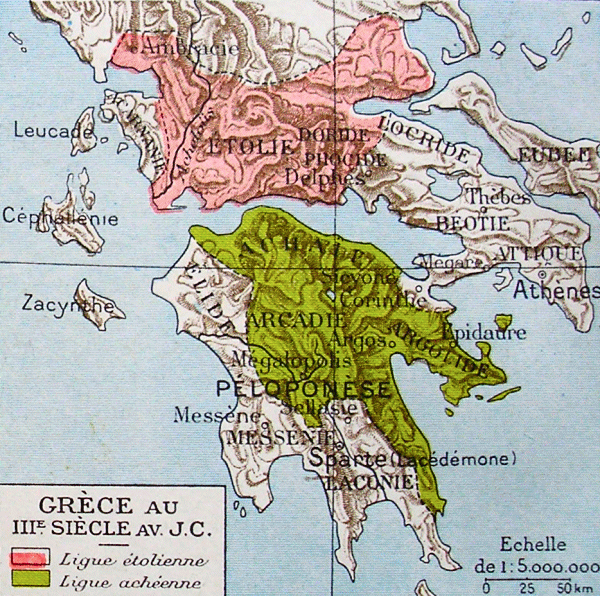
La
Grèce au IIIe
siècle av. J.-C. : la Ligue achéenne et la Ligue étolienne
Les confédérations
des cités.
Dès maintenant, des peuples, qui
ont passé jusqu'ici inaperçus, vont apparaître au premier
plan de l'histoire de la Grèce pour
jouer un rôle éphémère, mais non sans grandeur.
La
Ligue étolienne.
Ce sont Ies Etoliens,
peuple montagnard et inculte des contrées pauvres et déshéritées
qui s'étendent à l'ouest du Pinde jusqu'à la mer;
longtemps morcelés, ils ont organisé une fédération
perpétuelle ou Ligne étolienne qui remet à un pouvoir
central le soin des intérêt généraux de la nouvelle
nation. Dans l'affaiblissement où sont tombées les grandes
villes directrices de la Grèce, elle va devenir un centre de ralliement
rayonnant au loin.
La
Ligue achéenne.
Au même montent (280),
l'Achaïe ,
jusque-là restée à peu près inerte, devient
le siège d'une ligue de résistance à la Macédoine ,
jusque-là restée à peu près inerte, devient
le siège d'une ligue de résistance à la Macédoine .
Elle a aussi son gouvernement constitué, organe de liaison et d'administration
générale. .
Elle a aussi son gouvernement constitué, organe de liaison et d'administration
générale.
Ainsi, dans ces pays également arriérés
qui se font face de part et d'autre du golfe de Corinthe,
passe le même frisson de vie et de lutte, contre-coup inattendu de
l'ébranlement macédonien La Ligue achéenne voit bientôt
son domaine s'étendre grâce à l'énergie que
déploie pour elle Aratos de Sicyone ,
qui vient de délivrer sa patrie d'un tyran cruel. Très entreprenant,
il a réussi à s'attirer le concours financier de Ptolémée
d'Égypte ,
qui vient de délivrer sa patrie d'un tyran cruel. Très entreprenant,
il a réussi à s'attirer le concours financier de Ptolémée
d'Égypte .
Sicyone, puis Corinthe entrent dans la Ligue, puis l'Égypte, puis
Argos .
Sicyone, puis Corinthe entrent dans la Ligue, puis l'Égypte, puis
Argos ,
puis Mégare et mainte autre ville.
Tant de succès lui acquièrent un prestige inouï; il
semble que la Ligue ne peut vivre sans Aratos, ,
puis Mégare et mainte autre ville.
Tant de succès lui acquièrent un prestige inouï; il
semble que la Ligue ne peut vivre sans Aratos,
«
car on voit clairement qu'il n'y a ni richesses, ni amitié des rois,
ni avantages particuliers de Sicyone même, sa patrie, ni aucun autre
bien, quel qu'il soit, qu'il préfère à l'avantage
et à l'accroissement des Achéens » (Rollin).
Sparte
contre l'union des ligues.
La Ligue étolienne s'unit à
sa soeur d'Achaïe contre les Macédoniens. Mais il est dit que jusqu'au bout, dans
cette malheureuse Grèce
contre les Macédoniens. Mais il est dit que jusqu'au bout, dans
cette malheureuse Grèce ,
toute oeuvre collective de relèvement et d'indépendance verra
l'ambition d'une ville jalouse se jeter à la traverse pour l'interrompre
ou l'anéantir, Sparte est, depuis quelque
temps, le théâtre d'événements nouveaux. Décimée,
elle glissait à sa perte définitive, lorsqu'en 244 elle eut
pour roi le jeune Agis. Il résolut de faire
revivre, dans la corruption du présent, les anciennes moeurs spartiates
et de rétablir les lois de Lycurgue. Sobre lui-même et d'une
grande vertu, il avait sacrifié à cette tâche toute
sa fortune. C'était braver bien des haines; les riches propriétaires
spartiates le dénoncent comme ennemi public; on conspire tandis
qu'il est à la tête de ses troupes, et, quand il revient,
on le tue (242). Son oeuvre est reprise
par Cléomène qui, lui aussi,
veut rendre à Sparte la rigidité et l'austérité
des moeurs d'autrefois. ,
toute oeuvre collective de relèvement et d'indépendance verra
l'ambition d'une ville jalouse se jeter à la traverse pour l'interrompre
ou l'anéantir, Sparte est, depuis quelque
temps, le théâtre d'événements nouveaux. Décimée,
elle glissait à sa perte définitive, lorsqu'en 244 elle eut
pour roi le jeune Agis. Il résolut de faire
revivre, dans la corruption du présent, les anciennes moeurs spartiates
et de rétablir les lois de Lycurgue. Sobre lui-même et d'une
grande vertu, il avait sacrifié à cette tâche toute
sa fortune. C'était braver bien des haines; les riches propriétaires
spartiates le dénoncent comme ennemi public; on conspire tandis
qu'il est à la tête de ses troupes, et, quand il revient,
on le tue (242). Son oeuvre est reprise
par Cléomène qui, lui aussi,
veut rendre à Sparte la rigidité et l'austérité
des moeurs d'autrefois.
«
Quand les Grecs étrangers allaient vers Cléomène,
ils ne voyaient là ni robes de pourpre, ni meubles somptueux, ni
lits de parade, ni voitures superbes; ils ne rencontraient point une foule
d'officiers et de gardes; mais Cléomène, vêtu d'une
robe Tort simple, venait à leur rencontre, les saluait avec bonté,
les écoutait et leur parlait avec douceur aussi longtemps qu'ils
le désiraient. » (Plutarque).
Aussi sa renommée remplit la Grèce et la dépasse bientôt. Par lui, les lois de Lycurgue rentrent
en vigueur. Les moeurs militaires une fois restaurées, l'ennemi
est tout désigné par son voisinage et ses entreprises : c'est
la Ligue achéeenne.
et la dépasse bientôt. Par lui, les lois de Lycurgue rentrent
en vigueur. Les moeurs militaires une fois restaurées, l'ennemi
est tout désigné par son voisinage et ses entreprises : c'est
la Ligue achéeenne.
La désunion
des grecs.
Aratos est vaincu
d'abord; il est bon pour les ruses et les surprises, mais mauvais chef
en bataille rangée. Il fait appel à Antigone
de Macédoine .
Pendant deux ans, Cléomène tient la campagne; il est vaincu
à Sellasie, en 221. Sparte se
trouve à 15 kilomètres seulement au sud de ce champ de bataille,
où se sont engagées ses forces suprêmes. L'historien
Justin a dépeint avec une sobre éloquence
le sang-froid et la hauteur d'âme dont firent preuve les Spartiates,
en apprenant cette défaite qui tuait dans son germe tout espoir
de résurrection. Leur écrasement va se consommer sans retour
sous les coups de Philopoemen. Bien qu'Arcadien
et riche, il a l'austérité et l'endurance d'un Spartiate.
Il aime la vie rude et simple du laboureur; il préfère l'âpre
travail des champs aux exercices des écoles des gymnastique; il
lit les philosophes; à Sellasie, il s'est battu comme un lion : .
Pendant deux ans, Cléomène tient la campagne; il est vaincu
à Sellasie, en 221. Sparte se
trouve à 15 kilomètres seulement au sud de ce champ de bataille,
où se sont engagées ses forces suprêmes. L'historien
Justin a dépeint avec une sobre éloquence
le sang-froid et la hauteur d'âme dont firent preuve les Spartiates,
en apprenant cette défaite qui tuait dans son germe tout espoir
de résurrection. Leur écrasement va se consommer sans retour
sous les coups de Philopoemen. Bien qu'Arcadien
et riche, il a l'austérité et l'endurance d'un Spartiate.
Il aime la vie rude et simple du laboureur; il préfère l'âpre
travail des champs aux exercices des écoles des gymnastique; il
lit les philosophes; à Sellasie, il s'est battu comme un lion :
«
Aucun homme, dit Polybe, ne fut plus vertueux que lui [...]; mêlé
pendant quarante ans, et non sans gloire, aux affaires d'une démocratie,
il sut échapper à l'envie; cependant, il gouverna toujours
avec franchise et sais s'inquiéter de la faveur, conduite dont on
trouverait peu d'exemples. »
Il dote les Achéens
d'un, cavalerie sans rivale; il succède à Aratos
comme capitaine général. Alors, il prend modèle sur
la phalange macédonienne pour l'armement et la tactique des fantassins.
Il bat les Spartiates, les bat encore à Mantinée et, cette
fois, s'acharne sur les vaincus : 3000 Spartiates sont vendus comme esclaves;
les remparts de leur ville, démolis; les lois de Lycurgue, à
jamais interdites : Sparte est morte (206).
L'irruption des
Romains.
Sur ces entrefaites, de terribles événements
ont bouleversé la Grèce avec l'apparition d'ennemis nouveaux : les Romains,
auxquels il est réservé d'établir leur empire sur
toutes ces ruines et sur toutes ces discordes. Par la mise en pratique
de la maxime : « Diviser pour régner », qui leur assura
tant de triomphes, ils ont réussi à séparer les deux
ligues et à jeter les Etoliens contre
Philippe V de Macédoine, qui
s'est allié contre eux avec le Carthaginois Hannibal.
Pendant ce tendis, les Achéens restent fidèles à celui
qui les a soutenus contre Sparte : la Grèce est donc coupée
en deux. Philippe battu, Rome dont les soldats
foulent en vainqueurs le sol des Grecs prend comme plaisir à tenir
leur destinée en suspens. Philopoemen voit bien que Rome est l'ennemie
suprême. Il veut, lui opposer le Péloponnèse
avec l'apparition d'ennemis nouveaux : les Romains,
auxquels il est réservé d'établir leur empire sur
toutes ces ruines et sur toutes ces discordes. Par la mise en pratique
de la maxime : « Diviser pour régner », qui leur assura
tant de triomphes, ils ont réussi à séparer les deux
ligues et à jeter les Etoliens contre
Philippe V de Macédoine, qui
s'est allié contre eux avec le Carthaginois Hannibal.
Pendant ce tendis, les Achéens restent fidèles à celui
qui les a soutenus contre Sparte : la Grèce est donc coupée
en deux. Philippe battu, Rome dont les soldats
foulent en vainqueurs le sol des Grecs prend comme plaisir à tenir
leur destinée en suspens. Philopoemen voit bien que Rome est l'ennemie
suprême. Il veut, lui opposer le Péloponnèse comme une forteresse. Les Messéniens sont en pleine révolte;
il faut les pacifier. Aux environs de Messène, dans un combat d'arrière-garde,
il est enveloppé et fait prisonnier. Mené à Messène,
il y meurt empoisonné par la ciguë, heureux d'apprendre, en
levant la coupe, que ses compagnons sont sauvés (184).
comme une forteresse. Les Messéniens sont en pleine révolte;
il faut les pacifier. Aux environs de Messène, dans un combat d'arrière-garde,
il est enveloppé et fait prisonnier. Mené à Messène,
il y meurt empoisonné par la ciguë, heureux d'apprendre, en
levant la coupe, que ses compagnons sont sauvés (184).
Le Romain Paul-Émile
a trouvé la tactique qui brise la phalange macédonienne.
Le voici vainqueur de Persée, maître
de la Macédoine et de la Béotie
et de la Béotie ;
il passe les Thermopyles ;
il passe les Thermopyles : il n'y a plus de Spartiates pour les défendre.
Les Achéens se lèvent une dernière
fois et barrent le Péloponnèse
: il n'y a plus de Spartiates pour les défendre.
Les Achéens se lèvent une dernière
fois et barrent le Péloponnèse à Corinthe. Les Romains se ruent
et percent les lignes; rien ne leur résiste plus. Corinthe est saccagée
et rasée. Cette fois, la Grèce
à Corinthe. Les Romains se ruent
et percent les lignes; rien ne leur résiste plus. Corinthe est saccagée
et rasée. Cette fois, la Grèce a trouvé sous un maître l'unité et la paix définitives.
En 146 av. J.-C., elle n'est plus qu'une
dépendance de la province romaine de Macédoine. Les Romains,
poursuivant avec méthode leurs conquêtes sur les côtes
et sur les îles de la mer Egée, sur les côtes et dans
les provinces de l'Asie, vont ironiquement prouver qu'ils ont, eux, la
conception d'un bloc hellénique, pour le salut duquel aucun peuple
grec n'a rien voulu sacrifier de son égoïsme, de ses antipathies
ni de ses ambitions; mais ce bloc ne sera polir eux qu'un élément
du formidable édifice de domination qu'ils vont élever au
profit de la gloire de Rome
a trouvé sous un maître l'unité et la paix définitives.
En 146 av. J.-C., elle n'est plus qu'une
dépendance de la province romaine de Macédoine. Les Romains,
poursuivant avec méthode leurs conquêtes sur les côtes
et sur les îles de la mer Egée, sur les côtes et dans
les provinces de l'Asie, vont ironiquement prouver qu'ils ont, eux, la
conception d'un bloc hellénique, pour le salut duquel aucun peuple
grec n'a rien voulu sacrifier de son égoïsme, de ses antipathies
ni de ses ambitions; mais ce bloc ne sera polir eux qu'un élément
du formidable édifice de domination qu'ils vont élever au
profit de la gloire de Rome . .
Néanmoins, les dernières
luttes de la Grèce pour la liberté gardent, malgré les fautes et les responsabilités
communes, une sublime grandeur tragique. Le ciel de la liberté grecque
se couvrait lentement du voile obscur de la servitude. Mais, de temps à
autre, le soleil déclinant, gui avait illuminé tant de gloire,
ravivait son éclat, dissipait les nuées qui l'étouffaient
et, parfois, par une brusque déchirure, jaillissait une large coulée
de lumière aux reflets de sang. (HUP).
pour la liberté gardent, malgré les fautes et les responsabilités
communes, une sublime grandeur tragique. Le ciel de la liberté grecque
se couvrait lentement du voile obscur de la servitude. Mais, de temps à
autre, le soleil déclinant, gui avait illuminé tant de gloire,
ravivait son éclat, dissipait les nuées qui l'étouffaient
et, parfois, par une brusque déchirure, jaillissait une large coulée
de lumière aux reflets de sang. (HUP). |
|