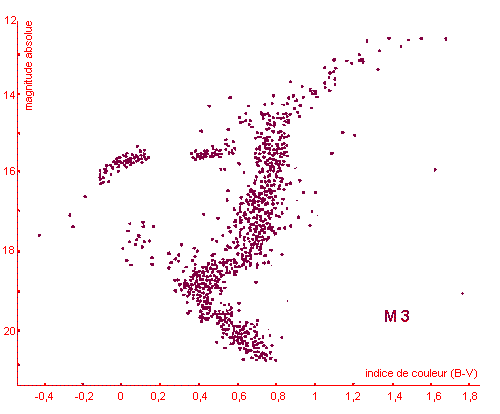Aperçu |
La lumière
des étoiles nous fait parvenir un message brouillé et complexe. Pour
en démêler les arcanes, les astronomes recourent à un outil mis au point
dans les premières années du XXe siècle
par Ejnar Hertzsprung (1905) et indépendamment par Henry Norris Russell
(1905) et indépendamment par Henry Norris Russell (1914). Il s'agit d'un diagramme dans lequel les points représentatifs
d'un ensemble d'étoiles sont placées en fonction de leur couleur,
température superficielle ou type
spectral (qui correspondent aux abscisses) et de leur luminosité ou
de leur magnitude absolues ou apparentes (en ordonnées).
(1914). Il s'agit d'un diagramme dans lequel les points représentatifs
d'un ensemble d'étoiles sont placées en fonction de leur couleur,
température superficielle ou type
spectral (qui correspondent aux abscisses) et de leur luminosité ou
de leur magnitude absolues ou apparentes (en ordonnées).
Les
différentes possibilités représentent des variantes du diagramme de
Hertzsprung-Russell (au sens large). On parlera ainsi plus spécialement
du diagramme couleur-magnitude (C-M), quand on recourt à ces deux paramètres,
et de diagramme de Hertzsprung-Russell, au sens strict, quand les paramètres
sont le type spectral et la magnitude apparente. Le choix de la variante
dépendra des paramètres disponibles ou du choix que l'astronome a jugé
le plus plus commode selon le contexte. Mais, il ne s'agira chaque fois
que du changement d'échelle des axes du diagramme, et pour une collection
d'étoiles donnée, la morphologie de toutes ces variantes restera donc
toujours la même.
Le diagramme de Hertzsprung-Russell est vite devenu
la pierre angulaire de l'astronomie stellaire, il révèle les mécanismes
qui gouvernent le devenir des étoiles et apporte
un peu de raison et d'ordre dans le bestiaire céleste.
Lorsqu'on cherche à caractériser dans un diagramme
HR la population d'étoiles de la
région de la Galaxie dans laquelle se situe le
Soleil - comme l'avait fait initialement Hertzsprung
et Russell, ou comme le représente la figure ci-dessous réalisée à
partir des mesures du satellite Hipparcos - le diagramme révèle que les
étoiles se concentrent dans deux régions privilégiées. La première
est une grande diagonale, appelée séquence
(ou série) principale, qui accueille la majorité des étoiles, dont
le Soleil. L'autre zone d'accumulation, dans la partie droite du diagramme,
regroupe des étoiles relativement froides (rouges) et plus lumineuses,
et constitue la branche des géantes.
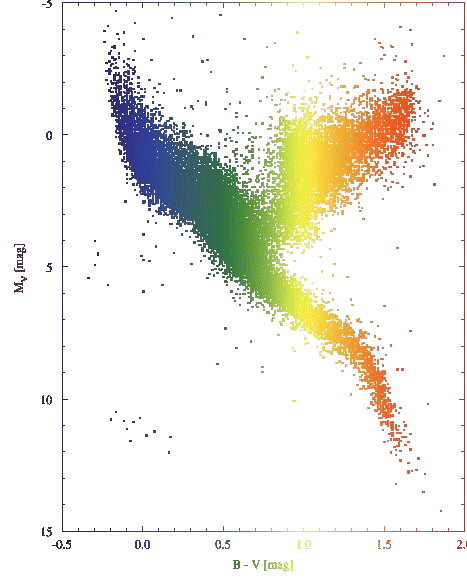
Diagramme
C-M du voisinage solaire réalisé à l'aide d'Hipparcos.
Ces concentrations sont le signe de corrélations
entre luminosité et couleur des étoiles, c'est-à-dire de l'existence
d'un ordre par-delà la diversité des apparences. Sur la séquence principale,
le déchiffrement est simple : plus une étoile est chaude (ou bleue) et
plus elle est lumineuse intrinsèquement; plus elle est froide (ou rouge)
et moins elle est lumineuse. La logique est différente pour les géantes.
Mais pour aller plus loin, l'échantillon que constituent les étoiles
du voisinage solaire est inadapté. Il s'agit en effet d'étoiles d'origines
diverses, qui se sont trouvées mélangées au fil du temps dans une même
région de l'espace.
Le diagramme HR prend sa pleine puissance lorsqu'on
l'utilise pour étudier des collections d'étoiles qui ont la même origine.
On a pu l'utiliser au cours des dernières années pour caractériser les
populations de certaines
galaxies dans leur ensemble (par ex. la Naine du Sextant,
ou la galaxie Leo I, dans le Lion). Mais, depuis
que Trumpler ,
dans les années 1920, a attiré l'attention sur eux, le territoire privilégié
du diagramme de Hertzsprung-Russell se sont les amas
stellaires, qu'ils soient ouverts ou globulaires. ,
dans les années 1920, a attiré l'attention sur eux, le territoire privilégié
du diagramme de Hertzsprung-Russell se sont les amas
stellaires, qu'ils soient ouverts ou globulaires.
Dans un amas, toutes les étoiles ont la même origine.
Elles ont le m√™me √Ęge, et comme l'ont compris les astronomes en s'aidant
justement de la comparaison de diagrammes de nombreux amas, elles ne se
distinguent que par des masses différentes.
Les étoiles les plus massives,
consomment leur combustible à un taux accéléré, et évoluent plus rapidement
que les étoiles les moins massives. Si bien que la région bleue de la
séquence principale des amas se dépeuple progressivement, au profit de
la région des géantes rouges, qui sont des étoiles parvenues à un stade
avancé d'évolution.
-
|
Les populations
stellaires*
En
1941, Baade a également utilisé le diagramme HR pour distinguer l'existence de deux
population d'étoiles dans les galaxies.
a également utilisé le diagramme HR pour distinguer l'existence de deux
population d'étoiles dans les galaxies.
Population
I - Les étoiles que l'on rencontre dans le voisinage du Soleil, dans
les amas ouverts, et plus généralement dans le disque des galaxies spirales
sont dites de population I. Elles correspondent à des étoiles relativement
jeunes.
Population
II - Ces étoiles sont plus anciennes que les précédentes. On les
rencontre principalement dans le halo des galaxies spirales et constituent
en particulier la population des amas globulaires.
On ajoute
à ces deux types de population une population I extrême, constituée
des étoiles les plus jeunes, et l'on évoque aussi la possible existence
d'étoiles de population III, qui seraient les premières étoiles formées,
et dont on attend qu'elles ne présentent aucun signe de pollution par
des éléments lourds, puisqu'il n'y aurait eu aucune génération d'étoiles
antérieures.
Actuellement
aucune étoile de population III n'est connue. Il est possible, en fait
qu'il n'en existe plus. Si les toutes premières étoiles étaient très
massives, elles ont d√Ľ exploser tr√®s t√īt et disperser autour d'elles
les éléments qu'elles avaient synthétisées, affectant ainsi la composition
chimique de leurs contemporaines. |
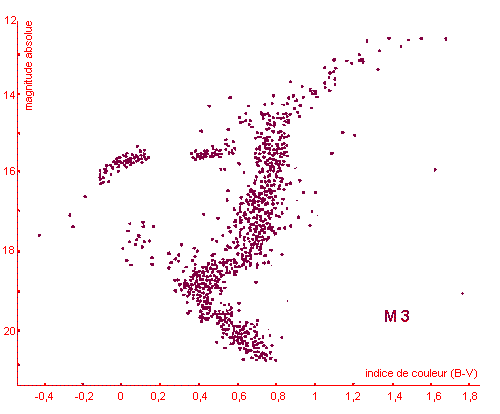
Le
diagramme HR typique d'un amas globulaire (M 3, dans les Chiens
de Chasse).
|
|