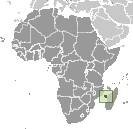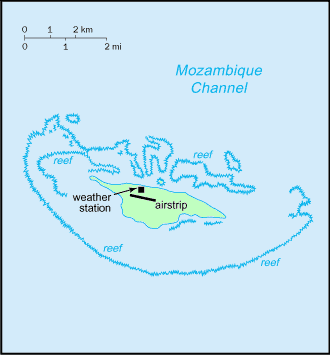17
03 S, 42 45 E
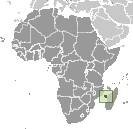 |
L'île Juan
de Nova est un territoire d'outre-mer de la France ,
situé au large des côtes de Madagascar et faisant partie des Îles
Éparses. L'île couvre environ 4,5 km² et est relativement plate
avec des plages de sable blanc et une végétation côtière. Elle est
entourée de récifs coralliens et possède un lagon intérieur. ,
situé au large des côtes de Madagascar et faisant partie des Îles
Éparses. L'île couvre environ 4,5 km² et est relativement plate
avec des plages de sable blanc et une végétation côtière. Elle est
entourée de récifs coralliens et possède un lagon intérieur.
 Cette île doit son nom à João
da Nova, navigateur du XVe siècle.
La France en revendique la possession depuis 1897. Son guano et son phosphate
a été exploité dans le passé. Aujourd'hui, une petite garnison militaire
supervise sa station météorologique.
Cette île doit son nom à João
da Nova, navigateur du XVe siècle.
La France en revendique la possession depuis 1897. Son guano et son phosphate
a été exploité dans le passé. Aujourd'hui, une petite garnison militaire
supervise sa station météorologique.
La végétation est assez limitée. On y trouve
des plantes résistantes au sel et des arbustes côtiers. Juan de Nova
abrite des oiseaux marins comme les sternes et les pétrels, et des populations
de tortues marines qui viennent y pondre. Les récifs coralliens environnants
sont également riches en biodiversité marine.
L'île est protégée et classée comme
réserve naturelle. Elle est sous la juridiction des TAAF et est gérée
dans le cadre des politiques de conservation. L'accès y est limité et
généralement restreint aux missions scientifiques ou aux opérations
de conservation. Les visiteurs sont soumis à des réglementations strictes
pour préserver l'environnement fragile.
-
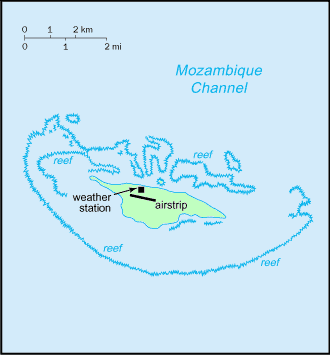
Carte
de l'île Juan de Nova.Source : The World Factbook.
(Cliquer
sur l'image pour afficher une carte plus détaillée).
|
|