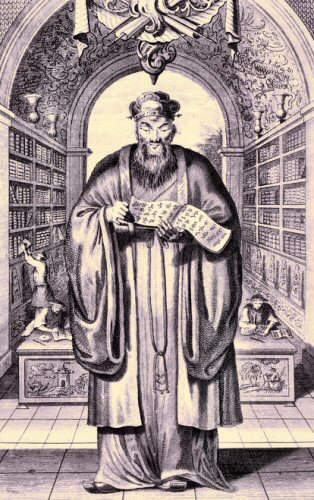|
Confucius,
nom latinis√© de Kong Fou-tseu (Ma√ģtre Kong) est un philosophe chinois,
né en 551, mort en 479 av. J. C. Les Chinois l'appellent Kong tseu, le
regardent et le révèrent comme le Sage par excellence. Sa famille remontait
au célèbre empereur Hoang-ti et après avoir quitté le pays de Soung, vint s'établir définitivement
dans celui de Lou (partie du Chan-toung actuel). Son père, Kong-chou Liang-he,
n'ayant eu que des filles d'un premier mariage, épousa en secondes noces
une jeune fille de la famille Yen, dont il eut, en 551, à Tseou, un fils
qui reçut le nom de Kieou à cause d'une protubérance qu'il avait sur
la tête, et le surnom de Tchoung-ni, qui est notre philosophe.
et après avoir quitté le pays de Soung, vint s'établir définitivement
dans celui de Lou (partie du Chan-toung actuel). Son père, Kong-chou Liang-he,
n'ayant eu que des filles d'un premier mariage, épousa en secondes noces
une jeune fille de la famille Yen, dont il eut, en 551, à Tseou, un fils
qui reçut le nom de Kieou à cause d'une protubérance qu'il avait sur
la tête, et le surnom de Tchoung-ni, qui est notre philosophe.
-

Statue
de Confucius dans un temple, au Vietnam. Photo
: © Angel Latorre, 2008.
Confucius n'eut d'ailleurs lui-même qu'un
fils auquel il survécut et qui suffit à perpétuer sa descendance, anoblie
par l'empereur Kaotsou, de la dynastie des Han (vers 200 av. J.-C.). Le
chef de la famille porte le titre de duc (Kong). Kong-kieou perdit son
p√®re √† l'√Ęge de trois ans, et sa m√®re Tcheng-tsai quitta le district
de Tchang-ping pour aller s'établir dans celui de Ku-feou. Elevé d'abord
par sa m√®re, le jeune Kieou fut, √† l'√Ęge de sept ans, envoy√© dans une
école tenue par un lettré distingué, nommé Ping-tchoung; il ne tarda
pas à se faire remarquer non seulement par son amour du travail, mais
encore par sa gravit√© pr√©coce, et son ma√ģtre le choisit pour faire r√©p√©ter
leurs leçons à ses condisciples moins bien doués que lui. A dix-sept
ans, il accepta un poste de fonctionnaire inspecteur de la vente et de
la distribution des grains, à dix-neuf ans, Kong épousa Ki Kouan-che
qui appartenait à la famille Ki, du royaume de Soung; il en eut l'année
suivante un fils qu'il appela Pe-yu. A vingt et un ans, sa réputation
étant devenue grande, il fut nommé inspecteur général des campagnes
et des troupeaux, avec mission de réprimer les abus. Pendant quatre ans,
il remplit ses fonctions avec un zèle qui lui permettait d'aspirer à
de hautes dignit√©s, lorsque la mort de sa m√®re, √† peine √Ęg√©e de quarante
ans, lui fit prendre une retraite de trois ans, renouvelant ainsi une coutume
qui s'est perpétuée en Chine jusqu'à la fin de l'époque impériale. Confucius continua à se perfectionner
dans l'étude de la philosophie. Il fit une visite à la ville de Loh,
près de la ville actuelle de Honan-fou, et l'on prétend qu'il y eut une
entrevue avec le célèbre Lao-tseu. En 517, l'Etat de Lou étant en pleine
anarchie, Confucius se retira à la cour de Tsi, puis il revint dans son
pays, o√Ļ, pendant quelques ann√©es encore, il n'occupa aucune fonction
publique. Tchao-Koung, roi de Lou, étant mort en exil, eut pour successeur
son frère Ting-Koung qui, en 501, nomma Confucius gouverneur de la ville
de Tchoung-tou, poste dans lequel il se distingua tellement que, l'année
suivante, il était nommé ministre des travaux publics, puis ministre
de la justice. La prospérité de l'Etat de Lou sous la sage administration
de Confucius excita la jalousie du roi de Tsi; celui-ci, pour détacher
Ting de son ministre, envoya à la cour de Lou quatre-vingts des plus belles
courtisanes de Tsi et cent vingt superbes chevaux en présents. L'effet
de ce cadeau dangereux ne tarda pas à se faire sentir; Confucius, alors
√Ęg√© de cinquante-quatre ans (497), se d√©cida √† quitter le royaume de
Lou, o√Ļ il ne rentra qu'en 484. Il se mit donc √† voyager dans les diff√©rents
Etats qui composaient la Chine; sa réputation allait grandissant et le
nombre de ses disciples augmentait sans cesse. Il parcourut les royaumes
de Wei, de Tsao, de Soung, de Tcheng, de Tchen, etc. Cependant le roi Ting,
de Lou, étant mort en 495, son fils et successeur, Ngai, le rappela de
Wei, mais le r√īle politique du Sage √©tait d√©sormais fini et il mourut
√† l'√Ęge de soixante-treize ans, le jour Ki-tcheou de la quatri√®me lune
de la seizième année de Ngai-Koung, roi de Lou, la quarante et unième
du règne de King-ouang, vingt-cinquième empereur de la dynastie des Tcheou,
479 av. J.-C. Son petit-fils, Tseu-seu étant trop jeune, ses disciples,
Tseu-Koung et Koung Hi-tche, se chargèrent des funérailles.
jusqu'à la fin de l'époque impériale. Confucius continua à se perfectionner
dans l'étude de la philosophie. Il fit une visite à la ville de Loh,
près de la ville actuelle de Honan-fou, et l'on prétend qu'il y eut une
entrevue avec le célèbre Lao-tseu. En 517, l'Etat de Lou étant en pleine
anarchie, Confucius se retira à la cour de Tsi, puis il revint dans son
pays, o√Ļ, pendant quelques ann√©es encore, il n'occupa aucune fonction
publique. Tchao-Koung, roi de Lou, étant mort en exil, eut pour successeur
son frère Ting-Koung qui, en 501, nomma Confucius gouverneur de la ville
de Tchoung-tou, poste dans lequel il se distingua tellement que, l'année
suivante, il était nommé ministre des travaux publics, puis ministre
de la justice. La prospérité de l'Etat de Lou sous la sage administration
de Confucius excita la jalousie du roi de Tsi; celui-ci, pour détacher
Ting de son ministre, envoya à la cour de Lou quatre-vingts des plus belles
courtisanes de Tsi et cent vingt superbes chevaux en présents. L'effet
de ce cadeau dangereux ne tarda pas à se faire sentir; Confucius, alors
√Ęg√© de cinquante-quatre ans (497), se d√©cida √† quitter le royaume de
Lou, o√Ļ il ne rentra qu'en 484. Il se mit donc √† voyager dans les diff√©rents
Etats qui composaient la Chine; sa réputation allait grandissant et le
nombre de ses disciples augmentait sans cesse. Il parcourut les royaumes
de Wei, de Tsao, de Soung, de Tcheng, de Tchen, etc. Cependant le roi Ting,
de Lou, étant mort en 495, son fils et successeur, Ngai, le rappela de
Wei, mais le r√īle politique du Sage √©tait d√©sormais fini et il mourut
√† l'√Ęge de soixante-treize ans, le jour Ki-tcheou de la quatri√®me lune
de la seizième année de Ngai-Koung, roi de Lou, la quarante et unième
du règne de King-ouang, vingt-cinquième empereur de la dynastie des Tcheou,
479 av. J.-C. Son petit-fils, Tseu-seu étant trop jeune, ses disciples,
Tseu-Koung et Koung Hi-tche, se chargèrent des funérailles.
-
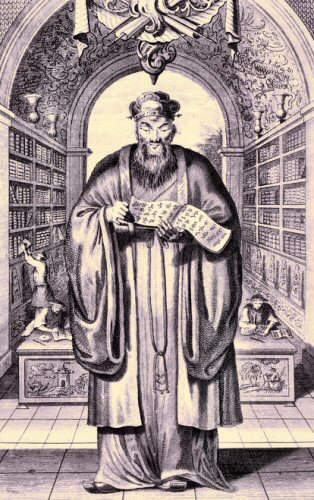
Confucius.
La doctrine de Confucius est moins une
philosophie qu'une morale : une morale reposant
sur des vertus naturelles, n'ayant rien d'h√©ro√Įque, avec un c√īt√© pratique;
une morale codifiant pour ainsi dire les sentiments, prenant par exemple
la piété filiale, étendant son caractère au delà de la famille, jusqu'à
l'empereur, le gouvernement, la nation et prévoyant dans les préceptes
tous les cas, toutes les circonstances dans lesquelles les théories doivent
√™tre mises en pratique. C'est justement ce c√īt√© essentiellement humain,
essentiellement terre à terre, qui a donné de la durée à la doctrine
de Confucius : elle est claire, limpide, compréhensible pour tous, n'a
rien des obscurités, ni en même temps du génie de Lao-tseu. Cette doctrine
est renfermée dans les livres classiques désignés sous le nom général
de King .
Tous ces livres, quoique appartenant à l'école de Confucius, sont loin
d'être en entier l'oeuvre personnelle du Sage, dont nous allons essayer
de marquer la part. Dix sections : Che-yi, de l'Y-king; le Chou-king est
une compilation par Confucius de ce qui restait des histoires de Yu et
des dynasties des Hia, des Chang et des Tcheou; il se composait de cent
chapitres qui comprenaient l'histoire de la Chine depuis les empereurs
Yao
et Chun, jusqu'à Ping-wang de la dynastie des Tcheou (720 av. J.-C.);
aujourd'hui l'ouvrage renferme cinquante-huit chapitres; il a subi des
remaniements, de nouvelles rédactions et des deux textes qui nous en restent,
l'ancien et le moderne Fou-wen et Fin-wen, ce dernier parait être le plus
authentique et comprend trente-trois chapitres sur cinquante-huit. Le Chi-king
est une collection des odes au nombre de trois cent onze répandues à
l'époque des Tcheou dans les petits Etats de la Chine, recueillies et
arrangées par Confucius. Le Tchoun-tsieou, annales du Printemps et de
l'Automne, est le seul des cinq grands King qui ait été vraiment écrit
par Confucius : c'est l'histoire de son pays, du pays de Lou, de 722 à
481 av. J.-C. C'est avec des matériaux rassemblés par ses disciples dans
les archives de l'Etat de Tcheou que Confucius a pu compiler cet ouvrage.
Il faut y ajouter les trois commentaires faits l'un par Tso Kieou-ming
sous le titre de Tso-tchouen; un second au commencement des Han par Kong-yang
Kao et le dernier vers le milieu du siècle av. J.-C. par Keou-lang. Dans
les Se-chou, quatre livres classiques, des onze chapitres qui composent
le Ta-hio, grande étude, le premier renferme les paroles de Confucius,
les dix autres sont de Tseng-tseu, son disciple; le Tchoung-young est de
Tseu-seu son petit-fils; le Luen-yu, conversations entre Confucius et ses
disciples, en vingt chapitres, n'a pas été rédigé par lui, pas plus
naturellement que le livre de Mencius. Le Hiao-king, livre de la pitié
filiale, est une conversation entre Confucius et son disciple Tseng-tseu
: il a été rédigé par un autre disciple dont on n'a pas conservé le
nom. Quoique ces livres n'aient pas été tous, comme je l'ai dit, écrits
par Confucius, ils ont tous son empreinte et s'inspirent de ses idées. .
Tous ces livres, quoique appartenant à l'école de Confucius, sont loin
d'être en entier l'oeuvre personnelle du Sage, dont nous allons essayer
de marquer la part. Dix sections : Che-yi, de l'Y-king; le Chou-king est
une compilation par Confucius de ce qui restait des histoires de Yu et
des dynasties des Hia, des Chang et des Tcheou; il se composait de cent
chapitres qui comprenaient l'histoire de la Chine depuis les empereurs
Yao
et Chun, jusqu'à Ping-wang de la dynastie des Tcheou (720 av. J.-C.);
aujourd'hui l'ouvrage renferme cinquante-huit chapitres; il a subi des
remaniements, de nouvelles rédactions et des deux textes qui nous en restent,
l'ancien et le moderne Fou-wen et Fin-wen, ce dernier parait être le plus
authentique et comprend trente-trois chapitres sur cinquante-huit. Le Chi-king
est une collection des odes au nombre de trois cent onze répandues à
l'époque des Tcheou dans les petits Etats de la Chine, recueillies et
arrangées par Confucius. Le Tchoun-tsieou, annales du Printemps et de
l'Automne, est le seul des cinq grands King qui ait été vraiment écrit
par Confucius : c'est l'histoire de son pays, du pays de Lou, de 722 à
481 av. J.-C. C'est avec des matériaux rassemblés par ses disciples dans
les archives de l'Etat de Tcheou que Confucius a pu compiler cet ouvrage.
Il faut y ajouter les trois commentaires faits l'un par Tso Kieou-ming
sous le titre de Tso-tchouen; un second au commencement des Han par Kong-yang
Kao et le dernier vers le milieu du siècle av. J.-C. par Keou-lang. Dans
les Se-chou, quatre livres classiques, des onze chapitres qui composent
le Ta-hio, grande étude, le premier renferme les paroles de Confucius,
les dix autres sont de Tseng-tseu, son disciple; le Tchoung-young est de
Tseu-seu son petit-fils; le Luen-yu, conversations entre Confucius et ses
disciples, en vingt chapitres, n'a pas été rédigé par lui, pas plus
naturellement que le livre de Mencius. Le Hiao-king, livre de la pitié
filiale, est une conversation entre Confucius et son disciple Tseng-tseu
: il a été rédigé par un autre disciple dont on n'a pas conservé le
nom. Quoique ces livres n'aient pas été tous, comme je l'ai dit, écrits
par Confucius, ils ont tous son empreinte et s'inspirent de ses idées.
Lorsque Chi Hoang-ti, le grand empereur
Tsin, voulut, en proscrivant les livres, anéantir tout vestige de la dynastie
des Tcheou, les oeuvres de Confucius et les rituels eurent spécialement
à souffrir de la destruction ordonnée par ce monarque. Le Tcheou-li,
rituel des Tcheou, fut particulièrement désigné à la destruction par
les Tsin, qui avaient conservé les rites des Chang, ainsi que le Chou-king,
livre d'histoire. On raconte que, lors de la renaissance littéraire, à
l'époque des Han (178 av. J.-C), un vieillard, nommé Fun-sang,
habitant de Tsi-nan dans le Chan-toung, se rappelant par coeur vingt-neuf
chapitres du Chou-King, on put reconstituer un texte de ce livre. En 140
av. J.-C., sous le règne de l'empereur Wou-ti, l'habitation de Confucius
fut démolie par ordre de Kong-wang, prince de Lou, et l'on trouva dans
les murs plusieurs livres dont un exemplaire du Chou-king, du rituel I-li
du Hiao-king, qui permirent de donner de nouveaux textes de ces ouvrages.
Quelque grande que soit la popularité de Confucius, elle a été certainement
accrue par le développement des doctrines du Sage, à l'époque des Soung,
par le grand philosophe Tchou-hi (1130-1200).
Les étrangers désignent généralement
sous le nom de confucianisme ce que les
Chinois appellent le Jou-kiao, religion des lettrés, appellation qui date
du XIIe siècle (1150) et dénote les disciples
de Tchou-hi.
-

Gros
plan sur l'architecture colorée du temple de Confucius, à Pékin.
Initialement construit
en
1302, le temple a été utilisé par les fonctionnaires impériaux pour
rendre hommage à l'ancien
philosophe
et éducateur. Source : The World Factbook.
Le premier de tous les saints dans le calendrier
du Jou-Kiao est Confucius en personne, Mencius lui-même n'étant placé
qu'au second rang. Ce Jou-Kiao est lié d'une façon intime avec la religion
d'Etat. La religion d'Etat comprend trois degr√©s de sacrifices : 1¬į les
grands sacrifices qui s'adressent au ciel (tien), à la terre (ti), aux
grands temples des anc√™tres (tai miao), o√Ļ sont plac√©es les tablettes
des empereurs défunts de la dynastie régnante, aux Chié tsi, dieux de
la terre et des grains; 2¬į les sacrifices moyens ont neuf objets : le
soleil, la lune, les m√Ęnes des empereurs et rois des dynasties pr√©c√©dentes,
Confucius, les anciens patrons de l'agriculture et de la soie, les dieux
du ciel et de la terre et l'ann√©e du cycle; 3¬į les sacrifices inf√©rieurs,
Kioun-se, s'adressent soit à des bienfaiteurs défunts, à des hommes
d'Etat célèbres, soit au vent, à la pluie, au tonnerre, aux montagnes,
aux fleuves, etc. C'est au solstice d'hiver qu'a lieu la grande fête de
la religion d'Etat, c'est le jour o√Ļ l'empereur se rend officiellement
au Tien-tan, temple du ciel. Il est bien difficile de faire remonter l'origine
de ce culte à Confucius et à ses disciples immédiats; ce génie positif
ne connaissait que la famille et l'Etat; le devoir envers le divin, il
n'en parle pas; son commentateur, Tchou-hi, avec son premier principe,
le Tai-ki, tombe absolument dans le matérialisme; il est aussi curieux
de voir les disciples de Confucius créer le Jou-kiao que de voir ceux
de Lao-tseu cr√©er le tao√Įsme; la philosophie ne leur a pas suffi, il
a fallu que non seulement leur esprit f√Ľt satisfait, mais encore leurs
yeux; avec deux théories, l'une pratique, l'autre abstraite, ils inventèrent
deux cultes avec leurs cérémonies et leurs ministres. (Henri
Cordier).
 |
 Confucius
et le Confucianisme (choix de textes), Pocket, 2008. - Une
présentation de la pensée confucéenne et de l'influence de cet homme
sur le monde chinois, ancien et actuel. Un
ouvrage qui présente un choix de grands textes et une présentation qui
en éclaire la lecture. Confucius
et le Confucianisme (choix de textes), Pocket, 2008. - Une
présentation de la pensée confucéenne et de l'influence de cet homme
sur le monde chinois, ancien et actuel. Un
ouvrage qui présente un choix de grands textes et une présentation qui
en éclaire la lecture.
Lorsque
les Chinois, au début du XXe siècle voulurent mettre à bas l'héritage
traditionnel de leur nation, ils s'en prirent spontanément à Confucius,
confirmant par là son caractère indissociable de la civilisation
chinoise. Il y eut certes en Chine de nombreux courants de pensée
qui marquèrent durablement sa culture, mais seul le confucianisme en fut
pour ainsi dire le cadre qui fit de l'empire du Milieu un monde si spécifique.
Si
l'étude de la pensée confucéenne est d'une importance capitale à celui
qui veut comprendre ce monde chinois, elle offre également une méditation
fondamentale sur l'homme. C'est à ce titre que Confucius figure parmi
les grandes figures de l'humanité telles Socrate,
le Bouddha ou Jésus.
Sa pens√©e est habit√©e par une vision traditionnelle du monde o√Ļ l'humain
trouve sa place dans un ordre naturel qu'il s'agit de respecter. L'observation
des rites alliés à la rectitude du coeur, la piété filiale comme cadre
des relations, les rapports du Ciel, des hommes et de la terre, voilà
autant de voies susceptibles d'inscrire l'homme au centre de son humanité.
Cette
anthologie des grands textes confucianistes offre au lecteur un large champ
au sein duquel il pourra entrer de façon approfondie dans cette pensée
qui ordonna tout l'esprit d'un peuple. (couv.).
 Jacques
Sancery, Confucius, Cerf , 2009. -
Grande figure de l'humanité, Confucius le fut assurément. Pourtant, il
ne fut ni un prophète, ni le fondateur d'une religion, ni même une figure
philosophique au sens o√Ļ nous l'entendons en Occident. On a parl√© de
moraliste érudit, d'"honnête homme". On l'a comparé à
Socrate
ou encore à Montaigne. En vérité, ce grand
sage, doublé d'un savant, fut tout à la fois un éducateur au charisme
exceptionnel, un idéologue profondément humaniste et un homme d'action
qui chercha, durant toute sa vie, à réformer la société de son temps
qu'il jugeait en perdition. Apr√®s des d√©buts incertains et gr√Ęce √†
l'engagement de ses disciples les plus doués, sa pensée, les idéaux
politiques et moraux qu'il chérissait finirent par marquer d'une empreinte
indélébile la société tout entière, s'ancrant dans les mentalités
et influençant les us et coutumes du peuple chinois pendant plus de deux
millénaires. S'appuyant sur des valeurs morales propres à transcender
l'homme, l'enseignement de celui qui fut v√©n√©r√© comme le Ma√ģtre par
excellence pr√īna une √©thique universelle et intemporelle. A ce titre,
le legs spirituel de Confucius reste d'une étonnante modernité. Dans
cette étude approfondie, fruit de patientes recherches et de longues années
de travail, l'auteur s'est employé à mettre en lumière les multiples
facettes de sa pensée, s'attachant à en dégager les lignes de force,
en se référant constamment aux sources anciennes sans négliger pour
autant les travaux les plus récents. (couv.). Jacques
Sancery, Confucius, Cerf , 2009. -
Grande figure de l'humanité, Confucius le fut assurément. Pourtant, il
ne fut ni un prophète, ni le fondateur d'une religion, ni même une figure
philosophique au sens o√Ļ nous l'entendons en Occident. On a parl√© de
moraliste érudit, d'"honnête homme". On l'a comparé à
Socrate
ou encore à Montaigne. En vérité, ce grand
sage, doublé d'un savant, fut tout à la fois un éducateur au charisme
exceptionnel, un idéologue profondément humaniste et un homme d'action
qui chercha, durant toute sa vie, à réformer la société de son temps
qu'il jugeait en perdition. Apr√®s des d√©buts incertains et gr√Ęce √†
l'engagement de ses disciples les plus doués, sa pensée, les idéaux
politiques et moraux qu'il chérissait finirent par marquer d'une empreinte
indélébile la société tout entière, s'ancrant dans les mentalités
et influençant les us et coutumes du peuple chinois pendant plus de deux
millénaires. S'appuyant sur des valeurs morales propres à transcender
l'homme, l'enseignement de celui qui fut v√©n√©r√© comme le Ma√ģtre par
excellence pr√īna une √©thique universelle et intemporelle. A ce titre,
le legs spirituel de Confucius reste d'une étonnante modernité. Dans
cette étude approfondie, fruit de patientes recherches et de longues années
de travail, l'auteur s'est employé à mettre en lumière les multiples
facettes de sa pensée, s'attachant à en dégager les lignes de force,
en se référant constamment aux sources anciennes sans négliger pour
autant les travaux les plus récents. (couv.).
Régine Pietra, La
Chine et le confucianisme aujourd'hui, Le Félin, 2008. |
|
|