| . |
| ||||||
| |
| . |
| ||||||
| | ||
| Maupertuis, 1738 | ||
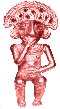 Maupertuis | J'exposai, il y a dix-huit mois, à la même Assemblée, le motif et le projet du voyage au cercle polaire; je vais lui faire part aujourd'hui de l'exécution. Mais il ne sera peut-être pas inutile de rappeler un peu les idées sur ce qui a fait entreprendre ce voyage. M. Richer ayant découvert à Cayenne | [1] En fait, il faudra attendre l'expérience de Foucault pour que cette preuve soit réellement disponible. |
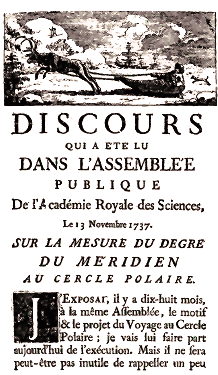 M. Newton était parti d'une autre théorie, de l'attraction Dès l'établissement de l'Académie, un de ses premiers soins avait été la mesure du degré du méridien Lorsque la mesure du méridien qui traverse la France fut achevée, on fut bien surpris de voir qu'on avait trouvé les degrés vers le Nord plus petits que vers le Midi; cela était absolument opposé à ce qui devait suivre de l'aplatissement de la Terre. Selon ces mesures, elle devait être allongée vers les pôles; d'autres opérations, faites sur le parallèle qui traverse la France, confirmaient cet allongement; et ces mesures avaient un grand poids. L'Académie se voyait ainsi partagée; ses propres lumières l'avaient rendue incertaine; lorsque le roi voulut faire décider cette grande question, qui n'était pas de ces vaines spéculations dont l'oisiveté ou l'inutile subtilité des philosophes s'occupe quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles sur l'astronomie et sur la navigation. | ||
| Pour bien déterminer la figure de la Terre, il fallait comparer ensemble deux degrés du méridien, les plus différents en latitude M. le comte de Maurepas, qui aime les sciences, et qui veut les faire servir au bien de l'État, trouva réunis dans cette entreprise l'avantage de la navigation et celui de l'Académie; et cette vue de l'utilité publique mérita l'attention de M. le cardinal de Fleury; au milieu de la guerre, les sciences trouvaient en lui une protection et des secours qu'à peine auraient-elles osé espérer dans la paix la plus profonde. M. le comte de Maurepas envoya bientôt à l'Académie des ordres du roi pour terminer la question de la figure de la Terre. L'Académie les reçut avec joie, et se hâta de les exécuter par plusieurs de ses membres : les uns devaient aller sous l'équateur, mesurer le premier degré du méridien, et partirent un an avant nous; les autres devaient aller au nord, mesurer le degré le plus septentrional qu'il fût possible. On vit partir avec la même ardeur ceux qui s'allaient exposer au soleil de la Zone brûlante, et ceux qui devaient éprouver les horreurs de l'hiver dans la Zone glacée : le même esprit les animait tous, l'envie d'être utiles à la patrie. La troupe destinée pour le nord était composée de quatre Académiciens, qui étaient MM. Clairaut, Camus, Le Monnier et moi, et de M. l'Abbé Outhier, auxquels se joignit M. Celsius célèbre professeur d'astronomie à Upsala, qui a assisté à toutes nos opérations, et dont les lumières et les conseils nous ont été fort utiles. S'il m'était permis de parler de mes autres compagnons, de leur courage et de leurs talents, on verrait que l'ouvrage que nous entreprenions, tout difficile qu'il peut paraître, était facile à exécuter avec eux. Depuis longtemps nous n'avons point de nouvelles de ceux qui sont partis pour l'équateur. On ne sait presque encore de cette entreprise que les peines qu'ils ont eues; et notre expérience nous a appris à trembler pour eux. Nous avons été plus heureux, et nous revenons apporter à l'Académie le fruit de notre travail. | ||
| Le vaisseau qui nous portait [2] était à peine arrivé à Stockholm, que nous nous hâtâmes d'en partir pour nous rendre au fond du golfe de Botnie Il n'est peut-être pas inutile de donner ici une idée de l'ouvrage que nous nous proposions, et des opérations que nous avions à faire pour mesurer un degré du méridien. Lorsqu'on s'avance vers le Nord, personne n'ignore qu'on voit s'abaisser les étoiles placées vers l'équateur, et qu'au contraire celles qui sont situées vers le pôle s'élèvent : c'est ce phénomène qui vraisemblablement à été la première preuve de la rondeur de la Terre. J'appelle cette différence qu'on observe dans la hauteur Si la Terre était parfaitement sphérique, cette différence de hauteur d'une étoile, cette amplitude, serait toujours proportionnelle à la longueur de l'arc du méridien qu'on aurait parcouru. Si, pour voir une étoile changer son élévation d'un degré, il fallait, vers Paris, parcourir une distance de 57000 toises sur le méridien, il faudrait, à Torneå, parcourir la même distance, pour apercevoir dans la hauteur d'une étoile le même changement. Si au contraire la surface de la Terre était absolument plate, quelque longue distance qu'on parcourût vers le Nord, l'étoile n'en paraîtrait ni plus ni moins élevée. Si donc la surface de la Terre est inégalement courbe dans différentes régions, pour trouver la même différence de hauteur dans une étoile, il faudra, dans ces différentes régions, parcourir des arcs inégaux du méridien de la Terre; et ces arcs dont l'amplitude sera toujours d'un degré, seront plus longs là où la terre sera plus plate. Si la Terre est aplatie vers les pôles | [2] Ce vaisseau avait été équipé à Dunkerque par ordre du roi : et nous fîmes voile le 2 Mai 1736, et arrivâmes à Stockholm le 21 du même mois. | |
| On voit par là que, pour avoir la mesure d'un degré du méridien de la Terre, il faut avoir une distance mesurée sur ce méridien, et connaître le changement d'élévation d'une étoile aux deux extrémités de la distance mesurée, afin de pouvoir comparer la longueur de l'arc avec son amplitude. La première partie de notre ouvrage consistait donc à mesurer quelque distance considérable sur le méridien; et il fallait pour cela former une suite de triangles qui communiquassent avec quelque base, dont on pourrait mesurer la longueur à la perche. Notre espérance avait toujours été de faire nos opérations sur les côtes du golfe de Botnie J'avais commencé le voyage de Stockholm à Torneå par terre, comme le reste de la compagnie; mais le hasard nous ayant fait rencontrer vers le milieu de cette longue route le vaisseau qui portait nos instruments et nos domestiques, j'étais monté sur ce vaisseau, et étais arrivé à Torneå quelques jours avant les autres [18 juin 1736]. J'avais trouvé, en mettant pied à terre, le gouverneur de la province qui partait pour aller visiter la Laponie septentrionale de son gouvernement; je m'étais joint à lui pour prendre quelque idée du pays, en attendant l'arrivée de mes compagnons, et j'avais pénétré jusqu'à 15 lieues vers le Nord. J'étais monté la nuit du solstice sur une des plus hautes montagnes de ce pays, sur l'Avasaxa, et j'étais revenu aussitôt pour me trouver à Torneå à leur arrivée. Mais j'avais remarqué, dans ce voyage qui ne dura que trois jours, que le fleuve de Torneå suivait assez la direction du méridien jusqu'où je l'avais remonté, et j'avais découvert de tous côtés de hautes montagnes, qui pouvaient donner des points de vue fort éloignés. | ||
| Nous pensâmes donc à faire nos opérations au nord de Torneå sur les sommets de ces montagnes; mais cette entreprise ne paraissait guère possible. Il fallait faire dans les déserts d'un pays presque inhabitable, dans cette forêt immense qui s'étend depuis Torneå jusqu'au cap Nord, des opérations difficiles dans les pays les plus commodes. Il n'y avait que deux manières de pénétrer dans ces déserts, et qu'il fallait toutes les deux éprouver, l'une en naviguant sur un fleuve rempli de cataractes, l'autre en traversant à pied des forêts épaisses, ou des marais profonds. Supposé qu'on pût pénétrer dans le pays, il fallait, après les marches les plus rudes, escalader des montagnes escarpées; il fallait dépouiller leur sommet des arbres qui s'y trouvaient, et qui en empêchaient la vue; il fallait vivre dans ces déserts avec la plus mauvaise nourriture, et exposés aux mouches, qui y sont si cruelles, qu'elles forcent les Lapons et leurs rennes d'abandonner le pays dans cette saison, pour aller vers les côtes de l'océan chercher des lieux plus habitables. Enfin il fallait entreprendre cet ouvrage, sans savoir s'il était possible, et sans pouvoir s'en informer de personne, sans savoir si, après tant de peines, le défaut d'une montagne n'arrêterait pas absolument la suite de nos triangles, sans savoir si nous pourrions trouver sur le fleuve une base qui pût être liée avec nos triangles. Si tout cela réussissait, il faudrait ensuite bâtir des observatoires sur la plus septentrionale de nos montagnes, il faudrait y porter un attirail d'instruments plus complet qu'il ne s'en trouve dans plusieurs observatoires de l'Europe, il faudrait y faire des observations des plus subtiles de l'astronomie. Si tous ces obstacles étaient capables de nous effrayer, d'un autre côté cet ouvrage avait pour nous bien des attraits. Outre toutes les peines qu'il fallait vaincre, c'était mesurer le degré le plus septentrional que vraisemblablement il soit permis aux hommes de mesurer, le degré qui coupait le cercle polaire, et dont une partie serait dans la Zone glacée. Enfin après avoir désespéré de pouvoir faire usage des îles du golfe, c'était la seule ressource qui nous restait; car nous ne pouvions nous résoudre à redescendre dans les autres provinces plus méridionales de la Suède |
| . |
| |
| ||||||||
|