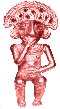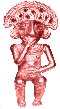
R. Berthelot
ca.1900 | La période wagnérienne (1869-76).
De 1869 à 1816, Nietzsche mena à Bâle la vie tranquille d'un professeur d'université; il passait ses vacances au bord des lacs de Suisse ou d'Italie et vivait à Bâle dans un petit cercle d'amis; l'un des principaux était Burckhardt, l'historien de l'art et de la Renaissance italienne, dont les idées eurent sans doute quelque action sur son esprit. Il allait souvent à Triebschen, près de Lucerne, visiter Wagner, dont il connaissait les oeuvres depuis sa jeunesse, auquel il avait été présenté à Leipzig et pour qui il éprouvait une admiration enthousiaste. Wagner, qui, pendant les premières années du séjour de Nietzsche à Bâle, achevait, dans une solitude presque complète, de composer la musique de Siegfried, se prit d'une amitié très vive pour ce jeune homme débordant d'intelligence et passionné de musique, et pendant plusieurs années la confiance entre eux fut absolue. italienne, dont les idées eurent sans doute quelque action sur son esprit. Il allait souvent à Triebschen, près de Lucerne, visiter Wagner, dont il connaissait les oeuvres depuis sa jeunesse, auquel il avait été présenté à Leipzig et pour qui il éprouvait une admiration enthousiaste. Wagner, qui, pendant les premières années du séjour de Nietzsche à Bâle, achevait, dans une solitude presque complète, de composer la musique de Siegfried, se prit d'une amitié très vive pour ce jeune homme débordant d'intelligence et passionné de musique, et pendant plusieurs années la confiance entre eux fut absolue. Parmi les influences extérieures qui s'exercèrent sur Nietzsche à cette époque, la plus profonde, avec celle de Wagner, fut celle de Schopenhauer; si Nietzsche n'eut jamais avec le philosophe de rapports personnels, il avait lu à Leipzig le Monde comme Volonté et Représentation et il avait été ému par cette lecture comme par la révélation d'un univers nouveau de sentiments et d'idées. Il ne pouvait qu'être confirmé dans son admiration par Wagner qui depuis 1854 voyait dans la doctrine de Schopenhauer l'expression philosophique de sa propre pensée. C'est en 1876 seulement que Nietzsche se détacha définitivement de Wagner et de Schopenhauer, et c'est la même année qu'une maladie contractée pendant la guerre de 1870, où il avait servi quelques semaines comme infirmier, l'obligea à prendre un congé d'un an. et il avait été ému par cette lecture comme par la révélation d'un univers nouveau de sentiments et d'idées. Il ne pouvait qu'être confirmé dans son admiration par Wagner qui depuis 1854 voyait dans la doctrine de Schopenhauer l'expression philosophique de sa propre pensée. C'est en 1876 seulement que Nietzsche se détacha définitivement de Wagner et de Schopenhauer, et c'est la même année qu'une maladie contractée pendant la guerre de 1870, où il avait servi quelques semaines comme infirmier, l'obligea à prendre un congé d'un an. Dans l'intervalle, entre 1869 et 1876, il avait professé des cours suivis sur l'histoire de la littérature grecque, de la religion grecque , de la philosophie grecque jusqu'à Platon inclusivement, rédigé en partie un livre sur la Philosophie dans l'âge tragique de la Grèce (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, composé de 1872 à 1875, publié seulement en 1896) et publié les ouvrages suivants : Die Geburt der Tragödie oder Griechenthum, und Pessimismus (composé entre 1869 et 1871, publié fin 1871 avec la date 1872); Unzeitdemässe Betrachtungen. 1, David Strauss, der Bekenner und Schriftsteller (composé et publié en 1873); 2, Vam Nutzen und Nachtheil der historie für das Leben (composé en octobre et novembre 1873, publié en février 1874); 3, Schopenhauer als Erzieher (composé et publié en octobre 1874); 4, Richard Wagner in Bayreuth , de la philosophie grecque jusqu'à Platon inclusivement, rédigé en partie un livre sur la Philosophie dans l'âge tragique de la Grèce (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, composé de 1872 à 1875, publié seulement en 1896) et publié les ouvrages suivants : Die Geburt der Tragödie oder Griechenthum, und Pessimismus (composé entre 1869 et 1871, publié fin 1871 avec la date 1872); Unzeitdemässe Betrachtungen. 1, David Strauss, der Bekenner und Schriftsteller (composé et publié en 1873); 2, Vam Nutzen und Nachtheil der historie für das Leben (composé en octobre et novembre 1873, publié en février 1874); 3, Schopenhauer als Erzieher (composé et publié en octobre 1874); 4, Richard Wagner in Bayreuth (composé en 1875 et 1876, paru en juillet 1876). L'interprétation et la glorification de la Grèce antique (composé en 1875 et 1876, paru en juillet 1876). L'interprétation et la glorification de la Grèce antique , la critique de la civilisation moderne, la conception d'un idéal supérieur, analogue à l'idéal hellénique et vers lequel Wagner et Schopenhauer peuvent nous guider, voilà le sujet de, ses livres et la matière de ses réflexions. , la critique de la civilisation moderne, la conception d'un idéal supérieur, analogue à l'idéal hellénique et vers lequel Wagner et Schopenhauer peuvent nous guider, voilà le sujet de, ses livres et la matière de ses réflexions. Quel est le sentiment de la vie dont le drame grec est l'expression? C'est à cette question que répond la Naissance de la tragédie. Nietzsche admet comme Schopenhauer que la nature est une activité aveugle, sans but, une puissance perpétuellement créatrice qui perpétuellement détruit ses propres créations et qui chez l'humain, devenue consciente d'elle-même, prend la forme d'un désir douloureux, toujours renouvelé et toujours inassouvi. Mais si l'existence du monde est moralement injustifiable, et si notre pensée réfléchie, brève apparition à la surface de l'univers, est misérablement impuissante dans la connaissance et dans l'action, l'humain, d'après Nietzsche, qui par là s'écarte de Schopenhauer, a le pouvoir de créer en lui des images du monde, des visions, des rêves, qui lui causent une joie artistique; c'est de ce pouvoir que procèdent les arts apolliniens, peinture , sculpture , sculpture et poésie épique et poésie épique . Bien plus, l'humain peut arriver à se sentir comme une volonté identique en son fond à l'activité même qui vit et souffre en toute chose; l'ivresse que cause en lui le sentiment de son union avec la nature entière est l'état dionysiaque; l'individu s'élève alors au-dessus de ses propres souffrances et se réjouit du spectacle tragique que présente l'univers, car il participe à la joie de l'activité impérissable qui survit à toutes les douleurs et à toutes les morts individuelles et qui ne, détruit que pour créer encore; les arts dionysiaques sont la musique . Bien plus, l'humain peut arriver à se sentir comme une volonté identique en son fond à l'activité même qui vit et souffre en toute chose; l'ivresse que cause en lui le sentiment de son union avec la nature entière est l'état dionysiaque; l'individu s'élève alors au-dessus de ses propres souffrances et se réjouit du spectacle tragique que présente l'univers, car il participe à la joie de l'activité impérissable qui survit à toutes les douleurs et à toutes les morts individuelles et qui ne, détruit que pour créer encore; les arts dionysiaques sont la musique et la poésie lyrique et la poésie lyrique . .
Seuls, donc, le rêve et l'ivresse artistiques, au milieu de l'universel changement et de l'universelle souffrance, permettent à l'humain de connaître la joie. L'optimisme grec est un optimisme artistique. Les Grecs sentent dans leur plénitude l'épouvante et la douleur de vivre, fils du hasard et de la peine, jouets impuissants des forces naturelles. Aussi créent-ils le monde des dieux de l'Olympe de l'Olympe , oeuvre de l'esprit apollinien. Homère est le type du Grec apollinien; vainqueur des terreurs de l'âge , oeuvre de l'esprit apollinien. Homère est le type du Grec apollinien; vainqueur des terreurs de l'âge des Titans des Titans . En face de l'épopée . En face de l'épopée , de l'art apollinien, surgissent bientôt le lyrisme, la musique , de l'art apollinien, surgissent bientôt le lyrisme, la musique , l'art dionysiaque. Et c'est de l'union d'Apollon , l'art dionysiaque. Et c'est de l'union d'Apollon et de Dionysos et de Dionysos , de l'épopée et du lyrisme, de la plastique et de la musique, qu'est né le drame d'Eschyle et de Sophocle, dont la forme est une succession de visions plastiques et dont le fond est l'émotion musicale et lyrique, l'enthousiasme dionysiaque né du spectacle même de la douleur et de la mort inévitables. Ce drame, c'est l'esprit socratique qui l'a tué. Socrate, dans son rationalisme optimiste, admet que l'humain, par la connaissance réfléchie, peut atteindre au bonheur; il admet que la finalité règne dans l'univers, que le monde a été disposé par des dieux bienveillants de manière à rendre possible le bonheur de l'humain et efficace la pensée humaine. Au nom de la science, de la pensée réfléchie, de la raison claire et confiante en sa toute-puissance, il condamne donc l'activité tout instinctive des Grecs de son temps, la vie hellénique, et avec elle il condamne l'art grec à cause de ce qu'il implique de musical, d'irrationnel, de pessimiste. , de l'épopée et du lyrisme, de la plastique et de la musique, qu'est né le drame d'Eschyle et de Sophocle, dont la forme est une succession de visions plastiques et dont le fond est l'émotion musicale et lyrique, l'enthousiasme dionysiaque né du spectacle même de la douleur et de la mort inévitables. Ce drame, c'est l'esprit socratique qui l'a tué. Socrate, dans son rationalisme optimiste, admet que l'humain, par la connaissance réfléchie, peut atteindre au bonheur; il admet que la finalité règne dans l'univers, que le monde a été disposé par des dieux bienveillants de manière à rendre possible le bonheur de l'humain et efficace la pensée humaine. Au nom de la science, de la pensée réfléchie, de la raison claire et confiante en sa toute-puissance, il condamne donc l'activité tout instinctive des Grecs de son temps, la vie hellénique, et avec elle il condamne l'art grec à cause de ce qu'il implique de musical, d'irrationnel, de pessimiste. L'époque de la tragédie est aussi celle de la philosophie « tragique » ( Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen). Dans l'oeuvre des précurseurs de Socrate, Nietzsche cherche le sentiment qu'ils avaient de la vie; tantôt leur pensée, dit-il, est pessimiste, tantôt c'est un optimisme artistique; pour les Pythagoriciens, pour Empédocle, l'univers on l'humain est condamné à vivre est le domaine de la souffrance; pour Parménide, c'est une illusion dont l'esprit doit se délivrer; pour Démocrite, le monde n'a aucune signification morale ou esthétique, rien n'existe que le jeu aveugle et fatal des forces mécaniques ( Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen). Dans l'oeuvre des précurseurs de Socrate, Nietzsche cherche le sentiment qu'ils avaient de la vie; tantôt leur pensée, dit-il, est pessimiste, tantôt c'est un optimisme artistique; pour les Pythagoriciens, pour Empédocle, l'univers on l'humain est condamné à vivre est le domaine de la souffrance; pour Parménide, c'est une illusion dont l'esprit doit se délivrer; pour Démocrite, le monde n'a aucune signification morale ou esthétique, rien n'existe que le jeu aveugle et fatal des forces mécaniques ( Philosophie mécanique); sa doctrine est le « pessimisme du hasard »; pour Héraclite, rien n'est qu'un devenir perpétuel, sans but, soumis à des lois nécessaires, un jeu de la divinité; pour Anaxagore, l'esprit, dont l'intervention produit dans le chaos primitif l'ordre et l'harmonie, se borne à en cadrer un mouvement, sans poursuivre, par un ensemble de moyens appropriés, un but extérieur à lui-même; son activité est un jeu libre, comme celle de l'artiste. Philosophie mécanique); sa doctrine est le « pessimisme du hasard »; pour Héraclite, rien n'est qu'un devenir perpétuel, sans but, soumis à des lois nécessaires, un jeu de la divinité; pour Anaxagore, l'esprit, dont l'intervention produit dans le chaos primitif l'ordre et l'harmonie, se borne à en cadrer un mouvement, sans poursuivre, par un ensemble de moyens appropriés, un but extérieur à lui-même; son activité est un jeu libre, comme celle de l'artiste. Avec l'optimisme de Socrate, sa croyance à la finalité naturelle, sa foi dans la dialectique, commence un âge nouveau; le philosophe subordonne tout à la recherche du bonheur individuel; la philosophie s'oppose à l'art et perd son caractère intuitif; le philosophe n'est plus un humain complet qui agit et prend part à la vie de la cité; sa vie devient purement contemplative. Ce qui fait la grandeur unique de l'époque qui a précédé les guerres médiques, l'époque d'Eschyle, d'Empédocle, d'Héraclite, c'est qu'aucun âge n'a été aussi favorable à la production des humains de génie, d'humains complets, résolus à vivre la vie la plus intense et la plus riche, penseurs, artistes, politiques tout à la fois, ayant le courage de voir la réalité comme elle est, dans toute son horreur tragique, et d'en accepter joyeusement les incertitudes et les dangers. La ruine de la civilisation grecque, avant qu'elle ait développé tous les germes, toutes les possibilités de vie supérieure qui étaient en elle, est elle-même un de ces jeux tragiques du hasard dont l'histoire, comme la nature, est pleine. Rien de plus opposé, on le voit, que les idées de Nietzsche à la théorie d'après laquelle les Grecs n'auraient été optimistes que par légèreté, insouciance, manque de réflexion profonde; rien de plus opposé aussi à la conception si « peu virile » qu'un Goethe se faisait de la Grèce, comme tout ordre, tout calme, toute harmonie. L'idéal hellénique doit être notre idéal. Le penseur doit être un « philosophe tragique-», qui voit et qui montre dans la nature une puissance redoutable et souvent malfaisante, dans l'histoire le jeu brutal et vide de sens de la force et du hasard, qui proclame l'impossibilité du bonheur, qui hait le bien-être matériel où se complaît le commun des humains et qui, également insoucieux de ses propres douleurs et des douleurs qu'il cause autour de lui, critique et combat toutes les illusions, tous les mensonges, toutes les faiblesses et toutes les lâchetés de notre civilisation. Pour lui, le pessimisme n'est pas un principe d'inertie et de résignation, mais d'activité héroïque : « L'humanité doit toujours travailler à mettre au monde des individus de génie. » C'est à cette oeuvre que l'éducateur doit se dévouer, et tout penseur doit être un éducateur, éducateur de lui-même et d'autrui; il doit « hâter la naissance et le développement du philosophe, de l'artiste, du saint, en nous et hors de nous, et collaborer ainsi à la suprême perfection de la nature ». « Je vois au-dessus de moi, dit encore Nietzsche, quelque chose de plus élevé, de plus humain que ce que le suis moi-même; aidez-moi tous à atteindre cet idéal, comme je viendrai moi-même en aide à celui qui pensera comme moi et souffrira comme moi. » « Il est possible d'obtenir par d'heureuses inventions des types de grands hommes tout autres et plus puissants que ceux qui, jusqu'à présent, ont été façonnés par des circonstances fortuites. » Aujourd'hui comme en Grèce, la production de types supérieurs d'humanité exige l'oppression du plus grand nombre. « L'esclavage est une des conditions essentielles d'une haute culture. » Le bonheur n'est pas plus fait pour la foule que pour l'élite; l'une et l'autre doivent sacrifier leur bonheur à la réalisation d'un idéal de grandeur et de beauté. La même nécessité tragique qui règne dans la nature régit aussi la société : « Chaque instant dévore le précédent; chaque naissance est la mort d'êtres innombrables; engendrer, vivre et assassiner ne sont qu'un. Et c'est pourquoi aussi nous pouvons comparer la culture triomphante à un vainqueur dégouttant de sang et qui trame à la suite de son cortège triomphal un troupeau de vaincus, d'esclaves enchaînés à son char. » Autour de lui que voyait Nietzsche? Le petit bourgeois allemand ou suisse. Dans quel milieu vivait-il? Parmi des bourgeois de petite ville. Contre l'optimisme-utilitaire et scientifique où se résume leur philosophie de l'existence, il se révolte. De là ses attaques contre Strauss, contre les historiens modernes, contre tous ceux qui placent le but de la vie dans le bonheur, dans le bien-être matériel, la fin de la société, le sens et le terme de l'évolution historique, dans la possibilité d'assurer un jour à tous la sécurité, le bien-être, un bonheur médiocre. Idéal à la fois méprisable et chimérique! Les maîtres, les éducateurs qui, dès maintenant, peuvent arracher les âmes au culte du bonheur et du bien-être, à l'optimisme, à la foi dans la toute-puissance de la raison scientifique ( Scientisme Scientisme ), c'est Schopenhauer et c'est Wagner. Le premier apprend à voir la nature et la vie comme, elles sont, avec ce qu'elles impliquent de souffrances, il enseigne que le bonheur est impossible, et, procédant, comme les premiers philosophes grecs, par intuitions artistiques, non par raisonnements, il s'adresse à l'âme tout entière. Si Schopenhauer fait songer, par son pessimisme et par ses intuitions d'artiste, à un Héraclite ou à un Empédocle, Wagner est un Eschyle moderne; son drame musical est une résurrection de la tragédie antique; il a réuni de nouveau tous les arts pour parler à l'humain tout entier, pour communiquer à ses auditeurs sa « sagesse tragique » et l'exaltation « dionysiaque » qui le saisit en présence de la fatalité. L'oeuvre de Bayreuth ), c'est Schopenhauer et c'est Wagner. Le premier apprend à voir la nature et la vie comme, elles sont, avec ce qu'elles impliquent de souffrances, il enseigne que le bonheur est impossible, et, procédant, comme les premiers philosophes grecs, par intuitions artistiques, non par raisonnements, il s'adresse à l'âme tout entière. Si Schopenhauer fait songer, par son pessimisme et par ses intuitions d'artiste, à un Héraclite ou à un Empédocle, Wagner est un Eschyle moderne; son drame musical est une résurrection de la tragédie antique; il a réuni de nouveau tous les arts pour parler à l'humain tout entier, pour communiquer à ses auditeurs sa « sagesse tragique » et l'exaltation « dionysiaque » qui le saisit en présence de la fatalité. L'oeuvre de Bayreuth et la philosophie de Schopenhauer nous sont des présages d'une renaissance de la culture antique dans l'Allemagne contemporaine. (René Berthelot). et la philosophie de Schopenhauer nous sont des présages d'une renaissance de la culture antique dans l'Allemagne contemporaine. (René Berthelot). | |